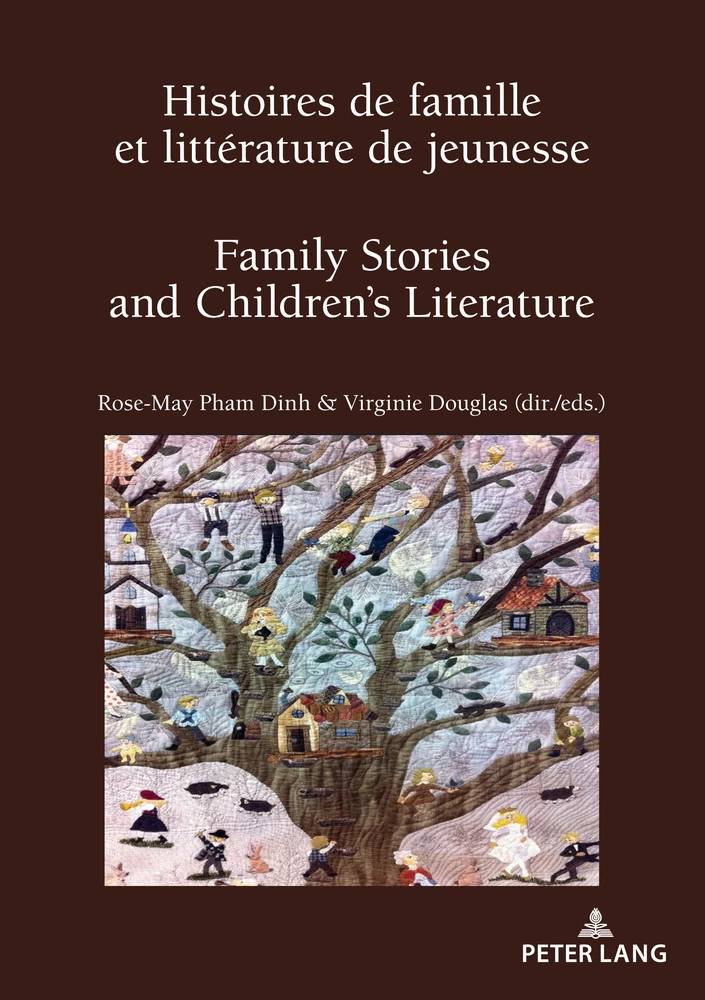Histoires de famille et littérature de jeunesse / Family Stories and Children’s Literature
Filiation, transmission, réinvention ? / Parentage, Transmission or Reinvention?
Résumé
This book re-examines the representation of the family in novels, picture books or theatre plays for young people, belonging to various geographical, cultural and linguistic areas.The bonds between generations or among siblings, whether benevolent or destructive, play a decisive part in the young protagonists’ development. Children’s literature is shown to reflect the diversity of the family as an institution and its ability to change or even to reinvent itself (single-parent, same-sex-parent, blended or adoptive families…). Its fictional representations of the family may differ from the realities experienced by the readers, and invites them to reconsider their own experiences, yet show expectations and questions related to family life to remain fairly constant.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction (en français)
- Introduction (in English)
- PREMIÈRE PARTIE : FAMILLE(S) ET SOCIÉTÉ(S) / FAMILIES AND SOCIETIES
- Section 1. La famille, marqueur de l’identité culturelle / The family as a mark of cultural identity
- 1 From Cornerstone to Cozy Hearth: The Image of the Family in Nineteenth-Century Flemish Children’s Literature
- 2 Family Models in Catalan Children’s Literature
- 3 La famille dans la littérature de jeunesse francophone africaine : discours, figures, espaces
- Section 2. La famille face à la diversité culturelle / The family and cultural diversity
- 4 Dealing with the “Otherness” of Your “Own” Children: Spanish Children’s Books about Transnational Adoption
- 5 Figures tutélaires et espaces de reconfigurations de la transmission familiale dans la littérature de jeunesse migrante contemporaine
- 6 Familles dans les albums de fiction pour la jeunesse : questions de couleur de peau
- DEUXIÈME PARTIE : LA FAMILLE À L’ÉPREUVE DU TEMPS / THE FAMILY: A TIME-TESTED INSTITUTION
- Section 1. Nouvelles problématiques / New issues
- 7 Dynamiques familiales dans Harry Potter : vers une nouvelle conception de la famille ?
- 8 Histoires de filles : l’univers mère-fille dans quelques romans francophones et anglophones pour adolescentes
- 9 « Clones, je vous hais ! » Remise en question des liens familiaux dans les fictions sur le clonage humain
- Section 2. Réinvention et pérennité / Reinventing or perpetuating the family
- 10 The Yearling: A Cracker Family Romance
- 11 Bossy Wives, Working Moms and Unfaithful Husbands: The Un-historical Family in Kjartan Poskitt’s Historical Plays for Young Adults
- 12 “Ordinary Life? In this family we know there’s no such thing.” The Child as the Saviour of the Father in Salman Rushdie’s Luka and the Fire of Life
- Postface
- Afterword
- Les auteurs / Contributors
- Abstracts
- Titres de la collection
Introduction
Université Sorbonne Paris Nord (France)
La société, ça n’existe pas. Ce qui existe, ce sont les hommes, les femmes et les familles.
Margaret Thatcher1
La famille, reposant sur l’union plus ou moins durable, mais socialement approuvée, de deux individus de sexes différents qui fondent un ménage, procréent et élèvent des enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement universel, présent dans tous les types de sociétés.
Claude Lévi-Strauss2
La famille, enjeu social et politique
Une question d’actualité
La réflexion qui est au centre du volume que nous présentons ici est née d’abord d’une interrogation sur la notion de famille et son évolution, dans un contexte – le début du XXIe siècle – à nouveau marqué par des débats publics et politiques la concernant. En France, la légalisation du mariage dit « pour tous » le 17 mai 2013 a suscité controverses et ←15 | 16→manifestations avant d’être adoptée, précédant ainsi de quelques mois son équivalent au Royaume-Uni. La loi française a été portée par un gouvernement socialiste et plus spécifiquement par la personnalité classée très à gauche qu’est Christiane Taubira3. En revanche, dans le cas britannique, la législation a été introduite par le Conservateur David Cameron4. Comme le montre Stéphane Porion, c’était un pari risqué mais stratégique que de faire d’un parti associé à la défense des traditions le fer de lance de cette nouvelle révolution des institutions5. En se revendiquant comme le « parti de la famille », les Conservateurs se positionnent en effet traditionnellement comme les défenseurs du modèle familial classique (couple parental marié et enfants qui en sont issus) contre les formes alternatives (cohabitation, familles monoparentales ou recomposées), dont la multiplication est perçue comme une réalité sociale qu’il convient de déplorer, et non d’accepter, voire d’encourager, comme le ferait supposément l’opposition travailliste. En proposant une nouvelle étape dans la légitimation d’une pluralité des modèles familiaux, Cameron prenait le monde politique à contrepied. Comme le démontre Stéphane Porion, il s’agissait pour lui de continuer à réinventer le parti Conservateur en se démarquant de l’héritage thatchérien, y compris dans sa dimension morale, et de l’inscrire dans une forme de modernité, là où la Dame de Fer avait semblé prôner le retour aux valeurs victoriennes, insistant sur le rôle fondamental des familles dans l’éducation des futurs citoyens6.
←16 | 17→La famille, plurielle et universelle
Ce préambule met en évidence les forts enjeux idéologiques et politiques liés à la famille et à sa représentation7. Il est aussi un rappel de la pluralité des réalités couvertes par le mot « famille » et de la confusion que peut engendrer son emploi générique. Pas plus que l’expérience de l’enfance, la famille ne saurait être décrite comme uniforme ; elle n’en est pas moins un « phénomène universel », comme l’écrivait Serge Vallon en 20068. S’appuyant entre autres sur les travaux de Claude Lévi-Strauss, l’auteur, docteur en psychologie et psychanalyste, montrait la nécessité de recourir à l’ensemble des sciences humaines pour rendre compte de cette « réalité complexe ».
Concernant la perspective historique, il est d’ailleurs opportun de se rappeler que le grand classique de Philippe Ariès sur l’enfance, qui demeure une référence incontournable, même si certaines de ses thèses ont été contestées ou nuancées par des travaux ultérieurs, s’intitule L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime9. Le titre inscrit ainsi d’emblée l’étude de l’enfance dans le cadre des rapports de l’enfant à la famille qui l’a vu naître et/ou grandir10.
Dans l’Ancien Régime évoqué par le titre d’Ariès, et longtemps encore après sa disparition, l’importance de la filiation se manifeste dans tout ce qui concerne les questions d’héritage – la transmission des terres, des titres, des biens ou du savoir-faire – et, a contrario, par la stigmatisation des enfants adultérins ou nés de père inconnu. Il est difficile pour l’enfant « de personne » d’exister socialement, en dehors d’une généalogie familiale établie11 et, ←17 | 18→sur le plan psychologique, de se construire en l’absence d’un père identifié, voire dans l’ignorance de ses origines ou dans le mensonge qui les entoure12. Aux yeux des autres comme dans son propre regard, l’enfant ne se définit pas indépendamment de ses parents : enfance et famille sont de ce point de vue difficilement dissociables.
Bien sûr, filiation biologique et filiation juridique ne se superposent pas toujours à l’identique, ce qui est une des sources de la complexité évoquée par Vallon. Quelles que soient les circonstances de sa conception, l’enfant porte en lui l’héritage génétique de ses deux parents biologiques, mais les adultes qui l’ont procréé ne sont pas nécessairement ceux qui se chargent de l’élever. Veuvage et remariage, abandon, adoption, mise en nourrice : autant d’événements qui ont toujours conduit à des phénomènes de recomposition familiale. Plus récemment, les progrès de la médecine dans le domaine de la PMA (procréation médicalement assistée) ont rendu possible la naissance d’enfants au sein de couples biologiquement stériles, augmentant les possibilités de divergence entre les deux types de filiation. Le père qui reconnaît l’enfant à la naissance n’est ainsi pas toujours l’homme qui a physiologiquement rendu cette naissance possible, et dans le cas de la PMA, il sait d’emblée – comme la mère – que c’est le cas ; c’est en cela que le phénomène diffère des précédents historiques où des hommes pouvaient être amenés à reconnaître comme leurs des enfants conçus par leur épouse avec d’autres qu’eux sans nécessairement savoir ce qu’il en était13.
Du côté féminin, les choses peuvent être encore plus compliquées, concernant l’éclatement de la fonction maternelle. Il est médicalement possible à une femme de fournir les gamètes, à une autre de mener la grossesse à terme, à une troisième éventuellement de prendre en charge l’enfant à la naissance. La GPA (gestation pour autrui) permet en tout cas ←18 | 19→à une femme de porter et de mettre au monde un enfant qu’elle remettra ensuite à l’individu ou au couple – hétérosexuel ou homosexuel – qui a choisi cette voie pour accéder à la parentalité. On sait d’ailleurs que la GPA est toujours l’objet de vifs débats en France, où elle demeure illégale, ce qui place les enfants nés à l’étranger par ce procédé pour le compte de parents français dans une situation qui a longtemps paru insoluble, quant à la reconnaissance de leur filiation avec ceux que la loi désigne comme les « parents d’intention », jusqu’à une récente décision de justice14, qui ne préjuge pas de l’évolution ultérieure de la loi.
Le débat juridique renvoie bien sûr aux questions éthiques soulevées par la mise en œuvre d’une grossesse de ce type. Certains saluent une forme de « don de soi » permettant à ces derniers d’accéder à une parentalité ardemment désirée quand d’autres considèrent que la mère porteuse, même « volontaire », est nécessairement exploitée et son corps loué par les « commanditaires ». Les risques inhérents à la marchandisation de l’humain sont ainsi dénoncés, comme ils ont pu l’être aussi dans le cas de l’adoption internationale, qui voit le plus souvent des parents venant de pays aisés accueillir des enfants issus de régions plus pauvres du monde, au prix de transactions impliquant au moins une contribution des adoptants au financement des structures qui ont au préalable pris soin de l’enfant ou facilité la procédure.
La dimension financière n’est d’ailleurs pas la seule raison pour laquelle ces pratiques sont mises en cause par leurs détracteurs : la revendication du « droit à l’enfant » en tant que telle ne fait pas l’unanimité15, même si elle renvoie à l’expression d’un sentiment d’incomplétude qui s’inscrit dans une évolution plus générale de la société. Comme l’indique Pierre Grelley, dans des sociétés comme la France contemporaine, ce n’est plus le mariage mais l’enfant qui fonde la famille :
[…] les évolutions récentes des pratiques sociales ont fait perdre ce rôle d’acte fondateur de la famille au mariage, qui n’est plus depuis 1884 un ←19 | 20→engagement social irréversible, le divorce constituant même de nos jours l’issue de plus en plus précoce de près d’une union sur deux. Si l’on ajoute à ce constat celui d’une sorte d’inversion du calendrier en vertu de laquelle beaucoup d’enfants (un sur deux en 2007 selon l’Insee) naissent avant que leurs parents ne convolent, essentiellement alors dans le but de légitimer leur descendance, il devient difficile de soutenir que c’est toujours le mariage qui fait la famille16.
Dans cette perspective, c’est bien l’arrivée de l’enfant qui est le préalable à la vie de famille, laquelle est distincte de la vie de couple que les individus concernés peuvent ou non déjà connaître. L’expression « famille sans enfants » en deviendrait presque une contradiction dans les termes.
En contrepoint, les progrès de la contraception et l’accès à l’avortement, là où les deux sont légalement accessibles, permettent depuis longtemps de dissocier sexualité et procréation, y compris au sein de couples dont la relation est installée, mais qui ne sont pas désireux de donner naissance à des enfants. De fait, le slogan « un enfant si je veux, quand je veux »17 a d’abord servi à accompagner les revendications féministes en faveur d’un contrôle des naissances : il s’agissait de ne pas mettre au monde d’enfant non désiré. Désormais, c’est la possibilité de faire naître un bébé que l’on désire, malgré les obstacles que la « nature » peut mettre sur votre chemin, qui devient l’enjeu de la PMA18.
Comme le souligne Pierre Grelley, dans la perspective qui est la sienne, c’est bien cette pluralité des réalités familiales qui s’est imposée au législateur français19. Comment cette diversité est-elle prise en compte dans la littérature de jeunesse ? C’est ce que ce volume se propose d’explorer.
←20 | 21→Famille et littérature de jeunesse
Variations historiques
En plein ou en creux, la famille a toujours occupé une place importante dans les thématiques des livres pour la jeunesse20.
Rappelons en effet d’abord que la littérature de jeunesse regorge d’orphelins au destin plus ou moins douloureusement marqué par leur condition, vécue tantôt comme « une chance », tantôt comme « un manque », pour reprendre la présentation binaire que fait Laurent Bazin21 de ce phénomène, avant de démontrer la complexité et la richesse des interprétations multiples auxquelles ce constat peut donner lieu. La mort des parents est parfois simplement une version extrême de la convention narrative qui veut que les jeunes protagonistes de romans pour la jeunesse soient placés en position d’autonomie22 au cœur de l’action et les adultes relégués à l’arrière-plan. Le statut d’orphelin des personnages n’invite donc pas nécessairement les jeunes lecteurs à ressentir de la compassion ou de l’apitoiement à leur égard. Ainsi, dans le cas de Fifi Brindacier (Pippi Långstrump), héroïne créée par la Suédoise Astrid Lindgren, l’absence de parents est synonyme de totale liberté, sort qui peut apparaître enviable à des enfants soumis à une autorité parentale plus ou moins bien acceptée. ←21 | 22→Comme le montre Laurent Bazin, cette absence parentale peut même parfois se lire comme la condition préalable à la naissance du héros23.
Dans d’autres cas, au contraire, sont mises en avant les implications plutôt négatives du décès des parents, en termes psychologiques et sociologiques. La solitude et la vulnérabilité de l’enfant sont alors mises en évidence. Ainsi, dans le bien nommé Sans famille (1878), classique d’Hector Malot, Rémi, enfant trouvé, est tributaire d’adultes qui l’exploitent plus souvent qu’ils ne l’accueillent, avant de retrouver la riche mère anglaise dont il avait été séparé. De même, Sara, dans A Little Princess (1905) de Frances Hodgson Burnett, se retrouve-t-elle à la merci de la directrice de la pension où l’a laissée son père, lorsque celui-ci disparaît. Plus près de nous, comment ne pas évoquer Harry Potter (1997-2007) ? Non seulement son destin est intimement lié à la mort tragique de ses parents, mais la douleur de leur absence l’accompagne tout au long de ses aventures, même lorsque son admission à l’école des Sorciers lui permet d’échapper à sa triste vie chez son oncle et sa tante Dursley.
En faisant de l’amour dont sa mère l’a entouré jusqu’à sa fin tragique l’un des ingrédients principaux du pouvoir que possède Harry face à Voldemort, J.K. Rowling illustre et prolonge à sa manière une tendance signalée par Kimberley Reynolds dans un chapitre consacré à la fiction anglo-américaine du milieu du XXe siècle24, analysée dans ses rapports avec l’évolution du rôle assigné à la famille. Dans le passé, rappelle K. Reynolds, la famille remplissait d’abord une fonction économique, alors qu’elle est désormais perçue avant tout comme une source de sécurité émotionnelle. Dans la période qu’elle étudie de plus près (1920–1960), on lui assigne un rôle crucial pour le bon développement de l’enfant, garant de sa future intégration sociale : « Dans la plus grande partie du monde anglophone à l’époque, la famille était l’unité de base de la société et le pivot du changement social. On tenait pour acquis qu’elle enseignerait aux enfants à devenir des citoyens responsables et ←22 | 23→productifs25. » Comme le souligne K. Reynolds, la variété des discours tenus lors de la période qu’elle analyse sur ce qui constitue « une bonne façon d’être parents, une enfance “normale” et la famille idéale est ce qui démontre le plus clairement qu’enfance et parentalité sont deux notions socialement construites »26. À mesure qu’évoluent l’idée de l’enfance et celle de la famille, leur représentation par la littérature de jeunesse comme dans d’autres types d’ouvrages, est donc, elle aussi, susceptible de variations.
Pour aborder la représentation de la famille dans la littérature de jeunesse, on peut commencer par s’intéresser aux contes traditionnels. La fondation de la famille constitue le point d’orgue que la mémoire collective leur associe : selon la formule rituelle, « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants »27. Néanmoins, beaucoup de ces contes donnent surtout à voir des familles dysfonctionnelles. Qu’on pense au père incestueux de Peau d’Âne, à la marâtre de Blanche-Neige ou à celle de Cendrillon, aux parents « abandonnants » du Petit Poucet, pour n’en citer que quelques-uns. Comme l’a montré Bruno Bettelheim, les difficultés auxquelles sont confrontés les personnages des contes sont précisément ce qui contribue au bon développement psychique de l’enfant en lui permettant de surmonter les angoisses et les sentiments ambivalents qu’il peut éprouver vis-à-vis de ses parents ou d’autres membres de sa famille, et en lui donnant confiance en sa capacité à se sortir des épreuves qui se présenteront dans sa vie à venir : « […] les contes anciens lui disent ce qu’il a tellement besoin d’entendre : que le monde est terrible mais qu’il saura s’en sortir. Ils lui disent aussi qu’il est encore petit et qu’il a besoin d’aide, mais qu’il ne doit pas s’en inquiéter et qu’il en trouvera »28.
←23 | 24→Pour Bettelheim, les contes traditionnels sont supérieurs à d’autres types de livres pour enfants précisément parce qu’ils mettent en scène le mal autant que la vertu, et n’édulcorent pas les réalités de l’existence ou les aspects les plus laids de l’âme humaine, tout en laissant entendre que les épreuves rencontrées sont surmontables et peuvent aboutir à une fin heureuse. Depuis la parution de Psychanalyse des contes de fées (The Uses of Enchantment) en 1976, la littérature de jeunesse a connu une évolution qui semblerait de nature à modifier les termes de la comparaison. Elle s’est ouverte à un courant qui, loin de privilégier le côté « ensoleillé »29 de l’existence, s’évertue au contraire à en présenter aussi – voire surtout – la dimension plus obscure, souvent sans laisser entrevoir la possibilité d’une résolution des problèmes même à la fin des histoires. La décennie 1970 apparaît d’ailleurs rétroactivement comme celle qui, aux ÉtatsUnis puis au Royaume-Uni30, a vu paraître les premiers romans pour la jeunesse revendiquant un réalisme social sans concession, et abordant de plus en plus crûment des questions jusque-là plutôt taboues : sexualité, drogue, violence, etc., quitte à heurter les sensibilités de la partie plus conservatrice de l’opinion.
Ce bouleversement coïncide avec les profondes mutations de la société occidentale et la remise en cause des modèles familiaux traditionnels, favorisée par les changements concernant la position des femmes en son sein. Divorce, naissances hors mariage, mais aussi accès légal à la contraception et à l’avortement, sont autant de facteurs qui sont venus modifier la façon dont la famille hétérosexuelle se construit et évolue au ←24 | 25→fil du temps, avant même l’émergence de la famille homoparentale déjà évoquée.
Comme le législateur ou le politicien, les acteurs de la production littéraire et de la médiation culturelle sont face à des changements qu’ils peuvent choisir de refléter ou non dans les histoires qu’ils proposent, selon leurs propres sensibilités mais aussi selon ce qu’ils pensent approprié, acceptable et attrayant pour le public visé31. Ils peuvent aussi être à l’initiative de certaines évolutions et, indépendamment des intentions conscientes et explicites de leurs auteurs, les livres lus par les enfants, comme l’a magistralement montré Peter Hollindale32, sont porteurs d’un contenu idéologique complexe, en partie co-construit par les jeunes lecteurs eux-mêmes. La littérature de jeunesse, historiquement chargée tout à la fois d’éduquer et de distraire ses lecteurs, peut à ce titre tantôt servir à perpétuer l’ordre et les valeurs établis, tantôt agir comme moteur d’une inflexion désirée. Elle peut être vue comme l’instrument qui sert tous les conformismes33 ou se révéler comme le lieu par excellence de la subversion34.
Comme l’a montré un récent numéro de Strenae dirigé par Sophie Heywood35, on peut en particulier analyser l’évolution de la littérature de jeunesse dans le cadre général des remises en question sociétales qui agitent la période qu’elle choisit de désigner – comme Daniel Sherman et d’autres historiens36 – sous le nom de « long 1968 », période qui s’étendrait de la fin des années 1950 à celle des années 1970. Dans son introduction, S. Heywood cite les propos revendicatifs d’auteurs d’albums comme Tomi Ungerer et Maurice Sendak. Le premier affirme que les enfants ←25 | 26→« […] doivent prendre la réalité en pleine figure »37 tandis que le second renchérit : « Bien sûr, nous voulons protéger nos enfants d’expériences douloureuses qui dépasseraient leurs capacités de compréhension et qui les angoisseraient […] [mais] c’est à travers l’imagination que les enfants réussissent la catharsis. C’est leur meilleur outil pour se défendre contre les maximonstres38. » Comme S. Heywood l’indique, l’expérience individuelle et familiale de ces deux auteurs, marqués par la Seconde Guerre mondiale et par la Shoah, sous-tend leur prise de parole39. Mais ce positionnement, somme toute proche de celui qui amenait Bettelheim à préférer les contes, signifie aussi que la littérature de jeunesse doit se faire le reflet des réalités d’une société en mutation, voire en crise, plutôt que s’évertuer à représenter un monde idéal – aux yeux de certains – et décalé par rapport aux bouleversements en cours.
Appliqué au domaine de la représentation de la famille, cela implique que le modèle désormais contesté de la famille nucléaire patriarcale ne soit plus le seul à être présenté comme la norme, mais qu’albums et romans fassent place à ces autres modes de vie familiale que connaissent un nombre grandissant des enfants lecteurs : ceux qui vivent le divorce, qui sont élevés par un seul de leurs parents, par choix ou par nécessité, ou qui grandissent dans une famille où les mères travaillent autant que les pères, par exemple. Le mouvement féministe incite à dénoncer les stéréotypes de genre qui pullulent dans la littérature de jeunesse existante et à proposer en contrepoids des ouvrages proposant une vision plus égalitaire des relations entre personnages masculins et féminins. Cette remise en cause de l’idéologie dominante amène aussi à lutter contre les préjugés de classe ou ceux liés à l’origine ethnique, comme y incitent au Royaume-Uni des critiques tels que Bob Dixon40.
Résumé des informations
- Pages
- 312
- Année de publication
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9782807615786
- ISBN (ePUB)
- 9782807615793
- ISBN (MOBI)
- 9782807615809
- ISBN (Broché)
- 9782807609433
- DOI
- 10.3726/b17303
- Langue
- français
- Date de parution
- 2021 (Mai)
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 312 p., 1 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG