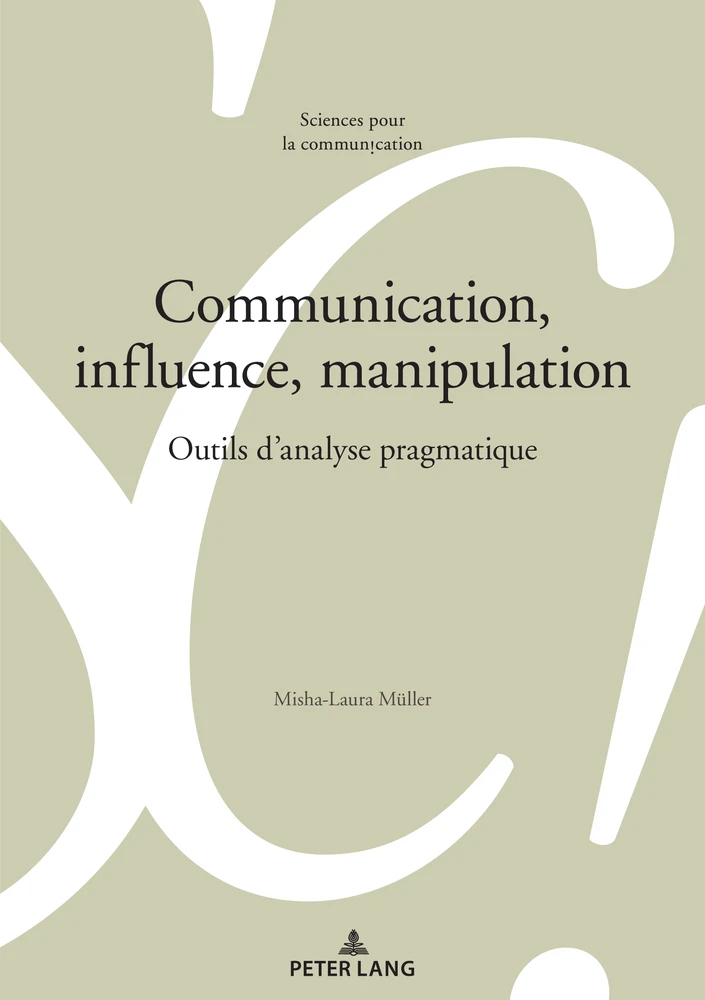Communication, influence, manipulation
outils d’analyse pragmatique
Summary
L’auteure confronte les approches gricéennes avec la théorie de la Pertinence, s’opposant à l’idée que la communication implicite est fondamentalement manipulatrice. À l’aide d’exemples empiriques, l’ouvrage explore la complexité de la reconstruction du sens, du point de vue du destinataire. Ce dernier possède un appareillage cognitif qui attribue spontanément des engagements au locuteur, y compris dans les contenus implicites. Cette perspective ouvre des horizons prometteurs dans le domaine de l’argumentation et de la détection de sophismes.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Introduction
- Remerciements
- Chapitre 1. Communication implicite et annulabilité de contenus dans la perspective de Grice
- 1.0. Introduction
- 1.1. La signification naturelle et la signification non-naturelle
- 1.1.1. La significationNN selon Searle
- 1.1.2. La réponse de Grice à Searle
- 1.2. La théorie des implicatures de Grice
- 1.2.1. Typologie des implicatures
- 1.2.2. L’annulation des implicatures conversationnelles
- 1.2.3. Le Principe de Coopération
- 1.3. Conclusion
- Chapitre 2. La communication implicite comme outil de manipulation
- 2.0. Introduction
- 2.1. La logique du discours implicite
- 2.1.1. Les rétractations plausibles
- 2.1.2. Les rétractations possibles
- 2.2. Les origines manipulatrices de la communication implicite
- 2.2.1. La communication implicite et l’externalisation de la compétence linguistique
- 2.2.2. Le critère de vériconditionnalité pour la communication implicite
- 2.2.3. Cacher ses intentions manipulatrices
- 2.2.4. Le problème de la non-coopérativité de la communication implicite
- 2.2.5. L’émergence de la communication implicite
- 2.3. Conclusion
- Chapitre 3. La communication implicite selon la théorie de la Pertinence
- 3.0. Introduction
- 3.1. La pertinence, comme heuristique de compréhension
- 3.1.1. Des stimuli mutuellement manifestes
- 3.1.2. La métareprésentation
- 3.1.3. La vigilance épistémique du destinataire
- 3.2. La frontière explicite vs implicite selon la théorie de la Pertinence
- 3.2.1. Les explicatures
- 3.2.2. Explicatures et rétractabilité
- 3.2.3. Simplification de la typologie gricéene
- 3.2.4. Conséquences de la typologie post-gricéenne sur la rétractabilité des contenus implicites
- 3.3. L’identification de contenus, au-delà de l’intention communicative du locuteur
- 3.3.1. Implicatures fortes et implicatures faibles
- 3.3.2. Les « effets présuppositionnels » dans la théorie de la Pertinence
- 3.3.3. Les présuppositions sémantiques et discursives
- 3.2.4. Conséquences de la typologie post-gricéenne sur la rétractabilité des présuppositions
- 3.4. Conclusion
- Chapitre 4. L’attribution d’engagements au locuteur
- 4.0. Introduction
- 4.1. Le sophisme de l’épouvantail : l’art de fausser la représentation des engagements du locuteur
- 4.1.1. Engagement du locuteur et Pertinence
- 4.1.2. Engagement du locuteur et vigilance épistémique
- 4.2. Sophisme de l’épouvantail et rétractation du locuteur
- 4.2.1. Sophisme de l’épouvantail : l’intérêt d’une approche cognitive (exemple 1)
- 4.2.2. Sophisme de l’épouvantail : de l’attribution d’un contenu à l’attribution d’une pensée (exemple 2)
- 4.3. Conclusion
- Conclusion générale
- Bibliographie
Introduction
Depuis la publication de l’article fondateur de Grice, Logic et Conversation (1975), la communication verbale a majoritairement été conçue comme étant divisée entre ce que le locuteur dit et ce qu’il communique à son destinataire. Ce phénomène peut s’illustrer à travers l’échange conversationnel ci-dessous :
Marie : Veux-tu un verre de whisky ?
Paul : Il est 20h30 ! (Contenu explicite)
→ Oui, je veux verre de whisky ! (Contenu implicite)
Le contenu explicitement communiqué par Paul ne répond pas directement à la question posée. En effet, il ne dit pas véritablement si, oui ou non, il souhaite boire un verre de whisky. Dans ce contexte, le locuteur communique davantage que ce qu’il dit explicitement. La réponse à la question est alors implicite : lorsque Paul énonce « Il est 20h30 », il invite le destinataire à comprendre que, en règle générale, 20h30 est une heure appropriée pour boire un verre de whisky et que, par conséquent, il accepte la proposition de boire du whisky.
Le contexte et les connaissances encyclopédiques du destinataire sont fondamentales pour évaluer l’intention communicative du locuteur. En effet, comme illustré ci-dessous, il suffit de changer la boisson dont il est question pour obtenir une réponse tout à fait différente :
Marie : Veux-tu un café ?
Paul : Il est 20h30 ! (Contenu explicite)
→ Non, je ne veux pas de café. (Contenu implicite)
Dans cet exemple, Paul invoque l’heure tardive comme argument pour refuser la proposition de boire du café, car cela aurait pour conséquence de l’empêcher de dormir (ce qui n’est pas souhaitable dans ce contexte). Ainsi, le fait de souligner qu’il est 20h30 lui permet de dire, implicitement, qu’il décline la proposition.
Enfin, les contenus implicites ont la propriété d’être logiquement annulables1, permettant ainsi au locuteur de nier les avoir communiqués. Si l’on reprend le premier exemple cité plus haut, la négation du contenu implicite prendrait la forme suivante :
Marie : Veux-tu un verre de whisky ?
Paul : Il est 20h30… mais c’est lundi ! (Contenu explicite)
→ Non, je ne veux pas de verre de whisky. (Contenu implicite)
Ici, contrairement à l’exemple précédent, le locuteur décline la proposition de boire du whisky. Il le fait par l’annulation du contenu implicite initialement déclenché par « Il est 20h30 », qui communiquait l’acceptation de la proposition. L’annulation se fait par l’ajout d’une deuxième proposition, « mais c’est lundi ! », qui contraste avec la proposition initiale. En effet, le locuteur souligne implicitement que, malgré le fait que l’heure soit propice à boire du whisky, il n’est pas acceptable de boire de l’alcool en début de semaine. Comme dans le premier exemple, le contenu implicite est compris grâce à des connaissances mutuellement partagées au sujet de normes sociales (i.e., bien que l’heure soit propice à boire de l’alcool, il n’est généralement pas acceptable de le faire en début de semaine).
Le caractère annulable des contenus implicites est à l’origine de théories en psychologie et en linguistique, soutenant que la communication implicite est un outil idéal pour manipuler autrui. Dans La Logique du Discours Indirect, Pinker, Nowak et Lee (2008) soutiennent que la communication implicite n’apporte aucun bénéfice pour la transmission d’informations : selon eux, un contenu implicite génère des coûts superflus pour la compréhension verbale et présente un risque important d’être la source de malentendus. Sur la base de ces éléments, Pinker et collègues soutiennent que la fonction essentielle du contenu implicite réside dans l’exploitation de sa propriété annulable, permettant au locuteur de manipuler autrui. En effet, l’annulation du contenu implicite donne la possibilité de nier une information potentiellement trompeuse, préservant ainsi la réputation sociale du locuteur.
L’exemple ci-dessous (adapté de Grice 1975 : 51) illustre une situation dans laquelle un locuteur communique un contenu implicite, puis cherche à nier avoir eu l’intention de transmettre ce contenu. Cette rétractation prend place juste après que le destinataire lui en attribue la responsabilité :
Paul : Sais-tu où Henry habite ?
Anne : Il habite quelque part dans le sud de la France.
→Anne ne sait pas exactement où Henry habite. (Contenu implicite)
Paul : Voyons ! Essaies-tu de me faire croire que tu ne connais pas son adresse !?! (Attribution d’engagement au locuteur)
Anne : Je n’ai jamais dit que je ne connaissais pas son adresse ! J’ai dit qu’il habite dans le sud de la France, mais si tu souhaites avoir son adresse exacte, je peux te la donner. (Rétractation du contenu attribué)
Dans le contexte ci-dessus, l’énoncé d’Anne semble vouloir dire qu’elle ne sait pas exactement où Henry habite. Ce contenu implicite est compris sur la base de l’hypothèse que, si Anne en savait davantage, elle l’aurait alors communiqué à Paul. Toutefois, lorsque Paul accuse Anne d’avoir prétendu ne pas savoir exactement où Henry habite (cf. Attribution d’engagement au locuteur), elle a la possibilité de nier avoir eu cette intention de communication en vertu du caractère implicite et annulable du contenu. Ainsi, Anne peut plausiblement nier le contenu implicite qui lui a été attribué (cf. Rétractation du contenu attribué).
Details
- Pages
- 166
- ISBN (PDF)
- 9783034349765
- ISBN (ePUB)
- 9783034349772
- ISBN (Softcover)
- 9783034349758
- DOI
- 10.3726/b22039
- Open Access
- CC-BY
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (September)
- Keywords
- théorie de la Pertinence implicatures implicites présuppositions explicatures rétractation engagement du locuteur manipulation Grice sophismes psychologie évolutive sémantique pragmatique pragmatique cognitive
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 166 p., 6 ill. n/b, 18 tabl.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG