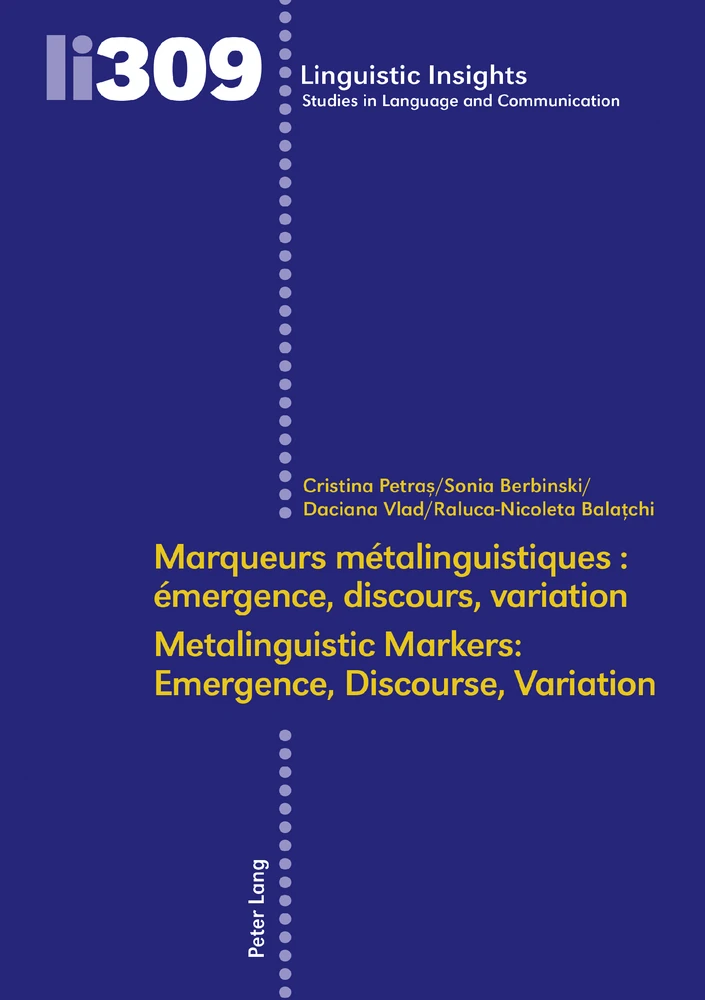Marqueurs métalinguistiques : émergence, discours, variation /Metalinguistic Markers: Emergence, Discourse, Variation
Résumé
Se réclamant de traditions théoriques et méthodologiques diverses (analyse du/des discours, approche du métadiscours, traductologie), les textes réunis dans ce volume interrogent les mécanismes d’émergence des marqueurs métalinguistiques (grammaticalisation, pragmaticalisation, cooptation, lexicalisation, constructionnalisation), leur fonctionnement sémantico-pragmatique dans différents types de discours général ou de spécialité, ainsi que leur rapport à la variation linguistique, à partir de corpus oraux et/ou écrits.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Liste des contributeurs
- Introduction
- I. Approches diachroniques/Diachronic Approaches
- Emplois et émergence des marqueurs d’approximation du français en tant que marqueurs méta-énonciatifs
- C’est dire : sur les traces de la formation d’un marqueur discursif
- From the financial to the metatextual: the emergence of discursive bottomline
- Étude des bridging contexts des marqueurs discursifs si j’ose dire et si je puis dire
- Le fonctionnement textuel des opérateurs de reformulation en moyen français et français préclassique
- À propos des emplois méta-énonciatifs et méta-discursifs du marqueur après à l’oral
- Les emplois discursifs de l’expression arabe chou essmou
- Genre, du nom au marqueur : parcours vers le métalinguistique
- II. Types de discours/Types of Discourse
- Les marqueurs de référence dans le discours juridique de l’environnement
- Marqueurs métalinguistiques dans l’article de recherche en sciences humaines en roumain
- Des marqueurs métalinguistiques en réunion de travail : des clés pour interagir
- Le marqueur adică dans le discours homilétique contemporain : focus sur l’espace chrétien orthodoxe
- Les marqueurs métalinguistiques de reformulation dans des textes médicaux scientifiques et grand public
- The Paraphrastic Rephrasing Markers altfel spus, mai exact, cu alte cuvinte, and mai pe scurt in Scholarly Publications in Romanian
- Métadiscours dans les applications de messagerie instantanée
- La variation diamésique dans les sous-titres intralinguaux et l’impact sur les marqueurs métalinguistiques
- III. Opérations métalinguistiques/Metalinguistic operations
- Pour ne pas le nommer et autres marqueurs métalinguistiques impliqués dans l’expression de la prétérition
- (Re)délimitation forcée du dire : analyse des emplois discursifs d’une forme verbale complexe exprimant la contrainte en russe
- Les marqueurs discursifs comme opérateurs de polyphonie dans le discours argumentatif. Le cas de d’accord et bien sûr
- Le marqueur de reformulation cu alte cuvinte en roumain actuel : entre fidélité et altération de la parole
- Greenwashing, flygskam, plogging, bore out : comment rendre transparents ces néologismes par emprunt en français ?
- Ko patati patata. Sur les traces d’un marqueur d’évaluation morale dans les interactions en français ordinaire ivoirien
- Grammaire et opérations méta-linguistiques : le concept de statut
- Une analyse métadiscursive. Quand la dénomination fait débat
- IV. Acquisition-apprentissage/Language learning-acquisition
- Boosters and Hedges as Metalinguistic Markers in Upper-Intermediate EFL Students’ Argumentative Essays
- Quel(s) usage(s) des marqueurs métalinguistiques dans le discours des enseignants débutants ?
- Les marqueurs de reformulation en français et leurs traductions en chinois dans une perspective didactique
- De quelques marqueurs métalinguistiques de reformulation en classe de langue étrangère
- V. Approches contrastives et traductologiques/Approaches in Contrastive Linguistics and Translation Studies
- The Communicative Process through the Lens of Metalinguistic Expressions: Italian direi ‘I would say’ and its Norwegian Correspondences
- Les marqueurs de reformulation dans le discours judiciaire : approche contrastive français-italien-roumain
- Reprises interprétatives et traduction littéraire : stratégie ou déformation ? C’est-à-dire et ses équivalents roumains dans La route des Flandres/ Drumul Flandrei de Claude Simon
- Le marqueur discursif évidemment et ses traductions en roumain et en slovaque
Cristina Petraș
Introduction
L’ouvrage collectif proposé découle des travaux du colloque Marqueurs métalinguistiques: émergence, discours, variation/Metalinguistic Markers : Emergence, Discourse, Variation, organisé les 8 et 9 juin 2022 à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, dans le cadre du projet de recherche « Les marqueurs métalinguistiques entre lexique, grammaire et discours. Approche diachronique »1.
Les recherches sur les marqueurs discursifs, en général, ont connu un extraordinaire essor ces dernières décennies, comme en témoignent les nombreux colloques, projets de recherche ou publications sur le sujet. Le présent ouvrage aborde les marqueurs discursifs dans leur dimension réflexive, en tant qu’ils renvoient aux activités métalinguistiques, indissociables du fonctionnement du langage. Connus aussi comme des marqueurs de glose (Steuckardt et Niklas-Salminen 2005), les marqueurs métalinguistiques ont été notamment traités par rapport à la modalisation autonymique ou en lien avec le verbe dire (Rouanne et Anscombre 2016, Anscombre et Rouanne 2020, Lansari 2020).
Les marqueurs métalinguistiques seront envisagés dans ce volume dans une acception large comme renvoyant aux différentes manifestations de cette propriété qu’est la réflexivité des langues naturelles, manifestée par des « non-coïncidences du dire » (Authier-Revuz 2012 [1995]). Dans l’analyse de productions langagières, c’est au niveau de l’actualisation, de l’énonciation, du métadiscours donc qu’il faut plutôt inscrire le propos. Il s’agira d’expressions portant sur le discours lui-même (métadiscursives) ou sur le « discours [dire] en train de se faire » (méta-énonciatives) (Authier-Revuz 2012, 2020). D’un autre point de vue, selon qu’on adopte une acception restreinte ou large du métadiscours, les expressions métadiscursives seront envisagées dans la seule dimension réflexive (« reflexive model », Ädel 2010 : 70) ou en plus, en tant qu’instruments de gestion de l’interaction comme chez Hyland (2005)2, dans un « interactive model » (Ädel 2010 : 70).
Les textes réunis dans ce volume interrogent les mécanismes d’émergence des marqueurs métalinguistiques (grammaticalisation, pragmaticalisation, cooptation, lexicalisation, constructionnalisation), leur fonctionnement sémantico-pragmatique dans différents types de discours (littéraire, scientifique, journalistique, didactique, juridique, religieux), ainsi que leur rapport à la variation (diamésie, diaphasie, diatopie), à partir de corpus oraux et/ou écrits. Certaines contributions concernent une langue particulière, d’autres proposent des approches contrastives et traductologiques impliquant deux ou plusieurs langues.
Portant sur des langues différentes (français, anglais, roumain, italien, portugais, arabe, chinois, norvégien, russe, slovaque, allemand, polonais), les trente-deux contributions (vingt-huit en français, quatre en anglais) ont été regroupées en cinq sections en fonction de leur visée principale, selon les axes suivants : approches diachroniques, types de discours, opérations métalinguistiques, acquisition-apprentissage, approches contrastives et traductologiques.
La variété des approches méthodologiques utilisées illustre la nécessaire complémentarité des points de vue dans l’étude des marqueurs métalinguistiques. Les types de données sur lesquelles s’appuient les différentes contributions sont aussi très différents : corpus d’interactions spontanées, d’interactions en classe de FLE, d’interactions par messagerie instantanée ; corpus écrits comportant des textes relevant de genres différents (littérature, presse, articles de recherche, écrits d’étudiants, textes de lois, sous-titres). Les analyses de corpus empruntent des instruments qualitatifs, mais aussi quantitatifs.
Les articles regroupés autour du premier axe (approches diachroniques) interrogent les mécanismes d’émergence des marqueurs. Le débat portant sur la manière la plus appropriée d’en rendre compte traverse ces textes. Si certains s’inscrivent d’emblée dans une tradition théorique ou une autre (pragmaticalisation chez Layal Kanaan-Caillol et Marie Skrovec ou chez Raoudha Toumi, grammaticalisation chez Guillaume Ciry et Jeanne Vigneron-Bosbach, constructionnalisation chez Mathilde Pinson, conventionnalisation chez Wiltrud Mihatsch), d’autres proposent leur propre réflexion sur la manière d’envisager ces mécanismes (Laurence Rouanne). D’autres, enfin, ne s’inscrivent pas dans une approche diachronique proprement dite, mais prennent comme objet un état de langue précis (moyen français et français préclassique chez Sabine Lehmann).
Travaillant sur le français à partir du corpus C-ORAL-Rom, Wiltrud Mihatsch rapporte les marqueurs d’approximation aux stratégies méta-énonciatives. Correspondant à des besoins communicatifs variés, la classe de ces marqueurs couvre tant les commentaires méta-énonciatifs qui viennent justifier les sélections lexicales problématiques, que les marqueurs qui portent sur l’activation des expressions. Il s’agit à la fois d’expressions provenant de substantifs taxinomiques (genre, espèce, sorte), que de marqueurs qui découlent de verbes du dire ou de structures phrastiques épistémiques, évidentielles, mais aussi de procédés clairement orientés vers l’interlocuteur (déictiques, incises, pronoms interrogatifs). L’article évoque la conventionnalisation et la grammaticalisation comme mécanismes d’émergence, le dernier se manifestant dans le cas des conventionnalisations très poussées.
Dans une perspective toujours diachronique, Laurence Rouanne retrace les étapes de pragmaticalisation et d’émergence du marqueur discursif c’est dire en tant que construction parenthétique/commentaire, à partir de son sens plein vers l’étape intermédiaire (valeur de reformulation ou de reformulation et intensification) jusqu’à la valeur de marqueur discursif, en position détachée. Une large typologie de discours est exploitée (blogs, forums, presse, littérature), à partir de ressources comme Sketch Engine, Google actualités et, pour une approche historique, Frantext. Cet article assume clairement le débat autour du type de mécanisme à l’œuvre dans l’émergence du marqueur, s’inscrivant dans le paradigme de la grammaticalisation. Selon cette auteure, la pragmaticalisation est l’étape ultime de la grammaticalisation, donc une étape et non un type de changement (comme dans la vision de ce que Heine et al. 2021 appellent « all grammaticalization »).
S’appuyant sur le corpus d’anglais contemporain COCA et sur le corpus historique d’anglais américain COHA, Mathilde Pinson décrit l’évolution de bottomline en anglais, à partir du nom utilisé dans la sphère financière vers la valeur de marqueur métatextuel, mobilisant les principes théoriques de la constructionnalisation. En tant que marqueur, bottomline prend des valeurs pragmatiques tout aussi différentes que celles associées à la focalisation, à la fermeture de thème, au résumé de thème, etc. L’approche pragmatique se double d’une analyse quantitative et d’une analyse de la courbe mélodique pour chaque étape de la constructionnalisation, qui montre des différences entre les emplois identifiés. Si bottomline est intégré dans la construction du type the N is (that) (the bottomline is that), cette unité se différencie dans son évolution d’autres noms du même paradigme, connaissant une évolution rapide vers l’emploi comme marqueur discursif, favorisée par le développement de la société et le recours par les concepteurs et les journalistes aux techniques propres au marketing.
Dans une même approche diachronique, Guillaume Ciry s’arrête sur un élément particulier dans le processus de grammaticalisation, telle qu’envisagée par C. Marchello-Nizia. Il s’agit de ce qu’on appelle bridging contexts ou contextes de transition des marqueurs discursifs si je puis dire et si j’ose dire là où une nouvelle signification apparaît dans un contexte positionnel nouveau. Grosso modo la question est de savoir si c’est l’évolution positionnelle qui déclenche l’apparition de différentes fonctions pragmatiques plus ou moins ambiguës, liées en général à l’atténuation, l’ambiguïté étant propre aux contextes de transition. À partir d’une analyse qui s’appuie sur Frantext, l’auteur arrive à la conclusion qu’au 20e siècle il se produit une désambiguïsation vers des valeurs de mise en relief des termes et des expressions ironiques, humoristiques ou de distanciation par le locuteur par rapport à un élément de l’énoncé. D’autres évolutions pourraient être envisagées au niveau du stade trois.
Sans proposer à proprement parler une approche des mécanismes de changement, l’article de Sabine Lehmann vise un état de langue (français moyen et préclassique) et essaie de rendre compte de l’apparition même de l’opération métalinguistique de reformulation. L’utilisation des opérateurs de reformulation, comme les appelle cette auteure, est liée à la diversification des types et des genres textuels et à l’apparition des textes explicatifs, argumentatifs, descriptifs, à la suite des progrès scientifiques et du travail de vulgarisation et partant de reformulation. Sont envisagés les différents types de marques de l’opération de reformulation, qui peuvent être placés sur un continuum de marquage : apposition, connecteurs de reformulation paraphrastique (c’est-à-dire, c’est à savoir) et non paraphrastique (en somme, brief).
Les données des deux corpus ESLO (1 et 2) permettent, grâce aux 40 ans qui les sépare, de documenter, dans l’article de Layal Kanaan-Caillol et Marie Skrovec, l’évolution des valeurs de après vers des emplois méta-énonciatifs et métadiscursifs, ce qui constitue un cas de pragmaticalisation. En témoignent des caractéristiques comme la recatégorisation et la complexification sémantique, qui se manifestent dans les emplois discursifs de après. La valeur de postériorité énonciative de ce marqueur s’est développée à partir de l’idée de postériorité temporelle et spatiale, présente dans ses emplois additifs et contrastifs. Dans l’analyse des valeurs plus ou moins pragmatiques de après sont prises en compte la différenciation diaphasique et l’influence du facteur générationnel. La démarche entreprise constitue tant une analyse en temps réel qu’une analyse en temps apparent.
L’exemple de l’expression arabe chou essmou ‘quel est son nom’ qui fait l’objet de l’article de Raoudha Toumi, est un cas inédit de pragmaticalisation. Au départ, cette expression, proche du français comment ça s’appelle, correspond à une question qui se rapporte à une dénomination. Sont identifiés deux types de fonctionnement de l’expression analysée, comme construction autonyme et comme marqueur discursif, et trois valeurs : de dénomination, phatique et marque d’un commentaire métalinguistique.
Jeanne Vigneron-Bosbach choisit elle aussi de comparer les deux corpus ESLO (1 et 2) pour analyser l’évolution des constructions de genre vers des emplois métalinguistiques. Si cette unité linguistique a déjà fait l’objet d’une série importante d’études, celle-ci a le mérite de mener un travail sur corpus, s’appuyant sur des données chiffrées, qui passe au crible toutes les expressions construites autour de genre et s’intéresse à la manière dont celles-ci ont évolué syntaxiquement et sémantiquement.
La deuxième série de textes choisissent un type de discours particulier : juridique (Sonia Berbinski, Corina Veleanu et Maria das Graças Rodriguez Soares), scientifique (Cristina Petraș, Ioana Buhnilă, Cristina Varga), professionnel (Carmen Alberdi, Virginie André et Carole Etienne), homilétique (Mihaela Lupu). La messagerie instantanée est retenue dans le travail d’Andreea Ioana Aelenei et les sous-titres dans l’article de Daniel Sebin.
L’étude de Sonia Berbinski, Corina Veleanu et Maria das Graças Rodriguez Soares propose une analyse comparative des marqueurs appelés par ces auteures « de référence » dans une directive européenne, en français, anglais, roumain et portugais, et, dans un deuxième temps, une comparaison avec des textes similiares issu du droit brésilien. Ce sont des marqueurs du type vu le / la, après consultation, statuant, considérant ce qui suit. Certains assurent la cohérence textuelle (endophoriques), d’autres renvoient à des éléments extérieurs au texte (exophoriques). Pour certains opérateurs, l’étude met en évidence les convergences comme les divergences entre les langues choisies.
Dans la perspective d’une analyse du métadiscours et du phénomène de hedging dans le discours scientifique en sciences humaines, sur un corpus d’articles de recherche, l’étude de Cristina Petraș montre des différences liées à la discipline concernant l’emploi des marqueurs (par exemple, un emploi plus important des marqueurs construits autour du verbe a numi ‘nommer’ en philosophie). L’article s’arrête aussi sur le fonctionnement de l’expression « trebuie ‘il faut’ + verbe de dire » comme connecteur concessif et comme marqueur discursif, des développements qui découlent de son emploi parenthétique. On remarque le riche éventail d’usages qu’en fait le discours scientifique, ainsi que certaines tendances, comme la préférence dans le domaine de l’histoire pour « trebuie + participe passé » aux dépens de « trebuie + subjonctif ».
Carmen Alberdi, Virginie André et Carole Etienne envisagent le contexte des interactions au travail dans une visée didactique. Les activités proposées par les auteures à travers la plateforme Interfare (qui comporte des échantillons d’interactions en réunion de travail) complètent le CECRL, contribuant à un meilleur enseignement-apprentissage des marqueurs discursifs dans ce genre de situation, grâce à l’approche des différentes étapes d’une telle interaction et des marqueurs discursifs qui y sont impliqués. Les marqueurs métalinguistiques sont ici compris dans un sens large comme relevant des mécanismes de gestion de la parole.
Mihaela Lupu retient un marqueur particulier du roumain, adică ‘c’est-à-dire’, par excellence associé avec la reformulation, pour en analyser les fonctions dans le discours homilétique : la fonction de reformulation paraphrastique, qui porte sur la dénomination, et celle de reformulation paraphrastique portant sur le sens. Ces fonctions du marqueur adică se manifestent également dans les discours à visée explicative, scientifique et didactique, dont le discours homilétique se rapproche.
Ioana Buhnilă propose une analyse des marqueurs métalinguistiques de la reformulation sous-phrastique médicale (est un/e, et autres, défini comme, appelé, signifie, c’est-à-dire) dans des résumés scientifiques et grand public en vue d’une application en TAL. Il s’agit de tester l’hypothèse du lien qui existe entre marqueurs métalinguistiques, relations lexicales et fonctions sémantico-pragmatiques des paraphrases, en vue de l’identification automatique des reformulations. Ce travail conduit à l’annotation des reformulations dans les deux types de textes (expert et non expert).
L’objet de l’article de Cristina Varga est le discours scientifique en roumain. Les marqueurs de la reformulation paraphrastique cu alte cuvinte ‘en d’autres mots’, altfel spus ‘autrement dit’, mai exact ‘plus exactement’ sont analysés du point de vue de leur position, de la relation entre séquence reformulée et séquence reformulante et du niveau d’équivalence entre les deux séquences. L’article conclut à l’idée qu’il existe une gamme variée de marqueurs métadiscursifs qui sont utilisés dans le discours scientifique en roumain. Utilisés dans différentes configurations, ils témoignent d’opérations de reformulation très complexes, propres à ce type de discours.
La messagerie instantanée offre une situation particulière, relevant tant du discours oral que du discours écrit. C’est un tel corpus, en roumain, qui est exploité par Andreea Ioana Aelenei pour l’analyse des marques métadiscursives, parmi lesquelles certaines communes avec d’autres types d’interaction (marqueurs discursifs comme voiam să zic că ‘je voulais dire que’, adică ‘c’est-à-dire’, gen ‘genre’, explications entre parenthèses, guillemets, reprise), d’autres liées à la situation de plurilinguisme (alternance codique) ou encore propres à ce type particulier de communication (stratégies métadiscursives liées aux conditions techniques liées à ce type de discours). L’auteure avance l’idée de la conception virtuelle du métadiscours, qui rend compte du fonctionnement de celui-ci dans cette situation particulière qui n’est ni de l’oral ni de l’écrit.
À partir d’un corpus de sous-titres intra-linguaux de films français et allemands, l’article de Daniel Sebin analyse les choix faits par les sous-titreurs concernant le maintien ou l’élimination des marqueurs métalinguistiques) et partant l’impact de la variation diamésique sur les sous-titres. Dans le corpus envisagé, l’auteur remarque plutôt l’absence de ces marqueurs, du fait des contraintes qui déterminent la création des sous-titres (conditions techniques, surcharge cognitive chez le sous-titreur, surcharge cognitive projetée chez le spectateur).
Les articles regroupés dans la troisième section envisagent les marqueurs métalinguistiques plutôt du point de vue des opérations effectuées : commentaire métadiscursif (Maxime Warnier et Daciana Vlad ; Bastien Poreau ; Oumarou Boukari et Adama Drabo), modalisation (Irina Ghidali), reformulation (Alice Ionescu et Cecilia-Mihaela Popescu), glose (Aïno Niklas-Salminen). La prise en compte des opérations métalinguistiques abstraites dans la grammaire fait l’objet du travail de Jean-Pierre Gabilan, alors que Gilles Gauthier s’arrête sur les interventions métadiscursives auxquelles donne lieu l’opération de dénomination.
L’article de Maxime Warnier et Daciana Vlad porte sur une série de marqueurs qui contribuent à l’expression de la prétérition, comme pour ne pas le nommer. Ils en analysent les configurations syntaxiques, ainsi que les valeurs sémantico-pragmatiques et les degrés de figement. Certaines de ces expressions sont d’un usage assez fréquent, car produisant des effets de sens très divers en contexte (emphase, évidence, atténuation et déresponsabilisation du locuteur).
La contribution de Bastien Poreau montre de quelle manière le prédicat modal à valeur déontique prijitis’/prihoditsja ‘être obligé / contraint de’ en russe en vient à exprimer, en combinaison avec un verbe de dire, des valeurs métadiscursives (commenter ou introduire son propre discours). Il s’agit de formes contraintes, figées. Dans les phrases affirmatives, la structure composée du présent imperfectif prihoditsja suivi d’un verbe de dire à l’infinitif perfectif et signifiant « force est de constater que » contribue à l’expression des actes performatifs, mais ceci d’une manière particulière : le locuteur se présente comme étant contraint par les circonstances d’avancer son dire. Dans les phrases négatives, la structure formée du présent imperfectif ne prihoditsja accompagné du verbe de dire à l’infinitif imperfectif (« il est hors de question de » ; souvent l’infinitif précède ne prihoditsja) permet au locuteur de commenter son propre discours. Cette fois-ci le jugement négatif par rapport à la situation envisagée s’impose de lui-même, la conclusion découlant nécessairement du contexte gauche, là où les attentes auraient pu être différentes.
Les marqueurs envisagés par Irina Ghidali peuvent être considérés comme métalinguistiques si l’on adopte l’acception large du terme métalinguistique (se rapportant à la gestion de la relation interpersonnelle). D’accord et bien sûr sont analysés non en tant que marqueurs du consentement, mais en tant que déclencheurs des phénomènes de polyphonie. Travaillant sur des corpus oraux et des corpus écrits, l’auteure traite des deux marqueurs dans leur triple emploi – modalisateurs, marqueurs de cohésion discursive et instruments de la stratégie argumentative –, en rapport avec le contexte proche et le type de discours.
Le marqueur cu alte cuvinte ‘en d’autres termes’ est analysé par Alice Ionescu et Cecilia-Mihaela Popescu à travers différents types de discours. Caractérisant notamment la langue littéraire, ce marqueur de date récente semble un calque partiel sur l’italien in altre parole. Cependant, du point de vue du fonctionnement (comme marqueur de reformulation et comme marqueur de reprise polémique), cu alte cuvinte est proche du français en d’autres termes et de l’anglais in other words. Les attestations du 19e et du 20e siècles indiquent plutôt une influence française. Les fonctions des reformulations introduites par cu alte cuvinte sont de natures diverses – cognitive (expliquer, préciser, corriger), argumentative (la dimension informative est remplacée par la fonction polémique), pragmatique (dénomination, précision, explicitation, exemplification) –, dépendant aussi du caractère monolocutif ou interlocutif du discours.
L’article d’Aïno Niklas-Salminen interroge, à partir d’un corpus d’internet, les gloses qui accompagnent une série d’emprunts en français : les anglais greenwashing et bore out, les suédois flygskam et plogging. Les gloses servent à en clarifier le sens, à donner des informations sur la réalité à laquelle se réfère l’emprunt, à rendre les attitudes du locuteur envers la langue et la culture étrangère l’ayant fourni. Sont analysées les caractéristiques syntaxiques, sémantiques et discursives des gloses.
Comme le montrent Oumarou Boukari et Adama Drabo, le transfert d’une unité linguistique d’une langue à une autre peut conduire à des changements par rapport à la langue d’origine. C’est le cas du marqueur ko repris en français ivoirien des langues mandingues, plus spécifiquement le dioula (où la particule dérive du verbe ko ‘dire’), qui est analysé à partir d’un corpus d’interactions verbales. Précédant un discours rapporté, ce marqueur multifonctionnel subit une spécialisation et marque l’évaluation et/ou la distanciation morale, dans les termes de ces auteurs, valeur qui n’existait pas en dioula. En utilisant ce marqueur, le locuteur indique qu’il rejette la pertinence d’un énoncé antérieur qu’il évalue pourtant en l’introduisant dans son discours comme discours rapporté ou en le reprenant tout simplement.
L’article de Jean-Pierre Gabilan propose une réflexion sur le principe métalinguistique de statut en grammaire. La grammaire d’une langue doit être décrite comme un véritable système, dans lequel il se manifeste des oppositions, qui traduisent en fait des opérations abstraites métalinguistiques. S’inscrivant dans le cadre théorique de la grammaire méta-opérationnelle, l’article montre que c’est le concept de statut qui rend compte des oppositions – observées dans les différentes langues, par exemple, en français, entre un / le, une / la, voici / voilà, à / de, passé simple / imparfait.
Comme il est indiqué dès le titre de l’article de Gilles Gauthier, la dénomination d’un fait ou d’un événement peut donner lieu à des débats, ce qui conduit à des interventions métadiscursives. Le débat autour des dénominations données à la découverte de tombes d’enfants autochtones dans la proximité des pensionnats indiens nourrit la réflexion sur le rapport entre discours et réalité. Les deux points de vue différents exprimés correspondent à deux types de dénomination : dénomination par qualification de la réalité, dénomination par extension conceptuelle. Deux types de désaccords se dessinent, à partir de deux acceptions du terme génocide : un désaccord sémantique dans la direction esprit/langage-monde (peut-on appliquer ce terme à la situation décrite et la décrire en fonction des caractéristiques reconnues du génocide ?), un désaccord factuel dans la direction monde-esprit/langage, qui met face à face des positions concernant le fait même de considérer que la réalité décrite illustre le concept de génocide.
La quatrième section du volume interroge le rapport entre marqueurs métalinguistiques et la situation d’acquisition-apprentissage, qu’il s’agisse des productions langagières des apprenants (Oleksandr Kapranov), du discours de l’enseignant (Céline Corteel ; Luminiţa Steriu, Monica Vlad, Elisabeta Ana Iuliana Linea), ou bien de la mise à la disposition des étudiants d’instruments informatiques (Jingrao Li, Yujing Ji, Rui Yan).
Oleksandr Kapranov propose une analyse quantitative de l’utilisation des atténuateurs et des intensificateurs dans les travaux d’étudiants en anglais langue étrangère de niveau B2. May s’avère l’atténuateur le plus fréquent, alors que will est l’intensificateur le plus employé. Ces usages ne varient pas de façon significative entre le semestre d’automne et le semestre de printemps. Les enjeux didactiques concernent la nécessité de travailler les marqueurs métalinguistiques dans la perspective de l’adéquation aux genres.
C’est le discours didactique qui est au centre des préoccupations de Céline Corteel, qui arrive à la conclusion d’un usage réduit des marqueurs métalinguistiques par les enseignants débutants. Dans la situation d’un discours explicatif sur la langue peu développée, en l’absence donc d’un discours métalinguistique, ceux-ci s’appuient par contre dans leur discours sur des pratiques discursives routinisées, qui ont plutôt une valeur métalinguistique implicite.
L’article de Jingrao Li, Yujing Ji, Rui Yan propose une approche des marques de reformulation dans le discours scientifique en français et leur traduction en chinois en vue de la création d’un instrument informatique d’aide aux étudiants de langue maternelle chinoise. Ceci s’avère nécessaire dans les conditions où les études ont mis en évidence les difficultés que rencontrent les étudiants dans leurs productions écrites. L’accès à la ressource lexicale se fera de deux manières : par la fonction discursive du marqueur et par l’équivalent en chinois.
Luminiţa Steriu, Monica Vlad, Elisabeta Ana Iuliana Linea s’arrêtent, comme Céline Corteel, sur le discours didactique, mais cette fois dans le cadre des classes de grammaire de FLE. C’est une situation particulière vu que la reformulation se produit dans un discours qui a pour objet la métalangue grammaticale. L’étude aboutit à la conclusion que les marqueurs de reformulation (considérés comme des routines discursives), qui apparaissent tant dans le discours unilingue que dans les alternances codiques, jouent un rôle important dans les discours des enseignants, étant un élément crucial dans l’explication grammaticale.
Les articles regroupés dans la dernière partie du volume proposent une approche contrastive et traductologique des marqueurs métalinguistiques dans deux/plusieurs langues. Trois articles portent sur la traduction du discours littéraire (Elizaveta Khachaturyan, Raluca- Nicoleta Balațchi, Lucia Ráčková) et le quatrième sur la traduction d’un texte spécialisé (Chiara Preite et Daniela Dincă).
La comparaison entre le marquer italien direi et ses équivalents en norvégien, tels qu’ils se présentent dans les traductions littéraires, permet à Elizaveta Khachaturyan de mettre en évidence les différences entre les deux langues. Les divers éléments du processus de communication (se rapportant au locuteur, au monde, à l’interlocuteur) sont différemment envisagés dans les deux langues. Ainsi direi accompagne une dénomination proposée par le locuteur en rapport avec la représentation qu’il a du monde – une dénomination parmi d’autres disponibles. En norvégien ce n’est pas un verbe de dire qui est utilisé, mais c’est un autre aspect de la communication qui est retenu : certaines expressions se rapportent au point de vue du locuteur (jeg tror ‘je pense’), d’autres portent sur les mots, indépendamment du locuteur et de l’interlocuteur (slags ‘sorte’).
Les marqueurs de reformulation sont envisagés par Chiara Preite et Daniela Dincă dans un corpus d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne en français et dans leurs traductions en italien et en roumain. Trois catégories de marqueurs de reformulation sont identifiées : des marqueurs d’inclusion ou d’appartenance, marqueurs qui établissent une équivalence, marqueurs d’exemplification explicative. Pour ce qui est de l’aspect plus spécifiquement contrastif, quelques tendances ont pu être identifiées dans les traductions. Ainsi, l’italien présente une gamme plus variée de marqueurs de reformulation tant par rapport au français que par rapport au roumain. Dans la traduction en roumain on remarque une élimination des formes littéraires ou familières pour garder le caractère technique du texte juridique. D’autres cas de figure concernent l’effacement de certains marqueurs ou bien la traduction par un marqueur qui a une valeur différente par rapport au texte français.
Le texte de Raluca-Nicoleta Balațchi propose une analyse des stratégies de traduction du marqueur c’est-à-dire dans la version roumaine du roman La route des Flandres de Claude Simon pour voir dans quelle mesure telle stratégie influe ou non sur le processus de reformulation lui-même dans la langue cible. La traduction se situe entre deux mouvements différents. D’une part, des effets supplémentaires surgissent dans la langue cible. D’autre part, l’omission du marqueur dans certaines situations vient en quelque sorte effacer l’opération même de reformulation dans une « stratégie d’implicitation », mais qui, selon l’auteure, transforme en langue cible l’esprit du texte simonien, qui justement s’appuie sur cette présence extraordinaire de c’est-à-dire.
Résumé des informations
- Pages
- 758
- Année de publication
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783034349161
- ISBN (ePUB)
- 9783034349178
- ISBN (Relié)
- 9783034349086
- DOI
- 10.3726/b21750
- Langue
- français
- Date de parution
- 2024 (Septembre)
- Mots clés
- marqueurs métalinguistiques variation grammaticalisation pragmaticalisation lexicalisation métadiscours reformulation approximation modalisation approche diachronique perspective traductologique acquisition apprentissage
- Publié
- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2024. x, 758 p., 49 ill n/b., 21 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG