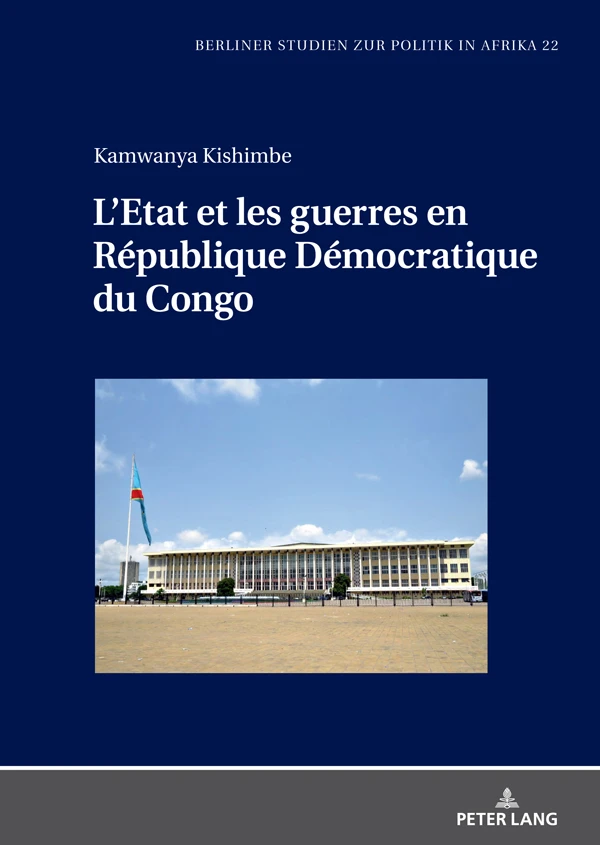L’Etat et les guerres en République Démocratique du Congo
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Dédicace
- Table des matières
- Préface de l’éditeur
- Remerciements
- Liste des figures
- Liste des abréviations
- Chronologie
- Carte administrative de la RDC avec ses pays voisins
- Introduction : Méthodes, Approche et présentation des principaux arguments
- 1. Méthodes et hypothèse
- 2. Légitimité de l’approche institutionnelle
- 3. Structure et présentation des principaux arguments
- Chapitre I : Brève présentation philosophique du concept de guerre et de paix
- 1. De l’état de nature à l’Etat
- 2. De la propriété universelle à l’accaparement des terres
- 3. La guerre comme poursuite de la politique par d’autres moyens
- 4. Guerre et mondialisation
- 5. Les Etats et l’exigence de la paix perpétuelle
- 6. En guise de conclusion
- Chapitre II : Les guerres nouvelles selon Kaldor
- 1. La nouveauté des guerres actuelles
- 2. Les guerres nouvelles et la globalisation
- 3. Objectif des guerres nouvelles
- 4. Eléments structurels des guerres nouvelles
- a) Fragilité étatique comme pépinière de la guerre
- b) Acteurs des guerres nouvelles
- c) Stratégie des guerres nouvelles
- d) Financement des guerres nouvelles
- 5. Précision de la transformation de la nature de la guerre
- 6. Conséquences régionales des guerres nouvelles
- 7. En guise de conclusion
- Chapitre III : Les guerres nouvelles selon Münkler
- 1. Une diversité de guerres
- 2. Les enfants soldats
- 3. Facteurs favorisant l’émergence des guerres nouvelles
- a) Violence sur les ruines d’anciens empires
- b) Etats en faillite, théâtre des guerres nouvelles
- 4. Conditions structurelles d’émergence de la force privatisée selon Mair
- a) L’économie de la rente et la théorie libérale
- b) Modernisation sociale sans développement socioéconomique
- c) Conflit entre tradition et modernité
- d) Faillite étatique et répression politique
- 5. Caractéristiques des guerres nouvelles
- a) Privatisation, commercialisation et asymétrie
- b) Installation d’une économie de guerre
- c) Processus de paix
- d) Personnalités charismatiques dans la guerre
- 6. Rupture de la dynamique des Etats modernes
- a) Fixation des frontières reconnues internationalement
- b) La distinction claire entre état de paix et état de guerre
- c) Identification de l’ami et de l’ennemi
- d) La distinction entre combattants et non-combattants
- e) Distinction entre usage permis de la force et crime de guerre
- f) Distinction entre recours à la force et activité professionnelle
- 7. « Les guerres nouvelles » sont-elles vraiment nouvelles ?
- 8. En guise de conclusion
- Chapitre IV : La rébellion par avidité selon Collier
- 1. Une définition de la rébellion entre protestation et crime organisé
- 2. La rébellion par grief
- 3. La rébellion par avidité
- a) La contrainte de survie
- b) Les matières premières
- c) L’avantage militaire
- d) Coût de recrutement de combattants
- 4. Interaction entre avidité et grief
- 5. Appréciation critique du modèle CH
- 6. Dépassement de la disjonction grief ou avidité
- 7. En guise de conclusion
- Chapitre V : Les conflits intercommunautaires selon Autesserre
- 1. Interprétation inadéquate des conflits de la RDC
- 2. Solutions inappropriées pour la stabilisation de la RDC
- 3. La théorie de la guerre des ressources et ses conséquences
- 4. La signification des conflits intercommunautaires dans l’instabilité de la RDC
- 5. Les acteurs locaux et leurs agendas
- 6. Restitution des conflits intercommunautaires dans l’histoire de la RDC
- 7. En guise de conclusion
- Chapitre VI : Les conflits régionaux selon Prunier
- 1. Lien entre le génocide rwandais et le Kivu
- 2. La cleptocratie du régime de Mobutu
- 3. Les réfugiés rwandais dans le Zaïre de Mobutu
- 4. La complexité de la situation du Kivu
- 5. La première guerre du Congo
- 6. Les conflits régionaux dans le bassin du Congo
- a) Les intrus officiels
- b) Les intrus non officiels
- 7. La seconde guerre du Congo
- 8. Appréciation critique
- 9. En guise de conclusion
- Chapitre VII : Plus de deux décennies de guerres et leurs interprétations
- 1. Des guerres nouvelles au centre de l’Afrique
- 2. Conflits pour les ressources
- 3. Les conflits au niveau local
- 4. Le niveau régional du conflit
- 5. Faillite de l’Etat congolais
- 6. En guise de conclusion
- Chapitre VIII : Reformes politiques
- 1. Consolidation de la paix
- 2. Réforme du système de sécurité
- 3. La décentralisation
- a) Généralités
- b) La mise en place de la décentralisation en RDC
- c) Les écueils de la décentralisation en RDC
- d) Recommandations pour une décentralisation réussie
- 4. La forme de gouvernement
- 5. L’Etat de droit
- 6. En guise de conclusion
- Chapitre IX : Réformes économiques
- 1. L’importance des institutions pour le développement
- 2. Plan National Stratégique de Développement
- 3. La gouvernance du secteur extractif
- 4. Transformation structurelle de l’économie congolaise
- 5. Priorité et bonne gouvernance du secteur agricole
- 6. En guise de conclusion
- Chapitre X : Pacification de l’Est de la RDC
- 1. La complexité des causes de l’instabilité de l’Est de la RDC
- 2. La restauration du monopole étatique de la force
- 3. L’identité ethnique
- 4. La question foncière
- 5. En guise de conclusion
- Intérêt philosophique de l’approche institutionnelle: la paix et les institutions dans les secteurs politique et économique
- Conclusion
- Bibliographie
- Sites internet
- Titres de la collection
Préface de l’éditeur
Les mérites de cette étude sont nombreux et ils seront découverts par les lecteurs au fur et à mesure que leur lecture les conduira à travers les chapitres de ce travail de recherche excellement structuré et amplement étoffé par des connaissances approfondies du cadre de référence théorique ainsi que de la matière de l’analyse empirique.
L’auteur a mis de l’ordre dans la pléthore des théories du conflit, utilisées pour l’explication de ces guerres permanentes à l’Est de la République démocratique du Congo qui ont dévasté le pays au cours des dernières trois décennies. Il a méticuleusement inventorié ces théories et les a rendues compréhensibles à un grand cercle de lecteurs, ceux qui ne sont pas familiers avec le langage des débats théoriques aiguisés inclus. Mais il est allé au-delà de cet effort louable pour contribuer à l’avancement de l’analyse scientifique de l’énigme de l’échec de toutes tenta-tives de pacifier cette région, moyennant des stratégies basées sur ces théories, en démontrant l’utilité réduite de celles-ci, en tant qu’approches unidimensionnelle, en vue de saisir la complexité socio-économique et politique des conflits qui déchirent la RDC.
Partant de cette critique, il a procédé à utiliser ces théories de manière complémentaire en mettant en exergue la nature structurelle de ces conflits et le rôle de l’État, devenu dysfonctionnel, dont la défaillance conditionne la perpétuité des conflits. L’importance de son diagnostic, basé sur son hypothèse de travail et justifié par des vastes recherches empiriques et historiques, de l’État comme source de tous les malheurs infligés au Congo depuis son avènement à l’indépendance, réside dans le fait qu’il lui a permit de proposer toute une série de mesures pour réformer l’État et sortir la RDC du cercle vicieux des conflits et de la dégradation des conditions de vie de la population. Ces mesures, même en semblant être utopistes parce que l’auteur n’a pas indiqué les acteurs censés les mettre en œuvre, ni les conditions sous lesquelles la mise en œuvre devrait être effectuée, constituent sans doute une importante feuille de route pour les futures recherches sur cette thématique.
Cela dit, il convient de mentionner qu’il s’ajoute aux mérites de cette étude, un mérite indirect considérable : celui de susciter une dynamisation des recherches sur le cas du Congo hors du cadre théorique contraignant des approches de recherche sur cette thématique, en vigueur depuis les années 90 du dernier siècle, dont les déficits ont été signalés par l’auteur.
Il a réussi, avec son analyse du rôle de l’État, en tant que vraie cause des maux qui minent le Congo, à tracer une voie pour les futures recherches vers une confrontation plus approfondie avec le sujet de la guerre en RDC, laquelle inclurait d’autres facteurs déterminant le déroulement de son histoire et de son avenir que les facteurs conventionnels, signalés par les interprétations réductionnistes de cette guerre, comme ayant uniquement des motifs locaux ou liés à l’exploitation illégale de ses richesses. En identifiant le rôle de l’État dans la « mêlée congolaise » et en ayant appelé ainsi à rehausser le niveau de complexité des analyses du cas du Congo dans le domaine des recherches sur la paix et les conflits, il a, par ricochet, attiré l’attention des futurs chercheurs à deux lacunes des recherches sur cette thématique, à savoir : le manque de prise en considération du fait que l’État congolais est soumis à l’impact des facteurs de pression externes qui l’ont transformé en état vassale, incapable de se réformer et de sortir le pays du statu quo, lui imposé par les rapports des forces au niveau international, et la déconsidération du narrative critique sur le cas du Congo lequel est nécessaire comme source d’information complémentaire essentielle pour comprendre ce qui se passe en RDC.
C’est en espérant que cette étude sera utile pour approfondir le savoir du Congo et pour susciter un débat plus diversifié et inclusif sur ce pays que le débat qui a eu lieu ces dernières années que nous vous en souhaitons bonne lecture.
Salua Nour
Université libre de Berlin 20 avril 2024
Remerciements
Mes sincères remerciements s’adressent aux trois professeurs, membres du comité d’encadrement de ma thèse. De manière spéciale, je remercie cordialement le professeur Dr. Dr. Gerhard Droesser qui n’avait pas hésité un seul instant à assumer la responsabilité de premier directeur de ce travail. Ses orientations et ses recommandations ont constamment guidé ce travail jusqu’à son aboutissement. Je remercie également les deux seconds directeurs : le professeur Dr. Wolfgang Schröder pour ses remarques et ses recommandations qui m’ont permis de préciser mon enquête. Enfin et surtout, je remercie le professeur Dr. Jörn Müller pour la promptitude avec laquelle il avait accepté d’accompagner ce travail.
Chronologie
Entre le XIVe et le début du XXe siècle, le territoire autour du bassin du Congo fut politiquement structuré par un certain nombre de royaumes dont les plus importants étaient le Royaume Kongo, le Royaume Luba, le Royaume Lunda et le Royaume Tchokwe.
1885 : La conférence de Berlin attribua l’actuel territoire de la République Démocratique du Congo au roi des Belges Léopold II à titre de propriété privé. Ce territoire fut baptisé EIC, Etat Indépendant du Congo.
1885–1908 : L’EIC. Suite aux cruautés perpétrées par Léopold II et aux protestations qu’elles portèrent au jour, le monarque belge fut dépossédé de son domaine au profit du Royaume de Belgique.
1908–60 : Le Congo belge. La colonisation du Congo par le Royaume de Belgique.
1937 : Création de la MIB, Mission d’Immigration des Banyarwanda, par l’administration coloniale dans le but de baisser le nombre d’habitants du Rwanda densément peuplé. Pendant ses dix-huit ans d’existence, cette mission installa plus de 85.000 Rwandophones au Congo.
1960 (30 juin): Indépendance du Congo. A plusieurs égards, l’indépendance du Congo fut un mauvais départ. D’un point de vue institutionnel, le Congo fut doté d’une pseudo- constitution, germe des conflits entre les membres de l’exécutif (président et premier ministre). Au niveau politique, les partis politiques qui émergèrent à l’indépendance n’avaient de partis politiques que les noms. En effet, il s’agissait de mouvements tribaux crispés sur des appartenances identitaires locales. Dans ce contexte, Lumumba, le premier ministre, fut un personnage exceptionnel avec son discours nationaliste et antiimpérialiste. Du point de vue social, la colonisation de style paternaliste n’avait pas favorisé l’émergence des cadres locaux. Forcés de quitter précipitamment le pays par le mouvement des indépendances en Afrique, les Belges laissèrent la gestion du Congo dans les mains des dirigeants sous-qualifiés et incompétents. En outre, il n’existait aucune société civile dans ce pays, la seule organisation fonctionnelle était l’armée. Ceci explique aussi le développement ultérieur qui porta Mobutu au pouvoir. La période postcoloniale, caractérisée par l’instabilité politique et sécuritaire, fut marquée par la sécession des provinces minières du Katanga et du Kasaï et culmina dans l’assassinat du premier ministre Patrice Lumumba.
1961 (17 janvier) : Assassinat du premier ministre et principal artisan de l’indépendance du Congo, Patrice Lumumba.
1965–97 : Putsch de Mobutu et trente-deux ans de dictature. Soucieux de s’offrir une présidence à vie, Mobutu supprima le multipartisme et installa un parti unique sur lequel il régna en chef absolu. Sur le plan économique, la fixation sur le secteur minier ainsi que sa mauvaise gestion rendirent l’économie dépendante des provinces minières et détruisirent progressivement les autres secteurs économiques. A côté de la dépendance vis-à-vis du secteur extractif, la plus grande erreur du mobutisme fut l’expropriation et la nationalisation des entreprises privées qui eurent comme conséquence l’effondrement de la production. L’autoritarisme et la mauvaise gestion portèrent au jour une opposition politique pacifique et différentes rébellions armées.
Les années 1970 : Dans le contexte de la guerre froide, l’arrivée au pouvoir de Mobutu, orchestrée par la Belgique et les USA dans la décennie précédente, fut saluée par les Occidentaux qui étaient suspicieux vis-à-vis de Lumumba soupçonné d’être en connivence avec les communistes. Cependant, Mobutu initia une politique dite d’authenticité adossée à une redécouverte de la culture africaine. Celle-ci interdit aux Congolais le port des prénoms occidentaux. En 1971, Mobutu baptisa le Congo comme Zaïre. Cependant, les conséquences les plus abjectes de cette politique sont à situer au niveau économique. Alors que le secteur économique était dominé par les entreprises belges, Mobutu initia un processus visant à reprendre le contrôle de l’économie. Dans ce contexte, il commença par le processus de nationalisation de l’Union minière, la principale entreprise minière belge exploitant les mines du Haut-Katanga en décembre 1966. Cette première étape fut suivie par la confiscation et la nationalisation d’une série d’entreprises privées dans la décennie 1970 dans le cadre du programme de zaïrianisation. La mauvaise gestion caractéristique des entreprises ainsi nationalisées et confiées aux Mobutistes causa l’effondrement de la production et fut le début d’une crise économique sans précédent et d’une inflation exponentielle qui atteignirent leur sommet dans la décennie 1990.
1978–88 : Programme d’ajustement structurel. La profondeur de la crise dans laquelle Mobutu avait plongé son Zaïre contraint celui-ci à se soumettre au programme d’ajustement structurel du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale. L’esprit de ce programme était aux antipodes de la Zaïrianisation. D’inspiration libérale, il préconisait notamment la limitation de l’activité étatique aux domaines régaliens, la privatisation des entreprises publiques, la diminution des dépenses publiques, la dérégulation et l’ouverture des marchés. Crispé sur l’amélioration des indicateurs macroéconomiques sans se préoccuper des impacts sociaux de cette thérapie, ce programme ne fut pas couronné de succès ; chaque étape de son application exacerba les tensions sociales. Celles-ci aboutirent aux pillages des magasins et sites industriels initiés par les militaires en septembre 1991.
1988–97 : Effondrement de l’économie.
1996 (octobre) – 1997 (mai) : Première guerre du Congo.
1998 (août) – 2003 (juillet) : Deuxième guerre du Congo.
2001(16 janvier) : Assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Celui-ci fut remplacé par son fils Joseph Kabila.
2002 (16 décembre) : Signature de l’ « accord global et inclusif » entre la RDC et les pays et groupes armés engagés dans la deuxième guerre du Congo à Pretoria en vue de mettre fin à celle-ci. Cet accord fut précédé par le cessez-le-feu de Lusaka du 10 juillet 1999. Il fut le point de départ de la période de transition pendant laquelle la RDC fut dirigée par le gouvernement « 1 plus 4 » (président Joseph Kabila avec quatre vice-présidents représentants des rébellions).
Details
- Pages
- 296
- Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631916834
- ISBN (ePUB)
- 9783631916841
- ISBN (Hardcover)
- 9783631916827
- DOI
- 10.3726/b21692
- Language
- French
- Publication date
- 2024 (June)
- Keywords
- Recherche sur la paix consolidation de la paix Région des Grands lacs analyse institutionnelle République Démocratique du Congo
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2024. 296 p., 5 ill. n/b.