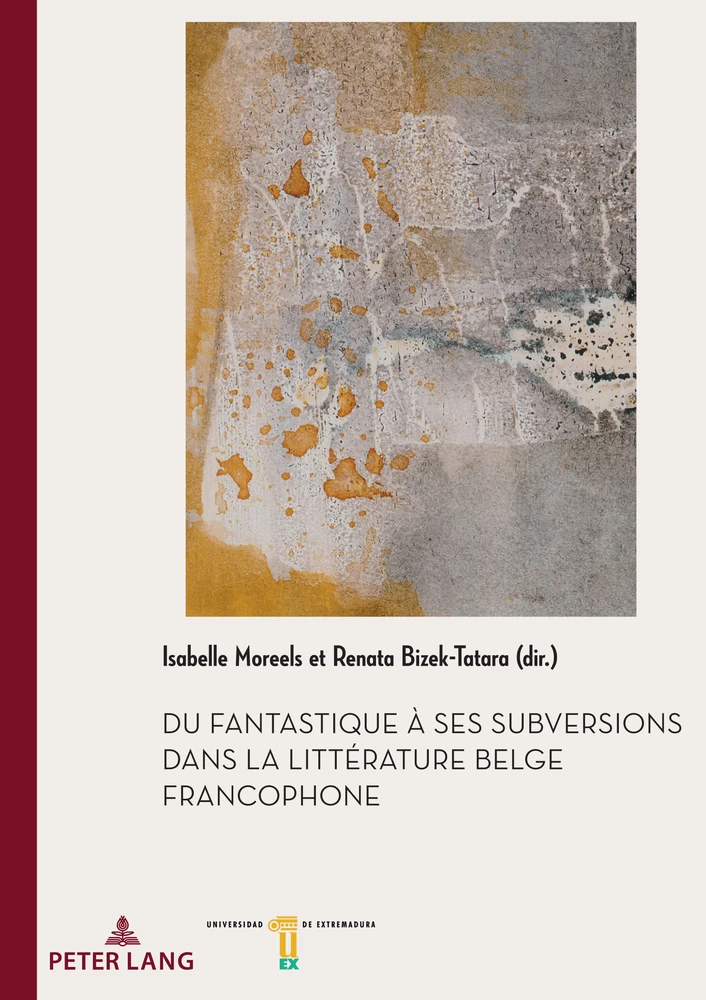Du fantastique à ses subversions dans la littérature belge francophone
Summary
Issus d’un éventail d’universités européennes, dix-sept chercheurs proposent des études qui s’attachent aux formes de distanciation vis-à-vis des canons vrais ou supposés du fantastique. Et ce, par le biais de l’humour, de l’ironie, voire de la parodie.
Ces subversions concernent les « fantastiqueurs » les plus emblématiques (M. de Ghelderode, T. Owen, J. Sternberg, G. Compère, A. Richter), ainsi que des écrivains à (re)découvrir (M. et H. Nizet, M. Carême, M.-T. Bodart, M. Mariën, J. Harpman, C. Haumont) ; des nouvellistes et romanciers tout à fait contemporains (B. Quiriny, C. Gérard, A. Wauters) ; des auteures qui affirment de plus en plus leur empreinte féminine (F. Richter, C. Barreau, J. Deneff e, C. Valentiny).
Avec en filigrane les figures tutélaires de J. Ray, F. Hellens et J. Muno, le lecteur se déplace de récits vampiriques des origines à des fictions postapocalyptiques. Le guident notamment d’éminents spécialistes internationaux de la littérature fantastique comme J.-B. Baronian, J. Finné, J. Marigny, É. Lysøe et M. Lits.
Pour sa part, M. Quaghebeur balise le discours critique des quarante dernières années, relatif au versant belge de l’écriture de l’étrange. De la sorte, il ancre cet ouvrage dans sa volonté d’ouvrir une nouvelle étape de la recherche : la saisie des sens et des mécanismes des subversions du fantastique. Cela concerne l’esthétique ainsi que le langage, mais aussi notre vision du monde bien réel.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos des directeurs de la publication
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Remerciements
- Présentation. Lorsque le fantastique joue la carte de la subversion (Isabelle Moreels et Renata Bizek-Tatara)
- Avant-propos (Jean-Baptiste Baronian)
- Quatre décennies d’approches du fantastique belge (Marc Quaghebeur)
- Vampires à la belge ou un bel amour à sens unique : « Je t’aime, moi non plus… » (Jacques Finné et Jean Marigny)
- Rire et sarcasme chez Michel de Ghelderode. Une distanciation de l’effroi (Éric Lysøe)
- Le jeu avec le fantastique de Maurice Carême (Renata Bizek-Tatara)
- La subversion dans la langue. Configurations discursives du fantastique dans « Le tissu compétitif » de Thomas Owen (Fernando Funari)
- La subversion sur une note humoristique dans Les Fantômes du château de cartes de Marcel Mariën (Aleksandra Komandera)
- Contes glacés de Jacques Sternberg ou la perversion du fantastique à travers des micro-récits (Estrella de la Torre Giménez)
- Le fantastique de Gaston Compère : où une ironie distanciée masque l’angoisse existentielle (Marc Lits)
- Gaston Compère et In Dracula memoriam, un feu d’artifice burlesque (Jacques Finné)
- Aux racines de l’enfance : l’univers étrange de Claude Haumont (Vincent Radermecker)
- L’humour dans le fantastique postmoderne : les nouvelles de Bernard Quiriny (Inmaculada Illanes Ortega)
- Figural et subversion dans Contes carnivores de Bernard Quiriny (Andrei Lazar)
- Aux marges du fantastique : l’imaginaire grinçant du roman postapocalyptique (Laurence Boudart)
- Un fantastique, belge et contemporain, au féminin ? Une étude de trois romans (2020) de Catherine Barreau, Jennifer Deneffe et Caroline Valentiny (Catherine Gravet)
- Marie-Thérèse Bodart, Anne Richter, Florence Richter : une filiation féminine de l’étrange à l’écriture oblique (Isabelle Moreels et Florence Richter)
- Notices biobibliographiques
- Index
- Titres de la collection
Remerciements
Les coordinatrices de ce volume collectif tiennent à exprimer toute leur gratitude à leurs universités respectives pour le soutien apporté à la publication de cet ouvrage, le Servicio de Publicaciones et le groupe de recherche CILEM (Lenguas y Culturas en la Europa Moderna : Discurso e Identidad), du côté de l’Universidad de Extremadura, et l’Institut des Langues et Littératures Modernes pour l’Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin. Elles souhaitent également remercier vivement Marc Quaghebeur de les avoir invitées à proposer la publication de cet ouvrage au sein de la collection qu’il dirige.
Comment ne rendraient-elles pas aussi symboliquement grâce à Jean Muno qui, d’outre-tombe, a présidé à leur fructueuse rencontre virtuelle dans les limbes des vidéoconférences entre l’Espagne et la Pologne ? C’est lui qui les a amenées à faire connaissance l’une de l’autre au départ de son œuvre, objet de leurs recherches respectives selon les perspectives de l’ironie et du fantastique : une très heureuse histoire singulière…
Présentation. Lorsque le fantastique joue la carte de la subversion
Isabelle MoreelsetRenata Bizek-Tatara
Université d’Estrémadure (Espagne)Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin (Pologne)
←13 | 14→←14 | 15→« Aussi suis-je de ceux qui sympathisent avec les hommes qui font cause commune avec le Mystère et sa sœur aux yeux de jade, la Peur […] »
Jean Ray1
Considéré comme une des marques identitaires de la littérature belge de langue française au risque d’en devenir un topos, le fantastique produit outre-Quiévrain a déjà fait couler beaucoup d’encre. Critiques et chercheurs de Belgique ou d’ailleurs, aussi bien qu’auteurs d’anthologies, se sont spécifiquement intéressés depuis plusieurs décennies à l’éventail des œuvres des tenants de l’« école belge de l’étrange », pour reprendre la dénomination donnée en 1972 par Jean-Baptiste Baronian qui a joué un rôle clé dans leur diffusion. Néanmoins, les écrivains ont mûri leur rapport avec le spectre réfracté de l’étrange à partir des figures pionnières et tutélaires de Jean Ray et Franz Hellens jusqu’à Jean Muno et Bernard Quiriny, en passant par Monique-Alika Watteau, Anne Richter ou Jacques Sternberg. Et nous ne citons ici que quelques-uns des plus emblématiques « fantastiqueurs » – selon le terme générique forgé par Théophile Gautier – issus de cet espace septentrional circonscrit.
Nous nous sommes dès lors proposé d’enrichir le discours critique en marge de l’analyse des canons du genre – s’il y a – en nous focalisant sur les différents types de subversions significatives auxquels donne lieu le fantastique, par le biais de l’humour (noir ou pas), l’ironie, voire la parodie. En effet, le vif succès du colloque international intitulé « Humour, ironie et subversions dans l’école belge de l’étrange », que nous avons ←15 | 16→organisé les 28 et 29 avril 2021 sous l’égide des universités d’Estrémadure (Cáceres, Espagne) et Marie Curie-Skłodowska (Lublin, Pologne)2, nous a montré l’intérêt d’approfondir le débat ouvert en suscitant la collaboration de spécialistes en la matière.
Les contributions offertes dans cet ouvrage poursuivent donc l’objectif d’examiner, chez des « fantastiqueurs » belges affirmés ou occasionnels, la signification et les mécanismes des distanciations ou irrégularités relevées par rapport aux modèles classiques, leurs codes et leurs invariants. Si les décalages se multiplient jusqu’au paroxysme du burlesque dans certaines narrations étudiées, d’autres récits en revanche ne montrent que des écarts ponctuels, la discrétion de ces déviations n’en étant pas moins révélatrice d’un choix sur lequel nous interroger. En tout cas se répète le constat que, sous le couvert d’un ludisme qui substitue le (sou)rire au frisson de la peur dans un univers teinté de surnaturel, surgit souvent, outre le questionnement esthétique et éventuellement linguistique, une réflexion transgressive. Celle-ci rebondit sur notre monde bien réel, tant dans ses aspects socio-politiques qu’environnementaux, au point que le détournement allant jusqu’au renversement des procédés canoniques peut amener le lecteur à réviser ses valeurs existentielles. Ajoutons que le parcours tracé par les dix-sept chercheurs internationaux participant à ce volume collectif ne prétend aucunement à l’exhaustivité, vu la pléiade des romanciers et surtout nouvellistes qui, venus d’horizons littéraires divers, ont emprunté les voies du fantastique en Belgique francophone. Mais il permet que des figures majeures et incontournables du panorama des lettres belges, envisagées sous des angles inhabituels, côtoient des écrivains méconnus à découvrir, et que les perspectives de générations plus éloignées soient confrontées à la nôtre.
Plutôt que de distribuer en différentes sections thématiques nécessairement poreuses les travaux réunis ici, nous avons choisi de les présenter suivant un axe diachronique, en fonction des repères temporels des auteurs étudiés, après l’ancrage critique fondamental constitué par la magistrale synthèse de Marc Quaghebeur, relative aux approches du fantastique belge. Le fil chronologique guidant notre cheminement nous donnera l’occasion de nous pencher sur des œuvres d’orientations et de formes variées (romans, nouvelles, micro-récits, pièces de théâtre et ←16 | 17→compositions hybrides ou fragmentaires) dans leurs rapports de subversion du fantastique, pour déboucher sur des fictions tout à fait contemporaines. Or, les narrations traitées les plus actuelles sont signées par des femmes, dans un domaine d’efflorescence créative au-delà du réel où les auteures n’abondent pas, et l’une d’entre elles nous livre son témoignage privilégié dans la contribution finale.
À tout seigneur tout honneur, le dossier s’ouvre par un bref avant-propos de Jean-Baptiste Baronian qui met en évidence et confirme, en tant que spécialiste incontestable en la matière, la particularité du fantastique belge, notamment sa dimension sarcastique, humoristique et subversive dont les déclinaisons sont aussi multiples que variées.
La première contribution donne un éclairage nouveau sur les études consacrées à la littérature de l’étrange durant les quatre décennies écoulées. Son auteur, Marc Quaghebeur, offre un parcours rétrospectif sur le renouvellement de l’approche des textes fantastiques belges et examine diverses pistes de leur théorisation. Il passe aussi en revue les conceptions les plus marquantes qui essaient de baliser le terrain vague de ce filon littéraire, afin de révéler sa nature polymorphe, labile et instable au cours de l’histoire des lettres belges francophones.
L’imaginaire belge réactive la figure tutélaire de la mythologie fantastique : le vampire. Jacques Finné et Jean Marigny remarquent l’influence des récits vampiriques belges sur les chefs-d’œuvre mondiaux dans le domaine, notamment celle de Marie (1859–1922) et Henri (1863–1925) Nizet sur le célèbre Dracula (1897) de Bram Stoker. Ils dressent une liste des quelques textes belges habités par l’hématophage, méconnus, oubliés ou peu étudiés, de Rosny aîné (1856–1940) à Christopher Gérard (né en 1962), en portant une attention particulière à « La voix du sang » (1979) de Jean Muno (1924–1988) où le motif du vampire est traité avec un clin d’œil et une dose non négligeable d’humour.
Que le rire fasse bon ménage avec le fantastique, l’œuvre de Michel de Ghelderode (1898–1962) le confirme parfaitement. En étudiant La mort regarde à la fenêtre (1918), Don Juan (1928) et La Farce des Ténébreux (1942), Éric Lysøe s’évertue à montrer que, dans le théâtre ghelderodien, le rire et le sarcasme garantissent la distanciation entre le lecteur et les personnages, car ils tiennent l’effroi – qui est le propre du fantastique – à distance. Son analyse fort pertinente et personnelle d’« Eliah le peintre » (1941) l’amène à constater que, dans ce conte, le rire contribue ←17 | 18→à l’identification entre le protagoniste juif et le lecteur, ce qui lui permet d’apporter un nouvel éclairage sur la question de l’antisémitisme de l’écrivain.
L’humour joue également un rôle important dans le fantastique de Maurice Carême (1899–1978) qui remanie divers éléments de sa poétique en remplaçant la peur, condition inhérente au genre, par le rire. Renata Bizek-Tatara étudie les ingrédients de son alchimie fantastique dans le recueil de contes Le Château sur la mer. Contes fantastiques. Contes insolites (2008), pour montrer dans quelle mesure l’auteur transgresse les règles du genre, en pétrissant à son goût ses grands archétypes. Elle dévoile aussi les procédés qu’il utilise pour faire fi de l’effectivité traditionnelle du fantastique et créer un effet humoristique.
Fernando Funari réfléchit, quant à lui, sur la question des configurations discursives dans le fantastique de Thomas Owen (1910–2002). Son analyse du conte « Le tissu compétitif » (1990) montre que la caricature, comprise comme interruption du récit, touche le dysfonctionnement du langage qui se manifeste par l’impossibilité de faire discours avec les mots choisis et de communiquer des pensées cohérentes. Selon le fondement linguistique particulier des procédés fantastiques oweniens, les anomalies d’une langue « monstrée » inspirent l’inquiétude mais provoquent aussi le rire du lecteur par la création de jeux de mots amusants.
Dans sa lecture du recueil Les Fantômes du château de cartes (1981) de Marcel Mariën (1920–1993), Aleksandra Komandera se penche sur différents jeux avec le fantastique, voire sur les éléments irréguliers par rapport aux codes littéraires, afin de débusquer la dimension subversive des nouvelles et de définir la fonction de l’humour. La remise en cause des convenances sociales, les trames improbables frôlant l’absurde et le jeu avec les habitudes du lecteur évacuent l’effet terrifiant du surnaturel et produisent un effet comique, ce qui confirme une fois de plus que le rire et le fantastique peuvent former un couple osmotique.
Estrella de la Torre Giménez explore, à son tour, le fantastique corrosif de Jacques Sternberg (1923–2006) en se focalisant sur ses Contes glacés (1974). Elle fait ressortir la particularité thématique et formelle de son écriture fantastique pour en dégager les traits singuliers et les constantes, notamment : univers peuplé par une humanité désenchantée, omniprésence de la mort, vie de tous les jours désespérante, prédilection pour une forme brève (micro-récit), ainsi que pour l’absurde, l’ironie et l’humour noir qui ne font pas rire, mais donnent froid dans le dos.
←18 | 19→L’œuvre polymorphe du fécond Gaston Compère (1924–2008) fait l’objet de deux approches complémentaires. Marc Lits procède à l’analyse de l’ironie dans La Femme de Putiphar (1975), recueil de nouvelles dont il souligne l’orientation particulière par rapport aux autres de cet auteur, vu la rupture de la tension fantastique patente dans presque tous les récits du volume considéré. Le détournement qui affecte aussi bien l’écriture – rendue bouffonne par les nombreux jeux de mots – que les intrigues de ce répertoire démoniaque, teinté d’intertextualité baudelairienne, amène le nouvelliste à y poser les questions existentielles angoissantes sous couvert du carnavalesque. Jacques Finné, quant à lui, s’attache à l’étude du roman In Dracula memoriam. Chronique vampirique vénitienne, parisienne et condruzienne (1998) du « fantastiqueur », où il observe aussi que les jeux lexicaux abondent et que les figures féminines se trouvent malmenées. Le portrait de l’« égotissime » protagoniste, assorti du tableau des satellites entourant ce vampire hors normes à dimension satirique, montre le feu d’artifice burlesque que constitue cette amplification d’une nouvelle antérieure de G. Compère, grâce à la parfaite maîtrise des divers mécanismes d’un comique subversif.
Pour approfondir l’univers étrange de Claude Haumont (1936–2009) qui, proche des surréalistes hennuyers, défendait le principe du « hasard objectif », Vincent Radermecker relève dans Pour une enfance inachevée… (1996) les évocations de présences fantasmales et autres surgissements fantastiques. Figurent aussi, dans ce recueil tissé d’échos autobiographiques, que la correspondance fournie du poète et peintre tourmenté nous permet d’éclairer, des textes empreints d’ironie d’Hector Haumont, où se manifeste la perméabilité des mondes animé et inanimé, en syntonie avec les « flashs » de son fils.
La production fictionnelle toujours croissante de Bernard Quiriny (né en 1978) se voit abordée selon une double perspective. Inmaculada Illanes Ortega se concentre sur les caractéristiques postmodernes de l’ensemble de ses nouvelles publiées de 2005 à 2019, pour souligner la distanciation affirmée par rapport à leur dimension souvent fantastique, grâce au commun dénominateur subversif de l’humour. Malgré leur nature hétéroclite, une riche intertextualité avouée – en référence à Borges, entre autres – unit les recueils. Leurs récits renarrativisés, qui ne manquent pas de touches ironiques quant au travail d’écriture, alimentent la réflexion sur notre monde contemporain en nouant une complicité ludique avec le lecteur. Andrei Lazar, de son côté, choisit d’utiliser le concept de figural comme critère analytique opératif, à la suite de Jean-François Lyotard ←19 | 20→notamment. Ceci l’amène à détailler dans quatre des Contes carnivores (2008) de Bernard Quiriny, autant de types particuliers de subversion concernant respectivement l’identité, le langage, l’esthétique et la raison elle-même, en envisageant des parallélismes avec d’autres textes. Se trouvent minées, par le biais de cette force transgressive, les barrières idéologiques rassurantes, au-delà des tensions fantastiques.
Explorant la veine postapocalyptique contemporaine du fantastique, Laurence Boudart compare les romans Moi qui n’ai pas connu les hommes (1995) de Jacqueline Harpman (1929–2012), L’Escalier (2016) de Catherine Barreau (née en 1965) et Moi, Marthe et les autres (2018) d’Antoine Wauters (né en 1981), dans leur questionnement en quête de survie et de mémoire. Ces dystopies qui imaginent, aux frontières du réel, les conséquences de la destruction dramatique de notre environnement avec, à la clé, la menace de fin du monde, utilisent occasionnellement l’humour (noir) et l’ironie comme prise de distance par rapport à ce constat oppressant.
Catherine Gravet, pour sa part, s’interroge sur les caractéristiques d’un fantastique contemporain au féminin à partir de l’examen de trois romans publiés par des écrivaines en 2020 : La Confiture des morts de Catherine Barreau, Médusa. Les femmes qui n’aimaient pas les hommes de Jennifer Deneffe (née en 1980) et Il fait bleu sous les tombes de Caroline Valentiny (née en 1974). Des touches humoristiques, parodiques ou burlesques parsèment ces œuvres à la structure parfois régie par l’ironie et où jouent un rôle fondamental la métamorphose, ainsi que le recours aux mythes de Perséphone ou de Méduse pour dire et surmonter la peur.
Afin d’étudier comment Marie-Thérèse Bodart (1909–1981), Anne Richter (1939–2019) et Florence Richter (née en 1967) se passent, de mère en fille, le relais d’une écriture féminine particulière de l’étrange et son exégèse, Isabelle Moreels propose un triptyque de leurs parcours littéraires respectifs, suivi du témoignage de Florence Richter qui répond à ses questions. Humour et ironie, souriante ou mordante voire subversive, imprègnent nouvelles et romans de portée fantastique des trois auteures pour revoir notre rapport au monde végétal et animal, de même que notre identité sociale, vers l’écoféminisme.
Details
- Pages
- 282
- Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9782875746627
- ISBN (ePUB)
- 9782875746634
- ISBN (Softcover)
- 9782875746610
- DOI
- 10.3726/b20044
- Language
- French
- Publication date
- 2023 (February)
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 282 p.