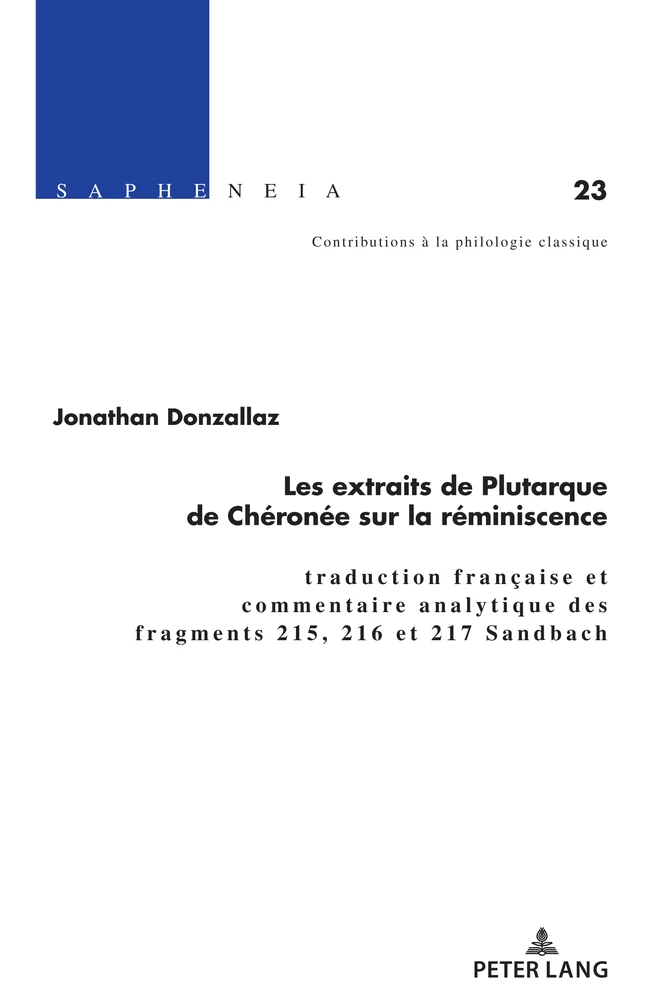Les extraits de Plutarque de Chéronée sur la réminiscence
Traduction française et commentaire analytique des fragments 215, 216 et 217 Sandbach
Résumé
forment un ensemble cohérent. Conservés dans deux Commentaires de Damascius sur le
Phédon de Platon, ces extraits traitent de la théorie platonicienne de la réminiscence et
n’avaient encore pas fait l’objet d’une réflexion approfondie qui permette d’en saisir tous
les enjeux, en dehors de quelques contributions non exhaustives. Le présent ouvrage vise à
combler cette lacune. Essentiellement composé d’un commentaire détaillé et d’une traduction
française inédite, il permet d’apporter un regard neuf sur cet ensemble de fragments,
en discutant en profondeur de la question de leur authenticité et en proposant notamment
un nouveau découpage, dont l’attribution de deux paragraphes supplémentaires à Plutarque.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Remerciements
- Sommaire
- Préface
- Table des abréviations
- Introduction générale
- 1. Histoire du texte
- 1.1. L’archétype : le Marc. Gr. Z. 196
- 1.1.1. Origine et caractéristiques du manuscrit
- 1.1.2. Un manuscrit à l’histoire complexe
- 1.2. Aperçu de la descendance manuscrite
- 1.3. Editions et traductions françaises
- 2. La question de la délimitation et de l’altération des fragments
- 2.1. Considérations théoriques sur la notion de « fragment »
- 2.2. Le discours citant : les commentaires sur le Phédon de Damascius
- 2.2.1. Introduction : aperçu historique de l’exégèse du Phédon
- 2.2.2. La nature des commentaires de Damascius
- 2.2.3. Le rapport entre les deux commentaires
- 2.3. Le discours cité : l’insertion des fragments de Plutarque
- 2.3.1. Le contexte direct de citation
- 2.3.2. La délimitation externe : tentatives de bornage
- 2.3.3. La nature des fragments : un énoncé altéré et déformé
- 2.3.4. La délimitation interne : interventions néoplatoniciennes dans le discours de Plutarque
- 2.4. Conclusion : conséquences typographiques et méthodologiques
- 3. Traduction française et commentaire analytique
- Introduction à la section 215a–215c
- 215a Sandbach = Damascius I § 275 Westerink
- 215b Sandbach = Damascius I § 276 Westerink
- 215c Sandbach = Damascius I § 277 Westerink
- Introduction à la section 215d–215f
- 215d Sandbach = Damascius I § 278 Westerink
- 215e Sandbach = Damascius I § 279 Westerink
- 215f Sandbach = Damascius I § 280 Westerink
- Introduction à la section 215g–215i
- 215g Sandbach = Damascius I § 281 Westerink
- 215h Sandbach = Damascius I § 282 Westerink
- 215i Sandbach = Damascius I § 283 Westerink
- Introduction aux sections 215j–215m et 216a–216c
- 215j Sandbach = Damascius I § 284 Westerink
- 215k Sandbach = Damascius I § 285 Westerink
- 215l Sandbach = Damascius I § 286 Westerink
- 215m Sandbach = Damascius I § 287 Westerink
- 216a Sandbach = Damascius I § 288 Westerink
- 216b Sandbach = Damascius I § 289 Westerink
- 216c Sandbach = Damascius I § 290 Westerink
- Introduction à la section 216d–216e
- 216d Sandbach = Damascius I § 291 Westerink
- 216e Sandbach = Damascius I § 292 Westerink
- Introduction à la section216f–216g et aux paragraphes I § 295–296 Westerink
- [216f Sandbach = Damascius I § 293 Westerink]
- 216g Sandbach = Damascius I § 294 Westerink
- [Plutarque ?] = Damascius I § 295 Westerink
- [Plutarque ?] = Damascius I § 296 Westerink
- Introduction à la section 217a–217l
- 217a Sandbach = Damascius II § 28.01 Westerink
- 217b Sandbach = Damascius II § 28.02 Westerink
- 217c Sandbach = Damascius II § 28.03 Westerink
- 217d Sandbach = Damascius II § 28.04 Westerink
- 217e Sandbach = Damascius II § 28.05 Westerink
- 217f Sandbach = Damascius II § 28.06 Westerink
- 217g Sandbach = Damascius II § 28.07 Westerink
- 217h Sandbach = Damascius II § 28.08 Westerink
- 217i Sandbach = Damascius II § 28.09 Westerink
- 217j Sandbach = Damascius II § 28.10 Westerink
- 217k Sandbach = Damascius II § 28.11 Westerink
- 217l Sandbach = Damascius II § 28.12 Westerink
- 4. Synthèse et hypothèses
- 4.1. Etat des lieux de la question de l’attribution à Plutarque
- 4.2. Eléments de datation
- 4.3. Eléments d’attribution
- 4.4. Quelques hypothèses sur l’œuvre originelle
- 4.4.1. Le Περὶ ψυχῆς et les traités apparentés
- 4.4.2. Un focus épistémologique ? Le Τί τὸ συνιέναι ; et autres traités
- 4.4.3. La trace d’une des Σχολαὶ Ἀκαδημαϊκαί ? La dimension rhétorico-philosophique
- 4.5. De Plutarque à Damascius
- Conclusion générale
- Bibliographie
- Titres de la collection
Préface
Le présent ouvrage constitue la version révisée du mémoire de Master que Jonathan Donzallaz a réalisé sous ma direction à l’Université de Fribourg et soutenu en mars 2018. Il n’est certes pas habituel de faire publier les résultats d’un travail de fin d’études, mais la qualité de la recherche menée par le candidat et l’intérêt indéniable qu’en présentent les conclusions pour la communauté scientifique m’ont semblé en justifier la publication. Aussi suis-je très reconnaissant à mes collègues du comité de rédaction de la collection Sapheneia d’avoir accueilli avec bienveillance ce projet de publication, après l’avoir soumis, comme il se doit, à une expertise externe anonyme, qui s’est révélée très positive.
L’étude de J. Donzallaz s’inscrit dans le cadre plus large de mon projet de nouvelle édition des fragments de Plutarque pour le compte de la Collection des Universités de France, que les responsables de la « Série grecque » ont bien voulu me confier et que je mène depuis plusieurs années avec la gracieuse collaboration de ma collègue Prof. em. Margarethe Billerbeck, qui a également assuré la dernière révision de la présente étude.
Pour cette recherche, j’avais suggéré à J. Donzallaz de procéder à un examen détaillé des fragments répertoriés dans l’édition de référence de F.H. Sandbach (Teubner, 1967) sous les numéros 215, 216 et 217, un ensemble cohérent constitué de 32 fragments préservés dans deux commentaires sur le Phédon de Platon attribués au philosophe néo-platonicien Damascius (au tournant des Ve et VIe siècles) et traitant de la théorie de la réminiscence. Il s’agit ici de la première étude d’ensemble de cette collection de fragments, abordée sous différents angles relevant de domaines aussi variés que la codicologie, la paléographie, la critique textuelle, la philosophie, l’analyse linguistique, littéraire et historique, l’apport de la théorie littéraire ou encore la réception des textes. Les résultats de l’enquête ←11 | 12→de J. Donzallaz ont confirmé le bien-fondé de ce choix et de cette démarche.
Son approche globalisante s’est en effet révélée très fructueuse. Ainsi, la description codicologique du Marcianus Graecus Z. 196, basée sur l’autopsie de ce codex byzantin constituant l’archétype des manuscrits de la collection dite « philosophique », a permis de mieux appréhender l’aspect matériel de cet ensemble et, conjointement avec des considérations théoriques sur la notion de « fragment », de formuler des propositions convaincantes pour une nouvelle délimitation de certains fragments de Plutarque. De même, le commentaire analytique des fragments, visant à la fois à éclairer les principales notions ou thématiques abordées et à en examiner les possibles correspondances avec les œuvres conservées de Plutarque, a notamment conduit l’auteur à identifier deux nouveaux fragments du Chéronéen à l’intérieur de l’ensemble constitué par le numéro 216 et, grâce à un parallèle passé inaperçu, à confirmer de façon indiscutable la paternité de Plutarque pour le fragment 215k. À la fin de son enquête, il est ainsi en mesure d’évaluer de façon critique les hypothèses formulées par la recherche moderne au sujet de l’œuvre dont seraient issus ces fragments et, surtout, d’en proposer une nouvelle, tout à fait convaincante.
Aussi est-ce en toute légitimité et sans aucune prétention que J. Donzallaz peut affirmer, en conclusion de son étude, « avoir démontré qu’une analyse fine et entièrement reprise à son commencement par l’analyse de la tradition textuelle permet au final d’apporter des éléments nouveaux susceptibles d’éclairer très modestement notre connaissance de l’œuvre de Plutarque ». Son enquête est bien, comme il le souligne, « un plaidoyer en faveur de l’étude des fragments » et elle démontre à l’envi tout l’intérêt qu’il existe à entreprendre à nouveaux frais une édition des fragments de Plutarque après celle de F.H. Sandbach, tout admirable qu’elle est.
Fribourg, le 1er novembre 2021
Thomas Schmidt
Introduction générale
Quel est l’intérêt d’un travail sur les fragments de Plutarque de Chéronée ? Avant de se lancer dans l’étude de quelques-uns d’entre eux, on peut se poser la question en toute légitimité. De prime abord, étudier une œuvre fragmentaire paraît être une entreprise à la fois problématique et vouée à des résultats partiels, forcément insatisfaisants. Bien qu’en plein développement, les études spécifiquement consacrées aux fragments littéraires sont relativement disparates, et l’édition des fragments d’un auteur n’est le plus souvent entreprise qu’une fois toutes les autres œuvres éditées, comme si cette tâche fastidieuse n’était envisagée qu’une fois le contenu « intéressant » épuisé.
Pourtant, tout chercheur recourant à la littérature antique, du philologue à l’historien et du philosophe à l’archéologue, sait qu’il s’en réfère à un corpus essentiellement fragmentaire. En effet, la plus grande partie des textes grecs et latins produits à travers les siècles sont irrémédiablement perdus. Des centaines d’auteurs ne sont à nos yeux guère plus que des noms. Même pour ceux dont nous avons conservé plusieurs dizaines d’œuvres, nous avons connaissance d’autres titres auxquels nous n’avons plus accès. A l’heure où les progrès de l’informatique ont considérablement modifié notre approche de la littérature antique, même les outils les plus performants viennent se briser sur cet écueil incontournable. Le Thesaurus Linguae Graecae permet d’interroger quasiment toute la littérature grecque, du moins celle qui est parvenue jusqu’à nous. Il s’agit d’un biais considérable, qui ne doit jamais être oublié. Tout spécialiste de l’Antiquité qui s’appuie sur les textes se doit donc d’exprimer des réserves avant de soutenir une thèse de manière trop définitive.
On entrevoit ainsi l’intérêt d’un travail sur les fragments. L’enjeu est de nous faire accéder à une part substantielle d’une littérature autrement perdue. Les fragments nous permettent d’éclairer d’autres ←15 | 16→textes, de reconstruire avec davantage de précisions l’univers intellectuel d’un auteur, de résoudre des problèmes de compréhension – en bref, ils sont une part comme une autre de la production littéraire d’un auteur, et à ce titre un sujet d’étude essentiel pour le philologue classique, qui seul dispose des outils qui permettent de les analyser.
Ces considérations générales s’appliquent évidemment aussi à Plutarque. En effet, en dépit du fait que nous avons conservé plusieurs dizaines de traités du célèbre écrivain et philosophe de Chéronée, et que celui-ci constitue de ce fait une source extrêmement importante pour notre connaissance de l’Antiquité, nous savons que nous avons en vérité perdu la majeure partie de ses œuvres, la moitié1, les deux tiers, voire les trois quarts2 de sa production littéraire, selon les estimations des différents spécialistes. Le catalogue d’une bibliothèque du IIIème ou du IVème siècle de notre ère3 communément désigné comme le Catalogue de Lamprias nous permet de nous faire une idée de l’étendue de cette perte, puisque celui-ci nous fournit plusieurs dizaines de titres perdus, quand bien même toutes les œuvres de Plutarque n’y figurent pas.
On dispose toutefois d’un corpus de fragments de Plutarque édité en dernier lieu par Sandbach4 qui nous permet d’accéder à quelques-uns de ces traités perdus. Parmi les fragments retenus par cet éditeur, les trois derniers, qui portent les numéros 215 à 217, forment un ensemble cohérent. Ceux-ci se présentent comme une succession de paragraphes juxtaposés les uns aux autres et introduits par les conjonctions ὅτι ou εἰ, de sorte que nous avons affaire à trente-deux unités textuelles, dont treize sont placées sous le numéro 215 (215a–215m), sept sous le numéro 216 (216a–216g*) et douze sous le numéro 217 (217a–217l). Il s’agit de textes préservés dans deux commentaires sur le Phédon de Platon que l’on doit au néoplatonicien Damascius et qui traitent de la théorie platonicienne de la ←16 | 17→réminiscence, un des arguments précisément avancé par Platon dans son dialogue pour prouver l’immortalité de l’âme. En dehors d’une ou deux études spécifiques5, ces fragments n’ont pas fait l’objet d’une réflexion approfondie, et les notes des différents éditeurs et traducteurs ne permettent guère d’en saisir tous les enjeux. On se borne généralement à poser sur eux un jugement sommaire, les uns doutant que Plutarque en soit même à l’origine, les autres appuyant au contraire la thèse d’une attribution à Plutarque avec un certain degré de conviction.
Le présent travail vise donc à développer ce champ très spécifique de la recherche, dans les limites que nous permet l’état actuel du texte. Nous avons pour ce faire choisi la forme du commentaire analytique, qui occupera l’essentiel de cette étude. Deux chapitres précèdent cette partie centrale. Il s’agira tout d’abord d’établir l’histoire du texte. En effet, les fragments ayant subi le même sort que toute œuvre littéraire, recopiés de manuscrit en manuscrit puis d’édition en édition, ils ont été l’objet du regard critique de savants qui les ont commentés et parfois corrigés. Il convient donc de se pencher sur cette histoire, afin d’être sensible aux choix effectués par les philologues à travers les siècles.
L’étude des fragments requiert en outre des précautions spécifiques. En effet, le fragment ne doit son existence qu’à la volonté d’un auteur postérieur, qui l’a cité dans son propre texte, dans un but précis qui, même s’il est « honnête », n’en constitue pas moins un prisme déformant. L’étude du contexte constitue dès lors un préalable inévitable, auquel nous dédierons un chapitre particulier.
Quant au commentaire en tant que tel, il offrira au lecteur une analyse détaillée du contenu de chaque fragment. Nous y avons adjoint, à chaque fois, le texte grec, accompagné d’une traduction française de notre plume, la dernière en date étant celle de Bétolaud au XIXème siècle6. En outre, nous avons repris dans les grandes lignes les divisions thématiques mises en évidence par Roskam dans son ←17 | 18→analyse récente de nos fragments7. Même si nous verrons que celles-ci ont leurs limites, elles mettent cependant en lumière l’unité qui relie certains fragments entre eux. Nous avons ainsi parsemé notre commentaire de diverses « introductions » à ces sections thématiques, qui nous permettent de livrer un commentaire d’ordre plus général.
Résumé des informations
- Pages
- 218
- Année de publication
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783034344814
- ISBN (ePUB)
- 9783034344821
- ISBN (MOBI)
- 9783034344838
- ISBN (Relié)
- 9783034343671
- DOI
- 10.3726/b19371
- Langue
- français
- Date de parution
- 2022 (Juin)
- Mots clés
- Platonic theory contributions non exhaustives Plutarque
- Publié
- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 218 p.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG