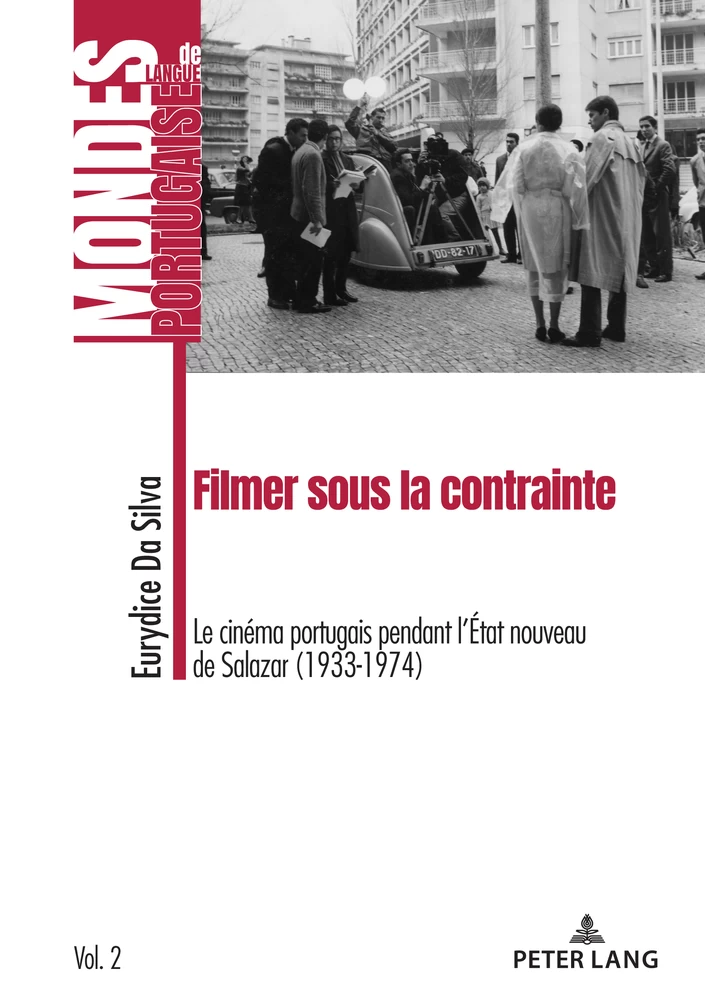Filmer sous la contrainte
Le cinéma portugais pendant l’État nouveau de Salazar (1933-1974)
Summary
Cette étude de fond sur 48 ans de dictature est une plongée dans le septième art portugais à une période charnière de l’histoire du Portugal.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Remerciements
- Sommaire
- Table Des Sigles Et Abréviations
- Note De Traduction
- Préface
- Introduction
- CHAPITRE I La mise en place d’un dispositif cinématographique
- I. Cinéma, pouvoir et État nouveau
- II. Images de pouvoir et pouvoir des images : l’instauration d’une norme à l’écran
- III. Rendre visible l’invisible, le code tacite de la censure
- IV. La consolidation d’un dispositif : la création du Fonds du cinéma national.
- CHAPITRE II Mutations du paysage cinématographique national : vers l’émergence d’un Nouveau cinéma Portugais
- I. Une brèche dans des horizons fermés
- II. Contourner le pouvoir
- III. Des mesures d’encadrement imposées par l’État
- CHAPITRE III Les effets de la censure. De l’interdiction de dire, à la poétique du non-dit
- I. La voix des censeurs
- II. La voix des auteurs, défendre une vision – 3 études de cas de cinéastes
- III. Déjouer la censure
- Conclusion
- Bibliographie Et Sources
- Index
- Table Des Illustrations
- Table Des Matières
- Titres de la collection
Table Des Sigles Et Abréviations
(Par ordre alphabétique)
ANTT : |
Arquivo Nacional da Torre do Tombo / Archives Nationales de la Torre do Tombo |
CPC : |
Centro Português do Cinema / Centre portugais du cinéma |
DGE : |
Direcção Geral dos Espectáculos / Direction générale des spectacles |
FCN : |
Fundo do Cinema Nacional / Fonds du cinéma national |
IPC : |
Instituto Português do cinema / Institut portugais du cinéma |
MUD : |
Movimento de Unidade Democrática / Mouvement d’Unité Démocratique |
MUDJ : |
Movimento de Unidade Democrática Juveníl / Mouvement d’Unité de la Jeunesse Démocrate |
PCP : |
Partido Comunista Português / Parti communiste portugais |
PIDE : |
Polícia Internacional e de Defesa do Estado / Police Internationale et de Défense de l’État |
PVDE : |
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado / Police de Vigilance et de Défense de l’État |
SEIT : |
Secretariado de Estado da Informação e Turismo / Secrétariat d’État de l’Information et du Tourisme |
SPN : |
Secretariado da Propaganda Nacional / Secrétariat de la Propagande Nationale |
SNI : |
Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo / Secrétariat national de l’Information, de la Culture populaire et du Tourisme |
Note De Traduction
Sauf mention du contraire en note de bas de page, nous avons traduit du portugais vers le français toutes les citations (documents d’archives, extraits de décrets-lois, ouvrages en portugais), car la majorité de nos sources et de nos références est en langue portugaise.
Préface
« Le terme de censure, au sens propre, désigne l’acte d’empêcher une œuvre d’accéder au public ».1 Cette définition lapidaire désigne l’objectif fondamental de l’acte censorial, mais le développement de chacun des éléments qui l’induisent recouvre un champ de réflexion poreux face à un phénomène complexe dont les méandres ne cessent de macérer. Toujours sous-tendue par un contexte politique et social, la censure est polymorphe et variable, selon les pouvoirs et les régimes qui la gouvernent, tour à tour exhibée ou dissimulée, selon les desseins de ceux qui la pilotent. A ce titre, le livre qui nous est proposé par Eurydice Da Silva est particulièrement intéressant : il aborde la censure pratiquée par un pouvoir monopolisé par l’Etat dictatorial d’un pays européen si proche, le Portugal, et si loin, tant le régime qui l’a étouffé durant 48 ans demeure encore, hors des frontières nationales, bien moins connu que les autres dictatures qui ont marqué l’histoire du XXème siècle.
Partant du constat de la longueur inusitée de la dictature portugaise (de 1926 à 1974), l’auteure se propose d’aborder le cinéma portugais de 1933 à 1974, en évoquant un système autoritaire qui allie propagande, censure et répression, outils d’exercice de pouvoir de l’État nouveau (Estado Novo) instauré par António de Oliveira Salazar. À travers l’analyse de documents d’archives inédits, l’étude cherche à déterminer l’impact du contexte politique dans le milieu cinématographique sous l’égide du régime salazariste, aussi bien dans le contenu de la création filmique que dans les modes de production et de distribution. Il s’agit de donner à voir le mode opératoire de l’État pour encadrer, surveiller ou réprimer la production cinématographique, afin de comprendre la dynamique à l’œuvre entre cinéma et histoire, spécifiques à ce pouvoir dictatorial. Le propos est également de sonder l’étendue de l’action de la censure dans ←17 | 18→le milieu du cinéma portugais, d’en comprendre la spécificité, les enjeux, et d’en observer les effets et leur évolution durant 48 ans de dictature.
Il faut souligner le mérite d’Eurydice Da Silva qui a su valoriser les circonstances parfois complexes de sa recherche sur une thématique dont « les cendres sont encore chaudes », dans un pays où il n’y a pas de tradition d’archives et où la tâche du chercheur se complique encore lorsqu’il s’agit d’une période récente dont la lecture peut être controversée. Le livre, de lecture agréable et aisée, est bonifié par l’expérience de praticienne de l’auteure, en lien avec son parcours de scénariste et d’activité cinématographique. Ainsi établit-elle une forme de chemin « dedans / dehors », qui lui permet d’observer le cinéma portugais sous surveillance avec une acuité particulière. Cherchant à mettre à jour le dispositif spécifique qui contraint le septième art portugais à l’épreuve de la dictature (cadre et réglementations, contraintes, surveillances, interdictions…), elle n’oublie pas de faire le lien avec le système global mis en place par un pouvoir dont l’objectif principal est de conditionner corps et mentalités, conduisant individuellement et collectivement la population à la soumission, voire à la participation au dispositif mis en place. Le livre donne de nombreux exemples d’auto-censure des artistes, des participants aux différentes étapes de la réalisation de la production filmique.
Eurydice Da Silva pointe l’efficacité d’un dispositif de surveillance tatillon, qui couvre tout le territoire et s’appuie sur des services de censure relayés par une propagande qui remplace le vide du texte et de l’image, interdits, par les éléments reformulés selon le modèle de l’idéologie imposée. On perçoit de façon précise une mise au pas progressive qui procède d’un véritable encerclement des personnalités, comme une sorte de colonisation de la psyché qui porte les auteurs, producteurs, artistes à modifier leur production, à l’adapter aux désidératas du pouvoir autoritaire.
L’originalité particulière de ce livre, qui s’inscrit tant en études cinématographiques qu’en histoire et en histoire culturelle, est de révéler combien les artistes/auteurs/producteurs, en voulant esquiver la censure, sont portés à maquiller leur version filmique originelle pour éviter l’interdit, la coupe. Il se produit alors une forme d’esthétique de la métaphore, du contour du réel que la « Politique de l’Esprit », promue par l’État nouveau, refusait de regarder en face et voulait maquiller. On voit combien c’est une procédure qui agit par encerclement progressif, par insinuation, aboutissant à l’intériorisation de ces processus de ←18 | 19→mise sous boisseau silencieux qui laisse des traces indélébiles dans les comportements. Et l’on voit les nombreux cas d’auteurs négociant avec les interlocuteurs censeurs la version acceptable de leur œuvre. On peut parler d’un habitus comportemental pour les artistes et dont les traces sont pérennes même après l’avènement d’une démocratie normalisée, ce qui n’est pas sans évoquer un phénomène de « syndrome de dictature » tel que l’évoque Alaa El Aswany.2 C’est encore avec ces effets à long terme qu’Eurydice Da Silva nous permet d’éclairer au présent le cinéma portugais dont beaucoup des particularités esthétiques sont aussi le reflet de cette époque obscure.
Ce sont là, parmi bien d’autres, les éléments qui font de Filmer sous la contrainte : le cinéma portugais pendant l’État nouveau de Salazar (1933–1974) une œuvre de référence sur le cinéma portugais qui s’inscrit pleinement dans une histoire de l’art cinématographique européen. Loin d’être une étude de cas limité à un espace et à des situations spécifiques, c’est également un apport considérable vers une histoire comparée de la censure et de ses procédés.
Introduction
De 1926 à 1974, le Portugal a connu la plus longue dictature d’Europe au XXème siècle. Aborder le cinéma portugais de 1933 à 1974, c’est évoquer un système autoritaire qui allie propagande, censure et répression, outils d’exercice de pouvoir de l’État nouveau (« Estado Novo ») instauré par António de Oliveira Salazar (1889–1970). Il en ressort un champ de recherche à la fois vaste et complexe, intrinsèquement pluridisciplinaire, car l’histoire du cinéma portugais se trouve traversée par des événements historiques, politiques et sociaux. Il est donc difficile d’aborder la filmographie produite pendant la dictature portugaise sans évoquer la société qui l’entoure et son contexte de production. Notre approche visera à mettre en lumière ce cadre, pour mieux comprendre la production nationale de cette époque. Pour cela, il nous faut d’abord revenir sur les premiers temps du régime, comme sur les débuts du cinéma au Portugal, pour pouvoir déterminer leur premier point de rencontre.
L’avènement de l’État nouveau
Le 28 mai 1926, un coup d’état militaire renverse la Première République portugaise, en place depuis 1910 malgré une scène politique tumultueuse où se sont succédés neuf présidents. En mars 1928, le Général Carmona3 devient Président de la République du nouvel ordre politique, nommé la Dictature Nationale (« Ditadura Nacional »), qui succède à la Dictature Militaire (« Ditadura Militar », 1926–1928). La formation de ce nouveau gouvernement va permettre la nomination d’un professeur d’économie politique de Coimbra pour le nommer Ministre des Finances. António de Oliveira Salazar s’impose progressivement comme la figure capable d’instaurer un pouvoir stable et durable, après des années d’incertitudes politiques et économiques. Graduellement, la ←21 | 22→figure de proue du Général Carmona s’efface derrière celle de Salazar qui, en juillet 1932, devient officiellement Président du Conseil. Il maintiendra ce titre pendant trente-six ans, jusqu’en septembre 1968, date à laquelle un accident cérébral l’éloigne du pouvoir, avant sa mort en juillet 1970. Son héritage politique perdure cependant, ne s’arrêtant pas à la mort de l’homme, car en 1933, Salazar érige une nouvelle constitution. Promulguée le 11 avril 1933, celle-ci annonce l’œuvre du véritable chef de l’État portugais et donne naissance au régime de l’État nouveau, qualifié de corporatiste, dont la longueur exceptionnelle s’apparente à un véritable règne4. Dans les mois qui suivent l’instauration de la nouvelle Constitution, l’État inaugure rapidement ses structures de contrôle comme le Secrétariat de la Propagande Nationale (« Secretariado da Propaganda Nacional », SPN) créé le 25 septembre 1933. Inauguré le 26 octobre 1933, le SPN est nommé Secrétariat National de l’Information, de la Culture Populaire et du Tourisme (« Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo » ou SNI) à partir du 23 février 1944. Dans un contexte dictatorial et suite à la victoire des Alliés, l’usage du mot « propagande » devient péjorativement connoté. En 1968, lorsque Salazar est éloigné du pouvoir, sa dénomination change de nouveau, le SNI devient la SEIT, le Secrétariat d’État de l’Information et du Tourisme (« Secretariado de Estado da Informação e Turismo »). Le nom des structures de l’État nouveau change, mais les organismes ont les mêmes fonctions. Ainsi, en 1945, la police politique de l’État nouveau, la PVDE, Police de Vigilance et de Défense de l’État (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado), est nommée PIDE, Police Internationale et de Défense de l’État (Polícia Internacional e de Defesa do Estado). En 1968, Marcelo Caetano remplace Salazar et se retrouve à la tête de l’État nouveau. Alors que certains espèrent voir venir la chute de la dictature, l’État nouveau et ses structures se maintiennent en place jusqu’au coup d’État militaire du 25 avril 1974, la Révolution des Œillets, qui mettra fin à 48 ans de dictature.
Pendant près de cinq décennies, la création artistique évolue dans un système qui la maintient, malgré des élans d’émancipation, dans un cadre déterminé par le régime en place. Le rôle du cinéma est fondamental dans les premiers temps du régime, car il donne lieu aux ←22 | 23→premières représentations du pouvoir. Dès 1933, il devient clair que le gouvernement aspire à un cinéma national fort, tout comme à l’existence d’un cinéma national reconnaissable par sa qualité et par son identité. L’aspiration au rayonnement du cinéma national au Portugal comme à l’étranger est une quête qui dirige les actions de l’État et oriente son intervention dans le milieu cinématographique. Parallèlement, au-delà de l’action de la PIDE, l’État instaure un contrôle préalable à travers la censure qui opère dans tous les secteurs d’activité, y compris le cinéma5.
La censure, une nouvelle forme de tradition ancienne
Si la censure pendant l’État nouveau constitue un instrument de contrôle fondamental, ayant aussi contribué à la longévité du régime, ses origines sont plus anciennes. Son intervention s’inscrit dans une longue tradition censoriale portugaise. Déjà existante durant le Moyen Âge et exercée par l’Église, la censure se perfectionne dans les siècles suivants, suite à l’invention de l’imprimerie. Dans son ouvrage Breve história da censura literária em Portugal, Graça Almeida Rodrigues retrace l’historiographique de cette institution et identifie deux modèles archétypes qui ont façonné le mode opératoire de la censure au Portugal : la censure inquisitoriale, qui va du XVIème au XVIIIème siècle, puis la Real Mesa Censória qui la remplaça en 1768, par l’action du Marquis de Pombal. Profondément ancrée dans la culture portugaise au fil des siècles, la censure préalable fonctionne toujours comme corollaire du pouvoir en place. « Durant les XIXème et XXème siècles, la censure se présente comme le baromètre de l’idéologie politique des gouvernements qui se succèdent. À chaque changement de pouvoir, qu’il soit libéral, absolutiste, républicain ou dictatorial, une nouvelle loi de la presse lui a toujours été associée »6. Pendant la 1ère République, la loi de la presse autorise la critique au gouvernement, une mesure qui sera révoquée en 1933, durant l’État nouveau. Avec de brefs interstices de liberté d’expression (notamment en 1822, suite à la révolution de 1820), la censure fait historiquement partie des instruments d’exercice du pouvoir politique au Portugal. Comme le note Graça Almeida Rodrigues, au ←23 | 24→Portugal la censure est en vigueur sur quatre des cinq siècles d’existence de la presse. C’est donc un instrument qui fait traditionnellement partie intégrante de la vie politique portugaise, avec des degrés d’intervention divers, selon le régime en place. Il s’agira donc de comprendre la spécificité de la censure pendant l’État nouveau, de voir comment celle-ci opère dans le milieu artistique, et surtout comment cette institution séculaire intègre la forme d’expression nouvelle, le nouveau langage, que représente le cinéma, et qui se développe de manière concomitante avec le début de l’État nouveau.
La rencontre entre histoire et cinéma s’opère graduellement. Politiquement, les débuts du cinéma au Portugal accompagnent la succession de trois régimes politiques en l’espace de trois décennies. Introduit au Portugal au temps de la monarchie, le cinéma portugais naît à Porto en 1896 grâce à Aurélio da Paz dos Reis7, soit un an après l’invention des frères Lumière à Paris. Durant les premières années, le cinéma se développe à l’échelle du pays, avec de petits moyens. Les premiers chefs opérateurs8, les « chasseurs d’images »9, documentent la vie publique portugaise, venant à filmer les obsèques de D. Carlos et du prince héritier en 1908, puis la révolution républicaine en 1910. Ainsi, les premières images de cinéma réalisées au Portugal se trouvent déjà liées aux événements historiques et politiques dans une certaine mesure, d’abord dans une perspective documentaire. Les premiers longs-métrages de fiction ne seront réalisés qu’à partir de 1918, et ce n’est véritablement qu’en 1933, avec l’instauration de l’État nouveau, que politique et cinéma portugais se trouveront irrémédiablement liés.
Nous verrons comment la législation qui encadre l’activité cinématographique évolue selon le régime dictatorial en place et selon ←24 | 25→les événements politiques. Il s’agira également de comprendre comment l’action de la censure se manifeste au cinéma dans un premier temps, puis comment elle se perfectionne jusqu’à la fin du régime.
Avant de présenter notre champ d’analyse, il nous faut préciser ce que nous entendons par censure au cinéma. Dans La pellicule et les ciseaux, La censure dans le cinéma soviétique du Dégel à la perestroïka, Martine Godet propose la définition suivante de la censure : « C’est un acte de la puissance publique qui a pour objet d’empêcher la diffusion d’une information, d’une pensée ou d’une idée. C’est l’obstacle mis par le pouvoir à la liberté d’expression »10. À cette définition, qui suggère la dimension politique de l’action censoriale, nous ajoutons celle de Daniël Biltereyst et Roel Vande Winkel dans leur ouvrage Silencing cinema : film censorship around the world, car elle rappelle les divers secteurs où la censure peut intervenir au cinéma, mettant en lumière un élément essentiel à prendre en compte : c’est un art qui est aussi une industrie. Les auteurs y décrivent la censure comme « la tentative de gêner ou de limiter la libre expression, création, production, distribution, exploitation et la réception des films »11. Cette dernière définition nous intéresse particulièrement car dans le cadre de notre étude, nous analyserons comment la censure intervenait aux divers moments de la création d’un film, jusqu’à sa sortie en salle. Dans le cas portugais, les études sur la censure au cinéma tendent à se centrer sur la phase de post-production dans la chaîne de confection d’un film, focalisant sur les coupes opérées au moment du montage. Nous verrons comment en réalité la censure intervenait bien plus tôt, et existait dès les premiers temps du processus de production.
Details
- Pages
- 372
- Year
- 2017
- ISBN (PDF)
- 9782807618336
- ISBN (ePUB)
- 9782807618343
- ISBN (MOBI)
- 9782807618350
- ISBN (Softcover)
- 9782807618329
- DOI
- 10.3726/b19211
- Language
- French
- Publication date
- 2022 (March)
- Published
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 372 p., 21 ill. n/b.