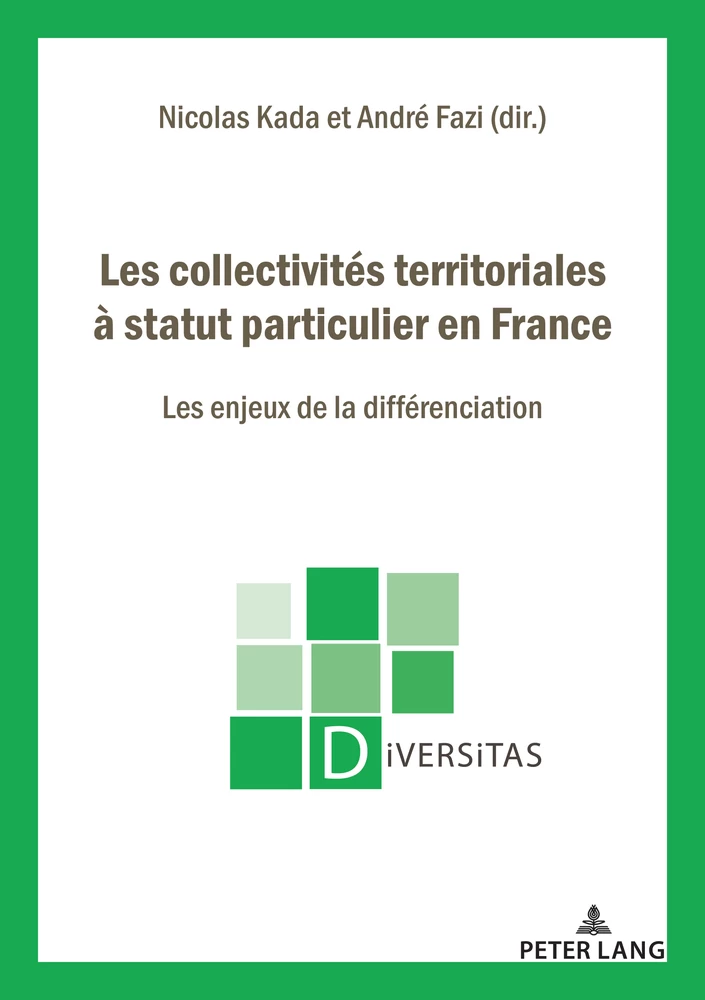Les collectivités territoriales à statut particulier en France
les enjeux de la différenciation
Résumé
Cet ouvrage aborde le développement des statuts particuliers en France à travers une étude globale et systémique. En conjuguant des approches diverses, il permet d’interroger les incidences de ce développement dans une logique non seulement conceptuelle mais aussi d’efficacité administrative et d’intelligibilité sur le plan juridique.
Extrait
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos des directeurs de la publication
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Sommaire
- Liste des Contributeurs
- Introduction (Nicolas Kada, André Fazi)
- Première partie : Fondements et cadres conceptuels
- Particularismes, singularités, spécificités : les mots du droit (Nicolas Kada)
- Ce que dit l’histoire des collectivités à statut particulier (Delphine Espagno-Abadie)
- Les fondements constitutionnels des statuts particuliers (Maylis Douence)
- La différenciation, reconnaissance contemporaine des particularismes territoriaux ? (Florence Crouzatier-Durand)
- Deuxième partie : Mille nuances du particularisme
- Une histoire longue de la spécificité institutionnelle de la Corse (André Fazi)
- La possibilité d’un statut constitutionnel de l’île ? Réflexions sur l’avenir du statut particulier de la Corse (Wanda Mastor)
- Interview de Jean-Louis Santoni, premier directeur général des services de la collectivité de Corse (Par André Fazi)
- La spécificité de la Corse à l’aune des autres statuts particuliers : le cas de la Martinique (Virginie Donier)
- Mayotte : collectivité à statut particulier ou collectivité à statut unique ? (Grégory Marchesini)
- La Collectivité européenne d’Alsace : un département à dispositions particulières (Étienne Schmitt)
- Troisième partie : Collectivités à statut particulier et action publique
- Collectivités à statut particulier et cohésion sociale (Martine Long)
- Collectivités à statut particulier et particularisme culturel (Mylène Le Roux)
- Les statuts particuliers de collectivité territoriale : ordre et liberté ? (Bertrand Faure)
- Titres de la collection
Liste des Contributeurs
André Fazi
maître de conférences en science politique à l’Université de Corse, UMR CNRS 6240 LISA
Nicolas Kada
professeur agrégé de droit public à l’Université Grenoble Alpes, CRJ, codirecteur du Groupement de Recherche sur l’Administration Locale en Europe (Université de Paris I)
Delphine Espagno-Abadie
maître de conférences en droit public à l’Institut d’études politiques de Toulouse, Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP/EA4175)
Maylis Douence
maître de conférences en droit public à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, UMR CNRS 6031 TREE.
Florence Crouzatier-Durand
professeure de droit public à l’Université Côte d’Azur, CERDACFF-GRALE
Wanda Mastor
professeure de droit constitutionnel à l’Université de Toulouse Capitole, Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé.
Virginie Donier
professeure de droit public à l’Université de Toulon, Centre d’Études et de Recherche sur les Contentieux, présidente du conseil scientifique du GRALE.
←11 | 12→Grégory Marchesini
maître de conférences HDR à l’Université de Toulon, Centre d’Études et de Recherches sur les Contentieux, avocat au barreau de Toulon.
Etienne Schmitt
professeur assistant en science politique à l’Université Concordia de Montréal
Martine Long
maître de conférences HDR à l’Université d’Angers, SFR 4201 Confluences, membre du conseil scientifique du GRALE
Mylène Le Roux
professeure de droit public à l’Université de Nantes, UMR CNRS 6297 Droit et Changement Social
Bertrand Faure
professeur de droit public à l’Université de Nantes, UMR CNRS 6297 Droit et Changement Social
Introduction
Nicolas Kada, André Fazi
« Ce qui n'est pas singulier, trouvez-le surprenant !
Ce qui est ordinaire, trouvez-le inexplicable !
Ce qui est habituel doit vous étonner.
Discernez l'abus dans ce qui est la règle
Et là vous avez discerné l'abus
Trouvez le remède ! »
Berthold Brecht, L’exception et la règle, Éditions de l’Arche, 1930.
La règle et l’exception, le général et le particulier, le commun et le dérogatoire… Le droit tout entier est fondé sur cette dialectique et il n’y avait a priori aucune raison que le droit des collectivités territoriales échappe à cette constante. La diversité des territoires de la République, leur histoire, leur culture ou encore leur fonction particulière sont mises en avant pour justifier un traitement différent et donc une réponse juridique adaptée à leurs spécificités. Pourtant, le souci de la pédagogie comme la volonté de reconnaissance d’une sous-discipline juridique à part entière ont tendance à éclipser ces subtilités et à promouvoir l’unité des notions et des catégories de collectivités territoriales. La simplification, la rationalisation, la précipitation parfois aussi aboutissent de ce fait à taire ces particularismes qui rajoutent sans cesse à la complexité du système institutionnel local français.
L’unité de la France s’est construite au prix d’un effort continu pour surmonter ses disparités territoriales. Les révolutionnaires français ont ainsi remplacé les institutions territoriales hétéroclites de l’Ancien régime par un modèle unique valable partout (communes et départements). La création des régions à la fin du XXe siècle s’inscrira dans la même perspective d’une France égalitaire s’opposant à la constitution de puissantes institutions politiques locales. Or, cet ordre imposé résiste mal à l’évolution du temps. Avec la démocratisation de nos institutions ←13 | 14→publiques, les revendications historiques et politiques font retour, et le règne des statuts généraux de droit commun sur tout le territoire est parfois ressenti comme un anachronisme et contesté. Si la France demeure attachée au principe d’unité, l’un des éléments de cette unité réside désormais dans la reconnaissance de statuts particuliers. La Corse en est un cas particulièrement emblématique, considérant que depuis 1982 quatre lois ont modifié le statut de l’île, et qu’une nouvelle évolution est d’ores et déjà discutée.
Ces statuts particuliers favorisent la constitution d’ensembles administratifs plus vastes et permettent de rapprocher des intérêts et des moyens que le morcellement excessif de la France en collectivités de droit commun superposées avait dissociés. Le statut particulier peut être conçu comme un moyen de s’affranchir de la pauvreté de la vie locale, tant l’exiguïté des collectivités de droit commun et la faiblesse des ressources qui lui est corrélative se prêtent mal au développement d’une véritable autonomie locale. Plus généralement, cette montée empirique des statuts particuliers permet d’envisager plus sérieusement la perspective d’une administration territoriale différenciée, plus moderne, au pouvoir et aux moyens plus concentrés, et à l’organisation plus démocratique.
Le colloque qui s’est tenu à l’Université de Corse en septembre 2019 s’inscrit dans le cadre du projet de recherche sur les (dis)continuités juridiques que le premier d’entre nous a engagé (https://discontinu.hypotheses.org/author/discontinu), et embrasse donc une réflexion plus globale relative à la différenciation territoriale. Il a rassemblé nombre de spécialistes du droit des collectivités territoriales mais aussi des praticiens et élus locaux, afin de faire le point sur cette épineuse question des statuts particuliers. À l’aune d’une réforme sur la différenciation qui se voulait initialement ambitieuse mais dont la traduction législative paraît désormais bien plus modeste, il semble en effet utile de faire le jour sur ces spécificités qui caractérisent – voire qui fondent – le droit institutionnel et matériel des collectivités décentralisées.
Cet ouvrage aborde ainsi le développement des statuts particuliers en France à travers une approche globale. Il interroge les incidences de ce développement dans une logique non seulement conceptuelle mais d’efficacité administrative. En conjuguant les réflexions théoriques, les analyses systémiques et les témoignages, il permet d’approfondir le regard sur les évolutions étudiées. Puisse-t-il favoriser demain la construction de synergies entre les différents types d’acteurs.
←14 | 15→Dans une première partie consacrée aux fondements historiques et conceptuels, le premier auteur de ces lignes rappelle les distinctions les plus élémentaires sur le plan sémantique et analyse dans quelle mesure la doctrine et la règle juridique sont parvenues à les retranscrire. Puis Delphine Espagno-Abadie nous propose une approche historique pour mieux comprendre ce que nous disent ces différents statuts particuliers sur la conception même des collectivités territoriales en France. Comme le démontre Maylis Douence, les fondements constitutionnels de ces statuts particuliers sont néanmoins fragiles et n’offrent que des garanties très relatives. Il est dès lors judicieux de s’interroger, avec Florence Crouzatier-Durand, sur l’intérêt juridique que peut offrir la reconnaissance du principe de différenciation territoriale.
La deuxième partie de l’ouvrage inclut plusieurs études de cas de statuts particuliers. Le second auteur de ces lignes l’ouvre en exposant la longue histoire de la spécificité institutionnelle corse, avant que la professeure Wanda Mastor ne poursuive la réflexion autour d’un statut constitutionnel particulier pour l’Île de beauté, en s’appuyant notamment sur des éléments de droit comparé. Suite à ces deux contributions académiques, nous avons choisi de donner la parole à un cadre administratif riche d’une expérience très particulière, puisque Jean-Louis Santoni a conduit le processus de fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux de Corse, puis est devenu en 2018 le premier directeur général des services de la collectivité de Corse. Comme espéré, son regard pragmatique apporte de précieux enseignements et complète utilement les contributions des juristes et politistes.
Les outre-mer, où les particularismes institutionnels trouvent un terrain privilégié, ne pouvaient évidemment être absents de cet ouvrage. Si comparaison n’est pas raison, la professeure Virginie Donier ose dresser un parallèle fort éclairant entre la Corse et la Martinique, avant que Grégory Marchesini ne se penche sur le statut de Mayotte. Revenant en métropole, Étienne Schmitt montre que la toute jeune collectivité européenne d’Alsace relève d’une moindre ambition mais présente des spécificités intéressantes en tant que département à dispositions particulières.
Après la présentation de ces différents cas, la troisième partie est consacrée aux compétences et à l’action des collectivités à statut particulier dans deux grands domaines d’action publique. C’est d’abord Martine Long qui s’intéresse, notamment à travers l’exemple de la Corse, au lien ←15 | 16→étroit entre statuts particuliers et cohésion sociale, avec un État toujours présent et prêt à « reprendre la main ». Ensuite, c’est la professeure Mylène Le Roux qui décline la même approche en matière culturelle, et en conclut que même si le particularisme culturel est toujours favorisé par le particularisme statutaire, il n’est pas systématiquement garanti par lui.
Enfin, la synthèse et la mise en perspective de toutes ces contributions est revenue au professeur Bertrand Faure, qui questionne la place des statuts particuliers de collectivité territoriale dans notre ordre juridique : ceux-ci font-ils exception ou système ? Certainement les deux. Ces statuts présentent tout autant des vertus que des limites, et il reste malaisé de concevoir un droit différencié dans une France historiquement centralisée. Au demeurant, ces mêmes statuts contribuent de plus en plus fortement à la réorganisation de notre droit des collectivités territoriales.
Particularismes, singularités, spécificités : les mots du droit
Nicolas Kada
Résumé des informations
- Pages
- 252
- Année de publication
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9782875744463
- ISBN (ePUB)
- 9782875744470
- ISBN (Broché)
- 9782875744456
- DOI
- 10.3726/b18975
- Langue
- français
- Date de parution
- 2022 (Février)
- Publié
- Bruxelles, Berlin, Bern, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 252 p., 2 tabl.
- Sécurité des produits
- Peter Lang Group AG