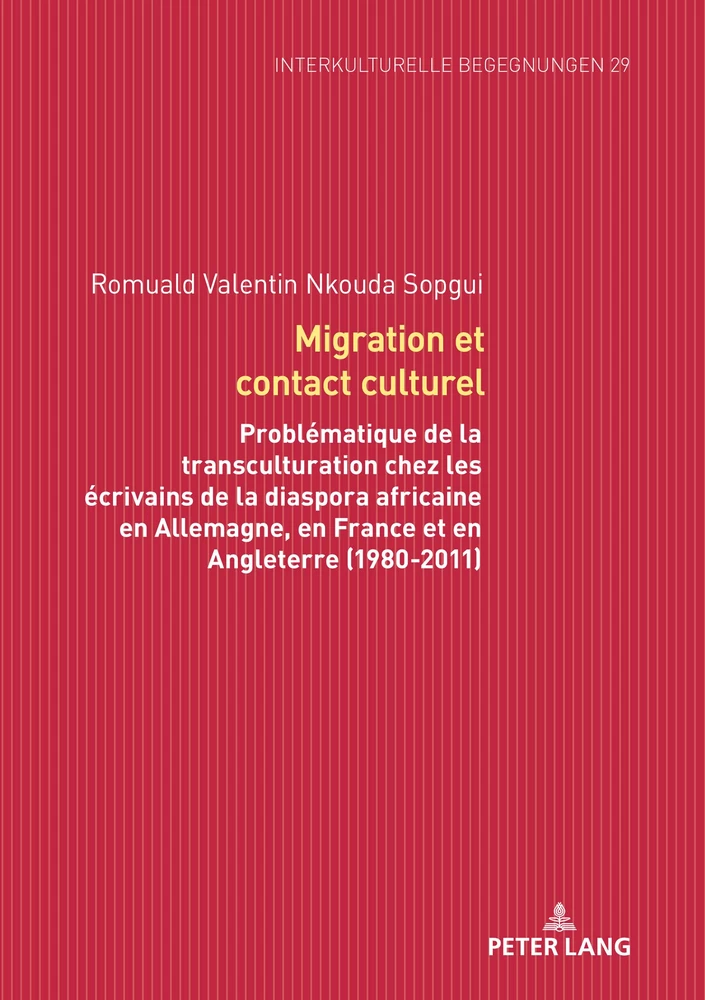Migration et contact culturel
Problématique de la transculturation chez les écrivains de la diaspora africaine en Allemagne, en France et en Angleterre (1980-2011)
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- À propos de l’auteur
- À propos du livre
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Remerciements
- Introduction
- I.1. Objectif de l’étude
- I.2. Délimitation, présentation et justification du corpus
- I.2.1. Délimitation du corpus
- I.2.2. Présentation et justification du corpus
- II. Problématique et hypothèses
- III. Revue de la littérature
- IV. Concepts opératoires et méthodologiques
- V. Structure et organisation
- Chapitre I : Description du pays d’origine et quete de l’ailleurs
- I.1. La description de l’espace d’origine : le malaise
- I.2. La quete de l’ailleurs : la recherche du « paradis »
- Chapitre II : La relation au pays d’accueil : l’intégration du migrant Africain
- II.1. La marginalisation du migrant
- II.2. La « qualification differentielle »
- II.3. La racialisation du corps
- II.4. Stereotype racial et negation des couples mixtes
- II.5. La transgression de l’essentialisme
- II.5.1. La subversion du discours hégémonique
- II.5.2. Le relativisme culturel
- Chapitre III : L’appartenance identitaire en contexte diasporique
- III.1. Évocation nostalgique et memoire du pays d’origine
- III-2. Le retour de l’immigre et la problematique de l’enracinement
- III.3. Parcours migratoire et identite fluide
- III.3.1. Hybridité et identités afropolitaines
- III.4. Bessora et l’expression du metissage
- Chapitre IV : Un espace identitaire transnational
- IV.1. (Re) Decouverte de soi et desappartenance identitaire
- IV.2. Quete de soi et legitimation de l’errance
- Conclusion
- Bibliographie
- 1. Littérature primaire
- 2. Littérature secondaire
- 2.1. Articles
- 2.2. Ouvrages
- 2.2.1. Ouvrages de critique littéraire générale et de critique littéraire africaine
- 2.2.2. Ouvrages en Sciences Humaines et Sociales
- 2.2.3. Ouvrages en migrations et études diasporiques africaines
- 2.3. Sitographie
- Titres de la collection
Remerciements
Qu’il me soit permis d’exprimer mes remerciements à quelques personnes qui ont contribué à l’aboutissement de ce travail. Mes remerciements vont premièrement à l’endroit de Madame Catherine MAZAURIC, pour la confiance qu’elle m’a accordée en acceptant de diriger la thèse, dont cet ouvrage est le condensé, et pour l’avoir suivie, avec un très grand intérêt. Sa rigueur intellectuelle, sa disponibilité, ses remarques, ses critiques et ses encouragements m’ont été précieux pour l’aboutissement de ce travail. Qu’elle trouve ici l’expression de ma gratitude.
J’exprime aussi ma gratitude aux professeurs du CIELAM (Centre Interdisciplinaire d’Etude des Littératures d’Aix-Marseille), en l’occurrence Monsieur Stéphane Lojkine, qui m’avait accueilli au sein du laboratoire en tant que doctorant. Je n’oublie pas Monsieur Alexis Nuselovici et Madame Fridrun Rinner qui ont suivi l’évolution de ma thèse. Nos nombreuses discussions m’ont permis d’en tirer le meilleur pour mon travail. Ma gratitude va également à l’endroit de Madame Ursula Mathis-Moser pour l’intérêt qu’elle a porté envers ce travail.
Cet ouvrage a bénéficié de l’appui financier du CIELAM (Centre Interdisciplinaire d’Etude des Littératures d’Aix-Marseille).
Introduction
I.1. Objectif de l’étude
Depuis les origines, la migration constitue l’une des thématiques fondamentales de la littérature africaine. Les écrivains africains de la première génération ont jeté les bases d’une véritable littérature africaine de migration. Cette première écriture d’immigration, affirme Catherine Mazauric, s’attachait aux différents moments de la confrontation de l’immigré avec la société d’accueil, à ses conditions sociales de vie, à la mise en présence de deux univers culturels et aux adaptations qui en découlaient, aux transformations affectant les différentes générations et plus généralement à une quête identitaire entre le lieu d’origine et l’espace de séjour1. Si la littérature de migration fait partir du discours littéraire d’Afrique francophone depuis les origines, elle a progressivement investi d’autres aires culturelles à l’instar de l’Allemagne et de l’Angleterre donnant naissance à divers champs d’écritures africaines de la migration.
Le présent ouvrage se donne pour objectif d’aborder la littérature africaine de migration à partir de trois aires culturelles : l’Allemagne, la France et l’Angleterre. La thématique de la migration chez les écrivains africains dans ces aires culturelles permet une analyse du processus de transculturation. La transculturation, dans leurs textes, se décline selon diverses modalités. Tout d’abord, elle décrit le passage des personnages africains de l’Afrique vers l’Europe. Ensuite, elle fait ressortir les difficultés d’intégration des migrants africains dans la nouvelle culture. Enfin, elle montre comment les personnages migrants se construisent une identité, qui non seulement, fusionne le pays d’origine et le pays d’accueil, mais qui transcende également, les frontières, les Nations et les cultures. Cette absence d’ancrage identitaire dans un territoire que les personnages immigrés, aux identités indécidables, partagent désormais avec leurs auteurs, affirme Christiane Albert, produit un contre-discours identitaire en rupture avec les discours nationalistes. De cette façon, les romanciers qui inscrivent ←13 | 14→l’immigration au cœur de leurs œuvres participent à une nouvelle étape des littératures […] aux prises avec les questions postcoloniales2.
I.2. Délimitation, présentation et justification du corpus
I.2.1. Délimitation du corpus
Les textes retenus dans le cadre de cette étude sont : Unter die Deutschen gefallen (1992) de Chima Oji, Die Farbe meines Gesichts (1999) de Miriam Kwalanda et Birgit Theresa Koch, Ich bin ein Black Berliner (2006) de Jones Kwesi Evans, Das afrikanische Auge (2008) de Luc Degla et Les étrangers noirs africains (2011) de Hilaire Mbakop dans l’espace germanophone ; 53cm (1999) de Sandrine Bessora, Le Ventre de l’Atlantique (2003) de Fatou Diome , A la vitesse d’un baiser sur la peau (2007) de Gaston Paul Effa et Je vois du soleil dans tes yeux (2008) de Nathalie Etoke ; dans l’espace francophone ; Pilgrims Way (1988) d’Abdulrazak Gurnah et The New Tribe (2000) de Buchi Emecheta pour ce qui est de l’espace anglo-saxon. Il convient tout d’abord de présenter les romans.
I.2.2. Présentation et justification du corpus
Publié en 1992, Unter die Deutschen gefallen3 relate les mésaventures d’un Nigérian qui émigre de son pays natal à la suite d’une guerre civile. Après une escale en Angleterre, le narrateur autobiographique se retrouve à Münster en Allemagne pour des études de médecine. Parlant parfaitement allemand, il travaille dans différents hôpitaux. Toutefois, son épanouissement dans l’espace d’accueil est difficile à cause de ses origines africaines. Dès lors, commence pour lui une lutte acharnée pour s’intégrer dans la société hôte en dépit de la discrimination raciale dont il est victime. Ce faisant, il entretient une relation avec Barbara, une Allemande de famille conservatrice. Aux yeux de tous, cette relation, qui débouche sur la naissance de trois enfants n’a pas sa raison d’être au regard des divergences ←14 | 15→culturelles. Ne pouvant plus supporter le calvaire de la vie en Allemagne, le héros décide de retourner dans son pays d’origine.
Fruit d’une coproduction germano-africaine, Die Farbe meines Gesichts4 est un roman autobiographique publié en 1999 par l’écrivaine kenyane Miriam Kwalanda et l’Allemande Birgit Theresa Koch. Le roman décrit les pérégrinations de Miriam, l’héroïne du roman, depuis son enfance à Kagamena, son village natal, jusqu’à son voyage et son séjour en Allemagne suite à son mariage avec un touriste allemand qu’elle a rencontré à Mombassa lorsqu’elle se prostituait. Immigré en Allemagne, Miriam croit avoir réalisé son rêve lorsqu’elle se heurte avec amertume aux dures réalités de la vie en Allemagne. Non seulement, elle découvre la face cachée de son époux, mais elle est aussi victime de racisme au quotidien. Malgré le divorce, elle s’entête à rester en Allemagne afin de poursuivre son émancipation.
Details
- Pages
- 148
- Publication Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631860069
- ISBN (ePUB)
- 9783631860076
- ISBN (MOBI)
- 9783631860083
- ISBN (Hardcover)
- 9783631850619
- DOI
- 10.3726/b19061
- Language
- French
- Publication date
- 2021 (October)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 148 p.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG