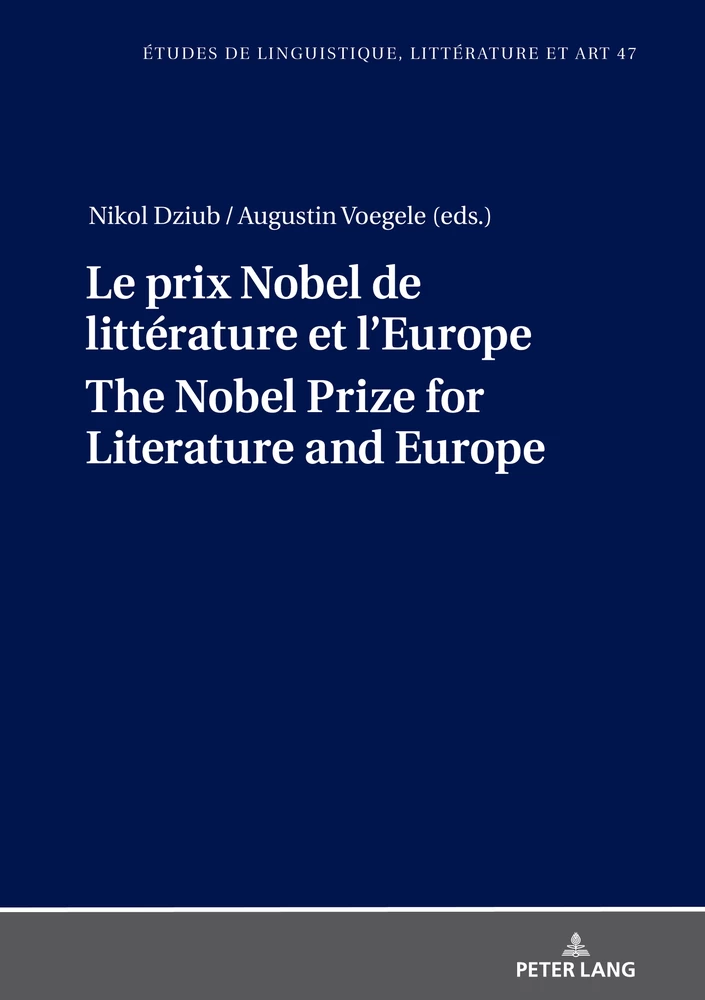Le prix Nobel de littérature et l’Europe The Nobel Prize for Literature and Europe
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Table des matières
- Liste des contributeurs
- Valeur(s) du Nobel. Introduction (Nikol Dziub et Augustin Voegele)
- Alfred Nobel : les volontés d’un citoyen du monde – et ce qui en est advenu (Jean-François Battail)
- Le prix Nobel et la littérature : définitions, indécisions, inflexions (Emmanuel Fraisse)
- Le prix Nobel de littérature et l’Europe : du mirage à l’idéal. Réflexions sur un vieux rêve de la littérature européenne (Pascal Dethurens)
- Thomas Mann as Nobel Prize Winner and his Way to European Thought (Katrin Bedenig)
- Hermann Hesse et l’idée d’Europe (Régine Battiston)
- Qu’est-ce qu’un prix Nobel ? André Gide vu par ses correspondants (automne 1947–printemps 1948) (Augustin Voegele)
- Latin American Nobel Prize Laureates and Europe (Angelica Duran)
- « You Should Just Be Proud ! » A Nobel Farce (Mihaela Ursa)
- Les effets du prix Nobel sur la trajectoire de Patrick Modiano dans le champ littéraire (Clara Lévy)
- Légitimité littéraire et musique populaire : les débats, en Suède, concernant l’attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan (Roger Marmus)
- Nobel versus Oscars : A Comparative Analysis of Cultural Appreciation and Relevance (Doru Pop)
- Conclusion. Le Nobel à l’épreuve du XXIe siècle (Nikol Dziub et Augustin Voegele)
- Index des noms de personnes
- Reihenübersicht
Jean-François Battail
Sorbonne Université
Régine Battiston
Université de Haute-Alsace
Katrin Bedenig
ETH Zürich
Pascal Dethurens
Université de Strasbourg
Angelica Duran
Purdue University
Nikol Dziub
Université de Haute-Alsace
Emmanuel Fraisse
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Clara Lévy
Université Paris 8
Roger Marmus
Sorbonne Université – Paris 4
Doru Pop
Babeş-Bolyai University, Cluj
Mihaela Ursa
Babeş-Bolyai University, Cluj
Augustin Voegele
Université de Haute-Alsace
Nikol Dziub et Augustin Voegele
Valeur(s) du Nobel. Introduction
Résumé : Ce qui constitue l’épine dorsale de ce volume, c’est la question des valeurs qui d’une part président au choix des lauréats du prix Nobel de littérature, et d’autre part fondent, du point de vue de l’économie de la culture, la légitimité du Nobel de littérature en tant qu’institution prétendant définir des ordres et des hiérarchies. Or ces valeurs semblent intimement liées à celles qui structurent un idéal européiste qui, sous une forme géographiquement élargie, demeure bien vivant aujourd’hui dans les discours officiels.
Mots-clés : prix Nobel de littérature, valeurs, économie de la culture, institutions littéraires, Europe.
Abstract : What constitutes the backbone of this volume is the question of the values which, on the one hand, preside over the choice of the winners of the Nobel Prize for Literature, and on the other hand, from the point of view of the economy of culture, underlie the legitimacy of the Nobel Prize for Literature as an institution which claims to define cultural hierarchies. These values seem to be intimately linked to those that structure a Europeanist ideal which, in a geographically enlarged form, remains very much alive today in official discourse.
Keywords : Nobel Prize for Literature, values, economy of culture, literary institutions, Europe.
En juin 2017, l’Institut de recherche en Langues et Littératures Européennes (ILLE, UR 4363, Université de Haute-Alsace) invitait à Mulhouse, à l’occasion d’un colloque intitulé « Comparer en Europe », des comparatistes de plus de vingt-cinq pays européens et nord-américains, de l’Allemagne à l’Ukraine en passant entre autres par l’Autriche, la Belgique, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, la Suisse, ou encore la Roumanie. La question Nobel ne faisait pas partie des axes prévus par les organisateurs, mais elle s’est invitée d’elle-même dans les débats : l’un des constats forts qui ont pu être faits au cours du colloque, c’est que, pour les littératures dites « mineures » (les guillemets s’imposent), ←9 | 10→l’attribution d’un prix comme le Nobel fonctionne presque comme un acte de naissance, au moins du point de vue institutionnel. Le cas du Polonais Czesław Miłosz, lauréat en 1980, est à cet égard archétypal : en tant que prix Nobel, ce dernier a été, plus encore qu’un ambassadeur, presque une sorte d’incarnation ou de réincarnation de la littérature polonaise qui renaissait de ses cendres (institutionnelles, encore une fois), et qui retrouvait sa place dans le « tissu » de « connexions » culturelles dont Miłosz fait justement l’éloge dans Rodzinna Europa (littéralement L’Europe familière, texte publié en 1959).
Un autre cas qui avait été au cœur des discussions était celui d’Herta Müller. La grande question de départ était celle-ci : faut-il considérer que le prix Nobel est revenu, en 2009, à une écrivaine allemande d’origine roumaine, ou à une écrivaine roumaine germanophone (et dont l’allemand est fortement teinté de roumanité) ? Mais cette question a vite été dépassée, pour laisser la place aux questions théoriques que justement elle suscitait : est-il encore pertinent de penser la carte des littératures européennes et mondiales en termes de nationalités d’une part, d’aires linguistiques homogènes d’autre part ? Ne faudrait-il pas créer des cartes en quelque sorte stratifiées, où les différents critères de cartographie se superposeraient, en transparence ? Et puis, autre question – et c’est celle-là qui a donné naissance au colloque organisé à Mulhouse en juin 2019 dont ce volume est une émanation (sans en constituer à proprement parler les actes) : quel rôle jouent les institutions de la littérature, et en particulier les institutions supranationales comme le Nobel, dans la cristallisation, ou en tout cas dans l’émergence de ces nouvelles littératures, de ces littératures à cheval sur plusieurs aires culturelles, nationales, linguistiques, de ces littératures qui sont difficilement catégorisables, et qui pourtant ont une valeur catégorielle ? D’où aussi cette question plus simple : à quoi ressemble aujourd’hui la carte des littératures européennes que l’attribution du prix Nobel de littérature redessine chaque année ? Et par ailleurs, y a-t-il un lien entre la vision de l’Europe (et de l’Europe littéraire en particulier) qui préside à l’attribution du Nobel, et la vision que le récipiendaire a lui-même de l’Europe – notamment quand il s’agit d’un récipiendaire européen ?
Mais qu’est-ce qu’un récipiendaire européen ? Où sont situées les frontières culturelles de l’Europe, ou les frontières de l’Europe culturelle et littéraire ? Peut-on considérer par exemple Orhan Pamuk (lauréat en ←10 | 11→2006) comme un Nobel européen ? La même question se pose pour Svetlana Aleksievitch, récipiendaire du prix en 2015 : où situer par rapport à l’Europe culturelle et à l’Europe littéraire cette écrivaine biélorusso-ukrainienne russophone ? Et l’on pourrait aussi débattre autour du cas « transcontinental » de Mario Vargas Llosa (2010), prix Nobel hispano-péruvien ; sans oublier Gao Xingjian (2000), Nobel sino-français.
Ce ne sont donc pas les questions qui manquent quand on aborde le sujet des rapports entre les choix du « jury Nobel » et un supposé « esprit européen » (pour ne pas parler d’« idéal européiste »). Et la première question, la question originelle, est celle de l’idée que Nobel lui-même se faisait des futurs lauréats de son prix : c’est précisément le point central de la contribution de Jean-François Battail, « Alfred Nobel : les volontés d’un citoyen du monde – et ce qui en est advenu ». Qu’est-ce que cette « tendance idéaliste » que Nobel souhaitait voir récompenser en littérature ? Sans doute pas ce qu’en a fait Carl David af Wirsén, qui présida au choix des premiers lauréats : une hypostase du conformisme et de la bien-pensance « bigote ». Jean-François Battail rappelle que Nobel (qui fut, entre autres, l’auteur d’une tragédie intitulée Nemesis, si « scandaleuse » qu’elle fut « mise au pilon » par ses ayants droit), s’il était « discret dans la vie », était « rebelle en son for intérieur, à l’égard des conventions, de l’ordre établi, de l’injustice omniprésente, de la dictature des prêtres » – un vrai « libre-penseur » en somme. D’où – et l’on oublie trop souvent le caractère presque téméraire de ce geste en une époque où la logique nationale était encore trop rarement dépassée – sa décision de fonder une série de prix « internationaux » dont l’attribution devait se faire sans distinction de nationalité : s’il peut être abusif de parler d’un « européisme » originel du prix Nobel, ce qui ne fait pas de doute, c’est que Nobel pensait à l’échelle continentale, voire mondiale.
S’il peut être difficile, de nos jours encore, de comprendre ce que Nobel entendait par « tendance idéaliste », il convient aussi de se demander ce qu’il faut entendre par « littérature » : rappelons que, de l’historien Theodor Mommsen (1902) au chanteur Bob Dylan (2016) en passant (entre autres) par les philosophes Henri Bergson (1927) et Bertrand Russell (1950), ou encore par l’homme de théâtre Dario Fo (1997), les lauréats « non littéraires » ne sont pas rares. Comme le note Emmanuel Fraisse dans son article (« Le prix Nobel et la littérature : définitions, indécisions, ←11 | 12→inflexions »), l’histoire du Nobel est celle d’une progressive « ouverture au complexe » : non seulement les continents trop longtemps « oubliés » (l’Asie et l’Afrique notamment) sont peu à peu reconnus ; mais en outre, les auteurs à cheval sur plusieurs aires culturelles ou disciplinaires semblent presque constituer, depuis deux décennies, l’archétype du prix Nobel de littérature : en somme, « c’est dans la mesure de sa capacité à reconnaître et consacrer la complexité, la multiplicité, l’hétérogénéité que le prix Nobel tend à devenir un prix universel ».
Mais l’Europe et le monde du prix Nobel de littérature, ce n’est pas seulement l’Europe et le monde vus par l’« Académie Nobel » : c’est aussi, d’abord et surtout l’Europe et le monde vus par les lauréats du Nobel. Pascal Dethurens, ainsi, nous propose de réfléchir sur l’Europe des Nobels comme « mirage » puis comme « idéal ». Certes, il rappelle que les lauréats du prix sont loin d’être toujours des zélateurs de l’Europe : il cite en particulier les cas « de Cela ([lauréat] en 1989), de Saramago (en 1998) ou de Jelinek (en 2004) », trois auteurs pour le moins sceptiques à l’égard de l’Europe telle qu’elle a pu être conçue et construite institutionnellement (et économiquement) dans les dernières décennies. Mais il n’en demeure pas moins qui, si ces auteurs dénigrent parfois l’Europe telle qu’elle va, c’est au nom d’une Europe meilleure, fantasmée sinon à proprement parler idéale ; et que, si « l’Europe d’Auschwitz n’est pas celle de Sarajevo, [ni] celle de Verdun […] celle de Tchernobyl », les Nobels de l’époque moderne puis post, hyper et épi-moderne1 sont unis par la conscience de vivre dans une Europe et dans un monde qui n’ont « jamais été aussi fragile[s]; ».
On ne saurait d’ailleurs, sans caricature, séparer les écrivains européistes des écrivains « ennemis de l’Europe ». Le cas de Thomas Mann, étudié par Katrin Bedenig, est particulièrement éloquent : d’abord virulemment nationaliste, et partisan, même, de la guerre, Thomas Mann deviendra, dans l’entre-deux-guerres, l’incarnation même d’une ouverture à l’Europe synonyme de trahison aux yeux du nationalisme impérialiste du Troisième Reich. Il n’est que de se rappeler les méditations de Settembrini dans La ←12 | 13→Montagne magique pour se convaincre que l’Europe du « deuxième Thomas Mann » est celle d’un idéal de progrès moral perpétuel :
Details
- Pages
- 210
- Publication Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631842591
- ISBN (ePUB)
- 9783631842607
- ISBN (MOBI)
- 9783631842614
- ISBN (Hardcover)
- 9783631841822
- DOI
- 10.3726/b18346
- Language
- English
- Publication date
- 2021 (November)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. 210 pp., 2 tables.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG