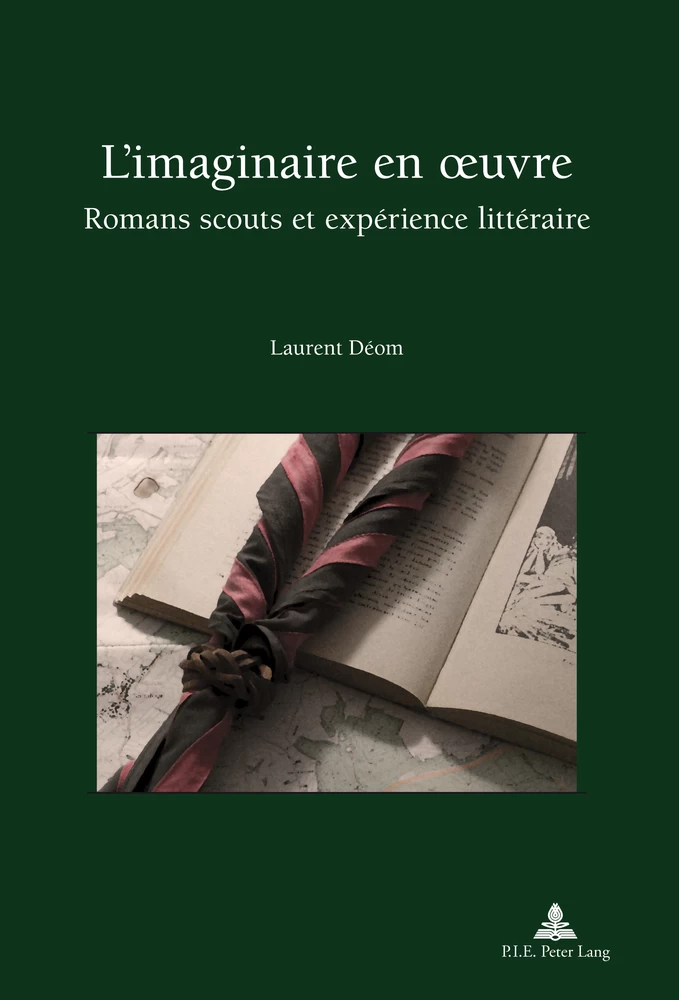L’imaginaire en œuvre
Romans scouts et expérience littéraire
Summary
Un texte littéraire – avec ses thèmes, ses structures narratives, son usage spécifique de la langue – est une interpellation. Certains lecteurs, en raison du contexte socio-historique et psychique dans lequel ils sont immergés, sont disposés à s’imprégner, d’une façon forte et durable, des imaginaires que le livre déploie. On peut ainsi analyser comment l’expérience esthétique articule des stratégies discursives et des effets émotionnels.
En raison du succès considérable qu’il a rencontré, le roman scout en français offre, à cet égard, un champ d’investigation éclairant. La collection « Signe de piste », en particulier, a suscité l’enthousiasme de nombreux lecteurs, pour des raisons qui n’ont été que partiellement élucidées jusqu’à présent et que l’on met ici en lumière sous un angle nouveau, à partir des œuvres de Serge Dalens, de Jean-Louis Foncine, d’X. B. Leprince, de Jean Valbert et de Maurice Vauthier. Cette étude s’attache notamment à analyser la construction d’une dynamique initiatique dans laquelle les romans sont capables d’entraîner le lecteur, qui est ainsi invité à adopter un rapport au monde renouvelé.
Excerpt
Table Of Contents
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Sur l’auteur
- À propos du livre
- Dédicace
- Pour référencer cet eBook
- Table des matières
- Avant-propos
- Introduction
- Première Partie. Du désordre à l’Âge d’or
- Chapitre I. Du désordre à la mise en ordre
- A. L’inordinatio ou le désordre du monde
- 1. Inordinatio et récit
- 2. Inordinatio et Histoire
- B. L’opposition radicale au désordre
- 1. Structures « héroïques »
- 2. Structures « mystiques »
- C. La formule « synthétique » des romans scouts
- 1. Sphère collective : la réconciliation
- 2. Sphère duelle : l’amitié narcissique
- 3. Sphère individuelle : l’androgynie
- Chapitre II. Temps, décadence et récit
- A. La rupture de l’Histoire
- 1. Temps et décadence
- 2. La contestation des figures d’autorité
- B. Le salut par le récit
- 1. La jeunesse, entre passé et avenir
- 2. Une conception « synthétique » du temps
- Seconde partie. La lecture comme initiation
- Chapitre I. L’initiation dans le texte
- A. Questions de méthode
- 1. Jalons pour une anthropologie de l’initiation
- 2. L’initiation dans la littérature
- B. Des romans initiatiques
- 1. Le Foulard de sang
- 2. Jimmy
- Chapitre II. L’initiation par le texte
- A. Le héros comme substitut du lecteur
- 1. Deux procédés de substitution
- 2. L’entrecroisement de la réalité et de la feintise
- B. L’auteur comme mystagogue
- 1. Le verbe créateur : l’exemple de Jean-Louis Foncine
- 2. Une figure positive d’autorité
- 3. La préface comme aire transitionnelle
- C. L’expérience du numineux
- 1. Poétique du mystère
- 2. Esthétique du sublime
- 3. La prolifération sensorielle
- 4. Coda : vers une pragmatique de l’affectif
- Conclusion
- Annexes
- Bibliographie
- Index
- « Recherches comparatives sur les livres et le multimédia d’enfance »
← 10 | 11 → Avant-propos
En 2007, nous soutenions la thèse qui est à l’origine de ce livre, dont les urgences de la vie universitaire ont, depuis, différé la publication. Nous la présentons aujourd’hui assortie de modifications légères, renonçant à l’actualisation systématique qui en aurait retardé encore la parution. On y trouvera donc peu de références théoriques ou critiques postérieures à 2007, mais on y verra une étape significative de notre réflexion, qui ne se prétendait ni exhaustive, ni définitive.
Au seuil de cet ouvrage, qu’il nous soit permis d’exprimer toute notre gratitude à Georges Jacques, qui a suivi avec bienveillance les premiers pas de nos travaux, ainsi qu’à Jean-Louis Tilleuil et à Myriam Watthee-Delmotte, qui nous ont guidé ensuite avec sûreté. Nos remerciements vont aussi à Christian Chelebourg et à Francis Marcoin, qui ont bien voulu évaluer le résultat de nos recherches. Merci enfin à Céline Drèze et à Jérémy Lambert pour leur relecture patiente et attentive.
← 12 | 13 → Introduction
Dans les livres les plus nobles, nous sommes touchés par quelque chose de semblable aux émotions de la vie. Et cette émotion peut être très diversement provoquée. […] Non seulement l’amour, et les champs, et la face étincelante du danger, mais le sacrifice, la mort et la souffrance imméritée humblement supportée, touchent en nous la veine poétique. Nous aimons y penser, nous rêvons de les essayer, nous espérons humblement, nous révéler, nous aussi, des héros1.
Par ces mots que l’on pourrait commenter à l’envi, Stevenson indique le lien qui unit étroitement la littérature et la vie, par le biais de la lecture. Ainsi, la littérature n’est pas qu’un jeu formel vaguement autotélique. Elle n’est pas non plus le lieu où s’exprimerait seulement la singularité d’un auteur. Elle est aussi, pour de nombreux lecteurs, l’occasion d’une aventure au dénouement incertain, qui, parfois, marque profondément la conscience et peut déterminer l’existence. Un tel phénomène ne naît pas ex nihilo. Avec François Flahaut, nous pensons que, « si tant d’êtres humains prennent plaisir à tels ou tels récits, si tant de générations les ont ressassés, c’est que ceux-ci font écho à quelque chose de nous2 ». Mais quels ressorts profonds ces récits font-ils jouer ?
La littérature de jeunesse est particulièrement propice à ce genre de questionnement : étant donné qu’elle vise en premier lieu un public d’enfants ou d’adolescents, dont on considère qu’ils doivent être éduqués (quels que soient les contenus et les méthodes que l’on assigne à cette éducation), il est utile de connaître les mécanismes littéraires (entre autres) qui peuvent influer sur leurs pensées ou leurs comportements. Le succès de certaines œuvres destinées à la jeunesse a d’ailleurs motivé, ces dernières années, des études visant à expliquer cet engouement, comme le montre le titre d’un ouvrage d’Isabelle Smadja, Harry Potter. Les raisons d’un succès3. En réalité, celle-ci précise, dès le début de son introduction, l’objet de ses recherches : « Non pas tant […] les raisons du succès – car il y a des succès immérités – que les raisons du charme ou de l’ensorcellement4. » Certes, il est possible de prendre distance par rapport à ce ← 13 | 14 → type de démarche, qui, selon certains, chercherait des raisons profondes quand il suffirait de mettre en exergue les logiques économiques5. Nous restons cependant convaincu que la littérature n’est pas que le produit des lois du marché, mais qu’elle mobilise un certain nombre d’enjeux anthropologiques qui, tout en intégrant la dimension économique, ne se réduisent pas à elle.
Il est une autre tentation réductrice qui menace la recherche en littérature de jeunesse : privilégier les productions les plus récentes (afin, peut-être, de rester en phase avec les mouvements du paysage éditorial et les préoccupations supposées du public)6. Cette tendance est encouragée par l’optique méthodologique de certains critiques, qui, consciemment ou non, relèguent la littérature à une place secondaire, comme nous le montrerons plus loin. Les enjeux pédagogiques et sociaux – que nous sommes loin de rejeter, cela va sans dire – prennent alors le pas sur l’œuvre en tant que telle, au point que celle-ci semble ne plus tenir lieu que de prétexte à des analyses utilitaristes. L’intérêt offert par de pareilles orientations ne doit pas occulter leur caractère partiel. En effet, si la recherche a pour finalité de mettre au jour du sens, elle ne peut se permettre de ne trouver celui-ci que dans l’immédiateté, sous peine de se heurter à deux écueils solidaires : d’une part, l’impossibilité de saisir les mouvements de fond qui transcendent les cloisonnements chronologiques ; d’autre part, la privation de toute possibilité de comparaison diachronique, laquelle donne pourtant l’occasion de replacer le présent dans une perspective plus vaste qui contribue à lui conférer toute sa signification. On remarquera encore que la valorisation d’une certaine conscience historique pourrait être mise à l’ordre du jour d’un projet de société global, dans la mesure où, en montrant l’inscription dans le fil des générations, elle permet de créer du lien (social – intergénérationnel notamment), de façon sans doute plus profonde et plus constructive qu’une focalisation exclusive sur un présent qui n’offre pas nécessairement lui-même les solutions aux problèmes qu’il pose.
Il ne serait cependant pas juste de réduire le paysage de la recherche à ces préoccupations exclusivement contemporaines. Dans un article ← 14 | 15 → publié en 1999, Jean Perrot établissait un panorama des études en littérature de jeunesse dans lequel il indiquait entre autres la dimension historique de certains travaux. Ainsi les noms de Jean Glénisson, Catherine Velay-Vallantin, Ségolène Le Men, Isabelle Nières-Chevrel, Marie-France Doray, Guillemette Tison ou Christa Ilef-Delahaye7, par exemple, peuvent-ils être associés à ce type de recherches, de même que celui de Francis Marcoin, qui a beaucoup étudié le XIXe siècle et lui a consacré un certain nombre de numéros de la revue qu’il dirige à l’Université d’Artois, les Cahiers Robinson. Les travaux de ces chercheurs ont permis de mieux connaître la production pour la jeunesse jusqu’au XIXe siècle inclus, mais il reste une tâche importante à accomplir pour les premières décennies du XXe siècle, même si des études comme celle d’Annie Renonciat8, touchant aux années 1920, se sont engagées dans cette voie9.
Les romans scouts
C’est pour répondre à cette carence que nous avons choisi d’aborder des romans publiés entre les années 1930 et la fin du XXe siècle (et plus précisément, pour un grand nombre d’entre eux, entre les années 1930 et les années 1960), et de nous intéresser à l’un des phénomènes les plus remarquables de cette époque, celui du « roman scout ».
Apparemment limpide, cette dernière étiquette pose pourtant problème, car il est difficile de savoir quelle valeur accorder à l’adjectif qu’elle contient. On saisira évidemment son rapport avec le scoutisme, cette méthode d’éducation inventée par Robert Baden-Powell et mise en pratique à partir de 1907, mais on risque de rester perplexe devant la place occupée par le scoutisme dans les ouvrages en question. La définition proposée par le Comité pour la promotion du scoutisme en Europe (Copse) permet de dissiper quelque peu le flou qui entoure cette notion : « Le roman scout est un roman dans lequel le ou les principaux personnages sont scouts, qui se déroule dans un cadre scout ou dans lequel le scoutisme joue un rôle déterminant10. » On précisera que, de ces trois critères, le premier est ← 15 | 16 → sans aucun doute le plus déterminant, étant donné que les deux autres lui sont subordonnés : le « cadre scout » implique en principe la présence de personnages scouts, de même que le « rôle déterminant » joué par le scoutisme est difficilement concevable sans de tels protagonistes11.
Le roman scout occupe une place non négligeable dans l’histoire de la littérature de jeunesse de la France du XXe siècle. Jean Perrot estime ainsi que « l’érosion du prestige du roman scolaire s’est effectuée d’abord sous l’influence du cinéma et du roman scout12 ». Ce dernier apparaît dans le paysage éditorial français dès 1913, avec la publication de Jack l’éclaireur, de Paul Zimmermann, dans la collection « Livres roses pour la jeunesse » (Larousse), de même qu’avec celle de trois autres romans parus en fascicules ou dans des périodiques : Le Défi d’un boy-scout du colonel Royet (publié dans Le Journal des voyages), Les Trois Boy-Scouts de Jean de La Hire (paru en fascicules chez Ferenczi) et Les Aventures de trois boy-scouts d’Arnould Galopin (édité par Albin Michel dans son hebdomadaire Le Boy-Scout)13. Bien que plusieurs romans scouts soient publiés de façon isolée, on peut mettre en évidence le rôle joué par certaines collections, qui, quoiqu’elles ne soient pas spécialisées dans le domaine du scoutisme, accueillent en leur sein plusieurs romans scouts. C’est le cas des « Livres roses pour la jeunesse » (Larousse), du « Livre d’aventures » (Tallandier) ou de la collection « Des fleurs et des fruits » (Spes), de même que de « Belle Humeur » (Desclée de Brouwer) – dans laquelle paraissent notamment les récits du père Albert Hublet –, du « Rameau vert » (Casterman) ou de « Jeunes de France » (Dumas), cette dernière étant dirigée par Dachs (pseudonyme de Jean Busson), lui-même auteur de plusieurs romans scouts. Il existe également un certain nombre de collections spécialement dédiées au scoutisme. La collection « Le Feu de camp » (de Gigord), « qui apparaît en 1933, est la première, en France, à se définir comme collection de “Romans Scouts” ; les directeurs étaient d’ailleurs deux Commissaires au Quartier Général des “Scouts de France” : André Noël et Maurice de Lansaye (qui a signé plusieurs ← 16 | 17 → titres sous le nom de Jacques Michel)14 » ; elle compte un peu plus de vingt titres, publiés entre 1933 et 1955. On peut citer aussi la collection « Autour du feu » (Casterman), « fort mal connue en France (à tel point que l’on peut se demander si elle y a été vraiment distribuée), éditée dans un format de “poche” (10 x 14,5 cm), qui s’adressait, indubitablement, au public scout, même si elle ne comporte que trois romans scouts “stricto sensu” […]15 », de même que « L’Équipée » (Éditions de l’Arc), née dans le sillage du jamboree de Moisson (1947), et qui, durant sa brève existence (de 1947 à 1949), publia dix volumes, dont tous peuvent être considérés comme des romans scouts. Ces collections demeurent toutefois assez marginales, en regard des deux grandes collections de romans scouts que sont « Jamboree » et, surtout, « Signe de piste ».
La collection « Signe de piste »
Éditée par Spes entre 1952 et 1963, la collection « Jamboree » compte soixante-six titres, dont quatorze romans scouts correspondant à la définition proposée par le Copse, et dix romans dans lesquels le scoutisme joue un rôle (bien qu’ils ne puissent être considérés comme des romans scouts proprement dits)16. Mais c’est surtout la collection « Signe de piste » qui retiendra notre attention, car son extension, sa diffusion et sa longévité sont sans égales dans l’édition de romans scouts en langue française.
Née en 1937 dans le giron des éditions Alsatia, la collection est placée sous la direction de Jacques Michel et est inaugurée par un roman de Georges Cerbelaud-Salagnac, Sous le signe de la tortue, suivi du Tigre et sa Panthère de Guy de Larigaudie et, la même année, du Bracelet de vermeil de Serge Dalens. En 1956, alors que Serge Dalens et Jean-Louis Foncine en assurent conjointement la direction littéraire depuis deux ans, elle compte près de cent titres publiés, dont quatre-vingts sont toujours réédités à ce moment-là, pour un total d’exemplaires vendus estimé entre 2 800 000 et 3 000 00017, et des tirages dépassant les 100 000 exemplaires pour certains romans (principalement de Dalens et de Foncine) – contre 50 000 pour les meilleurs chiffres avancés à la même époque par les Éditions de l’Amitié18. Selon Jean Perrot, ces succès « ne seront égalés et ← 17 | 18 → dépassés que par ceux des séries Hachette, dont le modèle est Enid Blyton avec son célèbre Club des Cinq […]19 ».
En dépit de cette audience, le « Signe de piste », dirigé de 1960 à 1971 par Foncine seul, connaîtra un parcours assez mouvementé durant les décennies qui suivront. En 1971, Alsatia entreprend un partenariat avec Hachette pour la diffusion de ses ouvrages, et « Signe de piste » devient « Safari - Signe de piste ». « Les années 1971, 72 et 73 marquèrent de nouveaux succès avec le retour à des chiffres de vente avoisinant les 300 000 exemplaires par an sous le nouveau sigle, tandis que les anciens volumes étaient soldés par les libraires […]. À cette époque, Serge Dalens était devenu le seul directeur du Safari - Signe de Piste alors que Foncine avait été envoyé à Belfort pour assurer le sauvetage d’une succursale d’Alsatia en grosse difficulté de gestion20. » Cette formule durera seulement jusqu’en 1974. L’année suivante, en raison, selon Louis Fontaine, du départ de Bernard de Fallois de chez Hachette, ainsi qu’à cause de dissensions personnelles21, les éditions Épi reprennent la collection, qui devient « Le Nouveau Signe de piste ». Ensuite, alors qu’Alsatia reste propriétaire du logo de la collection, les éditeurs se succéderont : Desclée de Brouwer (1979), puis les Éditions universitaires (1981), qui choisissent Alain Gout comme directeur de collection ; celles-ci sont « rachetées en 1987 par Begedis-Mediadis dépendant du groupe Ampère qui, en 1988, devient le groupe Médias Participations22 ». Au début des années 1990, ce sont les éditions Fleurus, dépendant également du groupe Ampère, qui reprennent la collection. « Après renouvellement des contrats et rachat du sigle Signe de Piste à Alsatia, un nouveau départ semblait être donné dès 199223. »
Malgré les espoirs des anciens directeurs de la collection, de certains auteurs ainsi que des lecteurs les plus fidèles, le renouveau attendu ne se produira pas, Fleurus investissant apparemment peu d’énergie dans ← 18 | 19 → la promotion du « Signe de piste »24. Cette inactivité n’empêchera pas plusieurs éditeurs de reprendre d’anciens titres de la collection dont ils auraient obtenu les droits : les éditions Alain Gout ont publié dans leur collection « Coureurs d’aventures » (entre 1999 et 2002) près d’une quarantaine de titres initialement parus au « Signe de piste » (des romans de Michel Bouts, Jean-Louis Dubreuil, Mik Fondal, Pierre Labat, Jean Valbert, etc.), la collection « Défi » (Téqui) a réédité Le Trésor de la Sonora de Jean-Louis Foncine, plusieurs reparutions ont été assurées par la collection « Les Jeux de l’aventure » des éditions Élor (des romans de Michel Bouts, Georges Cerbelaud-Salagnac, Serge Dalens et Louis Simon, Jean Valbert, etc.), « Totem », aux éditions du Triomphe, republie depuis 1995 Pierre-André Bernard, Mik Fondal, Maurice Vauthier, tandis que les éditions Delahaye et leur collection « S2P » (dirigée par Alain Gout) ont repris Le Tigre et sa Panthère de Guy de Larigaudie et Le Glaive de Cologne de Jean-Louis Foncine. Ce sont les mêmes éditions Delahaye qui, depuis 2007, sont propriétaires de la marque « Signe de piste ». Malgré cette pérennité objective, il faut reconnaître que ces ouvrages sont souvent diffusés de façon restreinte, les éditeurs étant contraints de miser sur la vente par correspondance ou par l’intermédiaire de librairies spécialisées (en particulier certaines librairies religieuses) plutôt que sur une présence régulière dans les librairies les plus fréquentées.
Sans doute ces difficultés, ajoutées à la disparition progressive des auteurs phares de la collection, ont-elles concouru à la désaffection à l’égard du « Signe de piste », mais celle-ci est surtout imputable au changement des attentes du public (qu’il faudrait mettre en relation avec l’évolution de la place du scoutisme, et plus particulièrement du scoutisme traditionnel – et des valeurs qu’il promeut –, dans la société). Cette mutation explique certainement le désintérêt relatif manifesté par les éditions Fleurus, qui, si elles avaient escompté des résultats plantureux de la relance de la collection, auraient vraisemblablement investi davantage qu’elles ne l’ont fait dans la réédition de titres anciens, dans la publication de nouveaux ouvrages, et surtout dans leur diffusion. En tout cas, la collection a survécu malgré tout, ce qui permettait à Nic Diament de constater, en 1993, que le « Signe de piste », « malgré des avatars nombreux, perdure depuis 1937 […]25 ».
← 19 | 20 → Quoi qu’il en soit de ces vicissitudes, le « Signe de piste » s’est signalé par une réception enthousiaste de la part de nombreux lecteurs26. En 1995 paraissait un recueil de témoignages livrés à propos du scoutisme par des personnalités médiatiques27. C’était l’occasion pour plusieurs d’entre elles d’évoquer (parfois de façon seulement allusive) le « Signe de piste » : « J’ai dévoré aussi la littérature de cette époque, toute la collection Signe de Piste, le Prince Éric. Je les ai relus récemment et ça me fait toujours rêver28 » (Jérôme Bonaldi), « À travers les dessins de Pierre Joubert (dont l’ambiguïté sexuelle m’échappait complètement), mes “rôles modèles” allaient s’occidentaliser et c’est en interprètes du “Prince Éric” que, en compagnie des membres de ma sizaine, tapis dans l’ombre d’un quelconque château abandonné couvert de lierre, nous guettions d’éventuels assaillants29 » (Jean-Paul Goude), « En fouillant dans ma bibliothèque, je suis presque certain d’y retrouver quelques volumes narrant les aventures d’un personnage légendaire pour les scouts de mon époque, le Prince Éric, dont l’ombre s’allonge et s’évapore comme la prière des scouts autour du feu de camp30 » (Jacques Martin), « On montait des pièces de théâtre pour les veillées. C’est ainsi que j’ai interprété le prince Éric, le héros du best-seller de Serge Dalens. Ces aventures pleines d’idéalisme et de pureté glorifiaient l’amitié, exaltaient la chevalerie31 » (Bertrand Poirot- Delpech). Près de vingt ans séparent Bertrand Poirot-Delpech (né en 1929) de Jérôme Bonaldi (né en 1952), mais l’on ne constate pas de différence notable entre les souvenirs de l’un et ceux de l’autre.
Plus de trois quarts de siècle après la naissance du « Signe de piste », cet enthousiasme est encore présent – qualitativement, mais pas quantitativement, car les politiques actuelles d’édition et de distribution ont considérablement réduit l’audience des romans scouts. L’Association des amis du Signe de piste, créée en 197532, fut active jusqu’à sa dissolution en 2013, notamment par l’intermédiaire d’un bulletin d’information trimestriel. Plusieurs sites internet existent, grâce auxquels les ← 20 | 21 → lecteurs ont la possibilité de partager leur passion pour ces romans. L’un ou l’autre forum de discussion montrent que des jeunes continuent de lire et d’apprécier le « Signe de piste », quel que soit le milieu social auquel ils appartiennent (en particulier, quelles que soient leurs orientations politiques ou religieuses) : telle adolescente de seize ans affirme lire des « Signe de piste » depuis l’âge de douze ans ; la fondatrice du forum Birkenwald dit, en 2003, avoir dix-sept ans, et l’une des modératrices en aurait vingt-deux ; une autre lectrice, de vingt-huit ans, déclare son intérêt pour ces romans, dont elle a lu le premier à onze ans et dont elle reconnaît implicitement qu’ils ont influencé le choix du prénom de son fils33. Ces lectures sont souvent dues aux parents, voire aux grands-parents34 – on repère donc ici un phénomène de transmission d’un héritage culturel –, aux camarades ou aux éducateurs35, ou parfois au hasard (livres trouvés dans une bibliothèque36, chez un bouquiniste ou dans un grenier…). En tout cas, malgré des changements culturels importants ← 21 | 22 → depuis sept décennies, les réactions – par rapport à des lectures nouvelles ou à des relectures37 – demeurent assez similaires à celles qui pouvaient être observées jadis ; nous en montrerons plusieurs exemples au cours de notre analyse.
Méthode
Partant de ces réactions enthousiastes, nous placerons au cœur de notre approche l’écho rencontré par un texte auprès d’un lecteur – un écho que Gaston Bachelard présentait dans La Poétique de l’espace comme « le doublet phénoménologique des résonances et du retentissement38 ». Selon cet auteur, « [l]es résonances se dispersent sur les différents plans de notre vie dans le monde, le retentissement nous appelle à un approfondissement de notre propre existence. Dans la résonance, nous entendons le poème, dans le retentissement nous le parlons, il est nôtre. Le retentissement opère un virement d’être39 ». C’est ainsi à une phénoménologie de l’expérience littéraire qu’ouvrent ces concepts bachelardiens, qui ont trait tous deux à l’impact d’une œuvre sur l’être du sujet lisant. La démarche à laquelle ils invitent est donc concernée par deux pôles fondamentaux : celui du texte et celui de son récepteur. La collection « Signe de piste » a déjà fait l’objet de plusieurs études : mémoires40, thèses de doctorat41, articles publiés dans ← 22 | 23 → des revues ou dans des ouvrages collectifs42, ainsi qu’un recueil d’actes de colloque43. Certains d’entre eux abordent la question de la réception, en particulier la thèse de Christian Guérin, éditée chez Fayard en 199744. Celle-ci n’est certes pas exempte de reproches : Gérard Cholvy a par exemple noté une « méconnaissance gênante du contexte historique et des institutions religieuses » ainsi qu’une « tendance constante à s’ériger en juge prêt à instruire des procès en sorcellerie »45. Mais les grandes lignes de cette étude sont incontestablement dignes d’intérêt : il s’agit d’exposer de quelle façon le scoutisme des Scouts de France46 et la collection « Signe de piste » ont façonné ensemble un système de représentations propre à fasciner l’adolescent et à lui inculquer une vision du monde spécifique, sur fond d’un projet de société inspiré d’une théologie politique coulée dans un imaginaire largement moyenâgeux. Ce résumé ne rend pas justice à l’œuvre de Guérin, mais il est suffisant pour montrer les affinités de nos recherches avec les siennes. Deux traits fondamentaux nous distinguent cependant de celles-ci. D’une part, L’Utopie Scouts de France s’intéresse essentiellement à la réception des romans du « Signe de piste » par des lecteurs évoluant d’une façon ou d’une autre dans le giron du scoutisme, alors que nous prendrons en compte la réception d’une manière plus générale. D’autre part, Guérin ne travaille pas en analyste littéraire. C’est d’ailleurs le manque d’une approche spécifiquement littéraire qui explique certaines limites de son étude à propos du « Signe de piste » : les intuitions qui parcourent son travail se révèlent souvent nourrissantes, mais ne sont pas appuyées par une analyse suffisamment précise des documents littéraires ou iconographiques, ni prolongées par une démarche interprétative approfondie. Il reste que nous nous inspirerons fréquemment de ses recherches (qui seront citées le cas échéant) – ou que nos propres analyses les recouperont involontairement (elles ne seront alors pas évoquées systématiquement) –, mais en adoptant une démarche analytique littéraire.
← 23 | 24 → La réception
Les relations entretenues par le texte littéraire et son lecteur ont été largement envisagées ces dernières décennies47. Ainsi, les théoriciens de l’effet postulent l’existence d’un lecteur implicite (Wolfgang Iser) ou modèle (Umberto Eco), dont la marge de manœuvre est extrêmement réduite puisque sa lecture est programmée par le texte (même si elle est appelée à se faire créative lorsqu’il s’agit d’investir les « lieux d’indétermination » du texte). Une telle orientation présente l’avantage de rester attentive au texte, ce qui constitue un préalable important pour l’analyse littéraire. Cependant, son inconvénient réside dans le fait que le lecteur modèle ne peut être conçu que comme une virtualité, qui, bien qu’inscrite dans le texte, ne se concrétise pas forcément dans la réalité : « Le lecteur postulé par le texte reste en effet, et quoi qu’on en dise, une conjecture48. » Or, si la lecture a une véritable portée existentielle, c’est parce qu’elle touche une personne réelle qui « appréhende le texte avec son intelligence, ses désirs, sa culture, ses déterminations socio-historiques et son inconscient49 ».
Prenant acte de cette importance de la réalité extérieure au texte, d’autres théories préfèrent à la notion d’« effet », centrée sur le texte, celle de « réception » ; « résolument externes, elles cherchent notamment à rendre compte de l’influence exercée sur la lect[ur]e par les différents contextes de réception, que ce soit à travers l’histoire […] ou à travers les divers groupes de la société […]50 ». L’un des grands noms de cette mouvance théorique est celui de Hans Robert Jauss. Avec son « esthétique de la réception », celui-ci s’intéresse à l’inscription d’une œuvre sur la toile de fond d’un « horizon d’attente », « c’est-à-dire dans un ensemble de connaissances relatives aux genres littéraires, aux “intertextes” possibles (sources) et aux courants esthétiques51 ». C’est du moins ce qui a été le plus retenu de la pensée de Jauss, ce qui continue aussi d’être généralement véhiculé lorsqu’il s’agit de résumer son œuvre. Or, cet aspect de sa théorie ne nous intéresse pas au premier chef, car il réduit l’horizon d’attente à des données strictement littéraires, comme en témoigne Jauss dans ce passage : « L’analyse de l’expérience littéraire du lecteur échappera au psychologisme dont elle est menacée si, pour décrire la réception ← 24 | 25 → de l’œuvre et l’effet produit par celle-ci, elle reconstitue l’horizon d’attente de son premier public, c’est-à-dire le système de références objectivement formulable qui, pour chaque œuvre au moment de l’histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : l’expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et l’opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne52. » Cependant, Jauss ne restreint pas son esthétique de la réception à cette première orientation. Au contraire, il indique que les effets de l’œuvre littéraire touchent le récepteur non seulement en tant que lecteur, mais aussi en tant qu’être du monde. Sa conception de la fonction libératrice de l’expérience esthétique est à cet égard révélatrice : « La libération par l’expérience esthétique peut s’accomplir sur trois plans : la conscience en tant qu’activité productrice crée un monde qui est son œuvre propre ; la conscience en tant qu’activité réceptrice saisit la possibilité de renouveler sa perception du monde ; enfin […] la réflexion esthétique adhère à un jugement requis par l’œuvre, ou s’identifie à des normes d’action qu’elle ébauche et dont il appartient à ses destinataires de poursuivre la définition53. » C’est pourquoi Jauss propose de distinguer, à côté de l’« horizon d’attente littéraire », un « horizon d’attente social ». Celui-ci dote le lecteur d’une possibilité de précompréhension de l’œuvre, qui « inclut les attentes concrètes correspondant à l’horizon de ses intérêts, désirs, besoins et expériences tels qu’ils sont déterminés par la société et la classe à laquelle il appartient aussi bien que par son histoire individuelle54 » ; cette mention de l’histoire individuelle montre que Jauss ne s’intéresse pas seulement à une réception collective, mais aussi à la réception individuelle (via la lecture), que nous privilégierons. L’expérience esthétique naîtrait en fait de la rencontre entre l’effet, produit par l’œuvre, et la réception, qui dépend du lecteur. La consonance – Jauss parle de « fusion » – entre ces deux horizons « peut s’opérer de façon spontanée dans la jouissance des attentes comblées, dans la libération des contraintes et de la monotonie quotidiennes, dans l’identification acceptée telle qu’elle était proposée, ou plus généralement dans l’adhésion au supplément d’expérience apporté par l’œuvre55 ». Même si la fusion des horizons ne se limite pas à ce phénomène (elle « peut aussi prendre une forme réflexive56 »), c’est à lui que nous nous intéresserons surtout.
← 25 | 26 → L’importance du texte
Cette conception de l’expérience esthétique présente notamment l’intérêt de conjuguer attention au texte et intérêt pour le lecteur, analyse interne et perspective externe. Ainsi, comme l’écrit Vincent Jouve, « [t]oute lecture se présentant comme une interaction entre l’individu qui tient le livre entre ses mains et le texte qu’il affronte, appréhender l’expérience lectorale suppose de réfléchir sur la façon dont se combinent la subjectivité du lecteur et les prescriptions du texte57 ».
Alors qu’une certaine orientation de la sociologie de la littérature se centre tellement sur le lecteur qu’elle en oublie la spécificité formelle des textes lus, nous nous proposons de ménager une place importante à l’analyse interne (narratologique, sémiologique, stylistique…) des œuvres étudiées58, non parce que cette démarche serait a priori la meilleure, mais parce qu’elle permet de dégager des significations qui ne pourraient pas être objectivées sans elle. Or, celle-ci fait parfois défaut aux recherches menées en littérature de jeunesse. Il serait toutefois inexact de prétendre qu’elle n’existe pas : les travaux de Francis Marcoin ou d’Isabelle Nières-Chevrel, pour ne citer que ces deux noms, montrent que l’on peut s’intéresser à la littérature de jeunesse en ne négligeant pas les outils classiques de l’analyse littéraire interne, ce que confirment d’autres exemples mentionnés par Jean Perrot dans son panorama de la critique59 ; en outre, certaines revues destinées à ce secteur sont attentives à ce type de perspective – par exemple les Cahiers Robinson, dont Perrot parlait en 1999 comme de la « seule revue universitaire de recherche pure sur la littérature de jeunesse […]60 ». Cependant, plus que la littérature générale, la littérature de jeunesse constitue un champ où se rencontrent des intervenants provenant d’horizons divers. Il n’entre pas dans nos intentions de contester la richesse des approches des psycho-pédagogues, des éducateurs ou des bibliothécaires, qui présentent certainement un grand intérêt, mais leur diffusion tend parfois à éclipser les travaux proprement littéraires : les recherches consacrées à la littérature de jeunesse occupent plus souvent les rayons de didactique, de pédagogie ou de psychologie que ceux des études de littérature générale, réduisant l’analyse interne à la portion congrue. Or, il nous semble important de traiter les livres ← 26 | 27 → pour la jeunesse, du point de vue de la rigueur et de l’approfondissement de l’analyse textuelle, comme n’importe quelle œuvre littéraire, avec les mêmes exigences de problématisation et de conceptualisation.
Précisons que, malgré l’attention au texte que nous revendiquons, nous nous efforcerons d’éviter de trop verser dans le technicisme, c’est-à-dire dans des analyses qui trouveraient en elles-mêmes leur propre fin61 et déboucheraient sur « une approche littéraire oublieuse de la “vie”62 ». Nous pensons en effet, comme Gérard Langlade, que « [l]a cohérence interprétative repose en fait sur [la] “sécularisation” de l’œuvre – cette appréhension de l’œuvre comme si elle renvoyait au monde réel – car elle utilise les mêmes catégories morales, culturelles, métaphysiques, que celles qu’utilise habituellement le lecteur dans son approche du monde63 ». En d’autres termes, l’analyse technique du signifiant doit absolument s’ouvrir à l’« épistémologie du signifié64 », sous peine de stagner au stade d’une rhétorique trop vaine et stérile, comme le font toutes les techniques qui se substituent aux fins qu’elles devraient servir.
L’imaginaire littéraire
En essayant de mettre en lumière – de façon hypothétique, rappelons-le – quelques-unes des raisons du succès des romans scouts du « Signe de piste », nous entendons finalement esquisser les contours d’un imaginaire littéraire spécifique. La notion d’imaginaire n’est pas sans rapport avec la réception, tant il est vrai que, comme l’écrit Christian Chelebourg, « [d]u point de vue de la littérature, l’imaginaire a pour fonction essentielle d’élaborer des images en vue de produire sur le lecteur un effet déterminé65 » ; l’image littéraire « éveille en nous des échos transsubjectifs, […] fait, pour ainsi dire, vibrer en nous des cordes qui dépassent notre existence individuelle, voire notre culture66 ».
Parmi les grands noms qui ont marqué les recherches sur l’imaginaire depuis le milieu du XXe siècle, nous retiendrons surtout celui de Gilbert Durand. Outre le fait que ses théories inspireront largement certaines parties de notre analyse, sa notion de « trajet anthropologique » correspond ← 27 | 28 → à notre prise en compte conjointe du social et du subjectif, puisqu’elle désigne « l’incessant échange qui existe au niveau de l’imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations objectives émanant du milieu cosmique et social67 ». L’imaginaire se constitue ainsi dans un dialogue incessant entre l’individuel et le collectif, « l’essentiel de la représentation et du symbole étant contenu entre ces deux bornes réversibles68 ». Voulant dépasser les solutions partielles des « herméneutiques réductives », dont la prétention à embrasser la totalité du sens est mise en échec par leurs limites intrinsèques69, Durand se situe sur un plan anthropologique qui lui permet de prendre une certaine hauteur par rapport à ce qu’il étudie, grâce à son ouverture à « [l]a psychanalyse, les institutions rituelles, le symbolisme religieux, la poésie, la mythologie, l’iconographie ou la psychologie pathologique […]70 ».
L’inspiration psychosociologique
C’est parce que nous pensons que, tout en étant d’une nature autre que le monde auquel il se réfère, le texte littéraire n’est pas absolument étranger à celui-ci, que le contexte revêt selon nous une grande importance dans l’interprétation d’une œuvre : à l’instar de Gilbert Durand, nous sommes convaincu de la nécessité de « ne pas faire une coupure entre le culturel et le social, ou – si l’on préfère –, entre les “textes” culturels, littéraires en particulier, et les “contextes” sociaux71 ».
Contrairement à la méthode suivie par certaines études de psychologie, de sociologie ou de psychosociologie, notre analyse ne se basera pas sur une enquête systématique effectuée sur la base d’un échantillon de lecteurs sélectionné selon des critères intentionnellement établis. Elle procédera par induction (ce qui lui confère un caractère hypothétique assumé comme tel) : d’une part, on se servira d’un nombre important de témoignages, récoltés dans des ouvrages, des revues ou sur internet72, que l’on ← 28 | 29 → considérera comme représentatifs de réactions généralement observables ; d’autre part, on admettra qu’il est possible de modéliser, de façon schématique, un contexte socio-culturel et une disposition psychique à partir de lignes de force constituées par la récurrence de faits singuliers.
Partant de ce dernier principe, nous nous intéresserons à certains traits saillants de la culture et de la société françaises entre 1937 (date de la publication originale du Bracelet de vermeil, le roman le plus ancien de notre corpus) et 2000 (année de la réédition la plus récente des ouvrages sélectionnés – celle de Faon l’héroïque, en l’occurrence). Nous n’aurons pas la naïveté de penser qu’il soit possible de considérer les événements de ces quelque soixante années de façon statique, car cette période s’est montrée riche en mutations de divers ordres. Pourtant, des phénomènes paraissent la traverser avec une certaine constance, malgré des changements de forme et des variations d’intensité. Il existe donc, sous certains aspects, une continuité entre 1937 et 2000, qui permet d’envisager certains phénomènes apparus durant cette période de façon synchronique, tout en restant attentif aux modifications de type diachronique. Ajoutons que nous nous intéresserons particulièrement aux représentations collectives, que nous mettrons en relation, lorsque cela se révélera utile, avec des éléments d’ordre socio-historique.
Pour ce qui est du cadre psychique, il serait évidemment absurde d’envisager les individus comme autant de répliques les uns des autres, qui ne se caractériseraient que par d’infimes particularités. La richesse et la complexité de l’être humain tiennent en effet notamment à ses propres variations, qui le constituent en tant que sujet différencié. Néanmoins, psychologues et psychanalystes reconnaissent volontiers l’existence de certains invariants, qui permettent d’inférer, chez des sujets parfois très différents, la présence de caractéristiques communes, en se basant entre autres sur certains modèles mis en évidence par la psychologie du développement. Étant donné que la collection « Signe de piste » s’adresse à un public juvénile, c’est à l’adolescence que nous nous intéresserons spécifiquement. Dans une perspective développementale, on peut admettre que cet âge de la vie se caractérise par un certain nombre de processus psychiques. Cela ne signifie pas que tout adolescent73, pris individuellement, corresponde à la description abstraite qu’en proposent les ouvrages spécialisés, ← 29 | 30 → mais que, dans la plupart des cas, ces processus se retrouvent, fût-ce de façon incomplète, dans la constitution particulière du sujet. Il existe donc, idéalement, une certaine permanence dans le portrait psychique de l’adolescent. Encore faut-il préciser que, comme c’était le cas pour la sphère socio-culturelle, ce modèle n’échappe pas à la variation, car l’adolescence des années 1930 n’est pas exactement semblable à celle des années 2000, dont Raymond Cahn a montré qu’elle était porteuse de nombreuses interrogations quant aux mutations qu’elle pourrait connaître74. Toutefois, étant donné que nos investigations se limitent à une culture donnée et à un laps de temps circonscrit, il est possible de postuler un minimum de stabilité.
Composition du corpus
Il va de soi que le catalogue du « Signe de piste », riche de près de quatre cents titres différents (si l’on prend en compte les titres publiés dans les collections affiliées : collections « sœurs » – « Prince Éric », « Joyeuse », « Rubans noirs » – et « filles » – « Safari - Signe de piste », « Le Nouveau Signe de piste »), ne pouvait dans son intégralité servir de base à une analyse telle que nous entendons la mener. Pour cette raison, il nous a semblé indispensable d’opérer une sélection parmi ces ouvrages, afin de n’en retenir que ceux qui nous paraissaient les plus significatifs.
Dans un premier temps, nous avons convenu de ne nous intéresser qu’aux romans parus dans la collection « Signe de piste » stricto sensu, à l’exception des collections affiliées. Parmi eux (plus de deux cents titres), seuls ceux identifiés comme « romans scouts » par le Copse75 ont été conservés (soixante-dix-sept titres). De ceux-ci ont été éliminées les traductions (trois titres seulement76). Dans l’optique d’une étude attentive à la réception, les ouvrages les plus plébiscités nous intéressaient particulièrement. Devant la difficulté de mesurer le succès de tel ou tel roman, nous avons choisi un critère discutable sans doute, mais qui présente au moins le mérite d’une certaine objectivité : celui de la réédition. En effet, quelles que soient les intentions de divertissement ou d’éducation mises ← 30 | 31 → en avant par les éditeurs, ceux-ci visent également – et parfois avant tout – le profit commercial. Dans cette perspective, un éditeur ne reprendra, en règle générale, que les ouvrages qui ont connu un succès suffisant lors de leur première publication ou dont il espère qu’ils connaîtront ce succès à l’occasion d’une réédition. Une seule réédition ne nous semblant pas significative, nous avons privilégié le critère des rééditions successives : nous n’avons ainsi retenu finalement que les romans parus initialement dans la collection « Signe de piste » proprement dite, réédités ensuite soit en « Safari - Signe de piste », soit en « Nouveau Signe de piste » (la brève durée de vie du « Safari - Signe de piste » autorisant ce choix entre les deux collections), puis publiés de nouveau, récemment cette fois, soit chez Fleurus, soit chez Élor, soit aux Éditions du Triomphe, soit chez Alain Gout. Précisons que nous nous sommes arrêté en 2000, date à laquelle nous avons commencé à constituer notre corpus.
Deux écarts par rapport à ces principes de sélection doivent être signalés. Le premier va dans le sens de la restriction : il s’agit de l’exclusion du Puits d’El-Hadjar de Dachs et du Tigre et sa Panthère de Guy de Larigaudie, qui auraient dû figurer dans la liste des ouvrages étudiés. A priori, il peut sembler contestable d’écarter le roman de Dachs : le narrateur extradiégétique est scout, et sa venue en Algérie est liée à son passé dans le scoutisme ; de plus, sa rencontre avec le narrateur intradiégétique n’est permise que par l’intermédiaire d’un lieutenant qui a lié connaissance avec le premier parce qu’il avait remarqué son insigne scout. Cependant, le protagoniste du récit enchâssé, qui constitue l’essentiel du roman, n’est pas scout, et son histoire n’a aucun rapport avec le scoutisme, ce qui place ce récit en marge de la définition du roman scout que nous avons adoptée. Quant au Tigre et sa Panthère, il se distingue des autres ouvrages du corpus par sa thématique : il s’agit d’un récit animalier, très différent de la plupart des autres romans scouts, et en tout cas marginal par rapport à tous ceux que nous avons sélectionnés ; en outre, en dépit du prestige de son auteur, il semble que la réception n’ait pas unanimement consacré ce roman, dont on peut se demander s’il n’a pas été réédité principalement à cause de l’incontestable aura développée autour de la figure de Guy de Larigaudie, ce routier-scout célèbre entre autres pour avoir réalisé le premier raid Paris-Saïgon en automobile (1937-1938), et qui trouva la mort au combat le 11 mai 1940.
La seconde liberté que nous avons prise par rapport à nos principes de sélection consiste en un élargissement, puisque nous avons choisi de ne pas morceler les séries. Ainsi, même si Éric le Magnifique et Ainsi régna le prince Éric n’ont pas été édités initialement au « Signe de piste » (mais au « Nouveau Signe de piste » pour l’un et chez Fleurus pour l’autre, en raison de la date de leur édition originale), nous envisagerons l’ensemble de la série du Prince Éric, qui forme un tout non seulement du point de ← 31 | 32 → vue de l’œuvre, mais aussi, vraisemblablement, pour un certain nombre de lecteurs. De la même façon, même si Jimmy ne peut pas être considéré comme un roman scout au sens strict, son appartenance à la trilogie des Voleurs, composée notamment de deux romans scouts, nous a semblé suffisante pour qu’il soit intégré au corpus.
En vertu de ces critères de sélection, c’est à un corpus de vingt et un romans que nous nous intéresserons, dont les trois quarts sont l’œuvre de Serge Dalens (neuf titres) ou de Jean-Louis Foncine (six titres), soit les deux auteurs de la collection « Signe de piste » qui, selon de nombreux témoignages, ont le plus marqué le public77. Ce choix s’avère en adéquation avec les préférences des lecteurs, comme le montre un sondage organisé en 2003 par la liste de diffusion Birkenwald (mais dont il faut cependant relativiser les résultats, en raison du nombre très peu élevé de participants) : à la question « Quels sont vos auteurs préférés ? », treize personnes ont voté (dans une liste prédéfinie) pour Serge Dalens (résultat le plus important), dix pour Jean-Louis Foncine, sept pour Jean Valbert, six pour X. B. Leprince et quatre pour Maurice Vauthier (contre deux seulement pour Guy de Larigaudie, Pierre Delsuc ou Jean-Claude Alain, et aucun pour Dachs ou Michel Bouts)78. Cela étant, nous sommes parfaitement conscient du fait que des pans entiers du roman scout du « Signe de piste » ne sont pas représentés dans ce corpus, alors que leur étude se révélerait instructive. Aussi la sélection que nous proposons ne préjuge-t-elle en rien de la qualité, de l’originalité ou de l’importance des œuvres retenues ou laissées de côté.
Précisons encore que, dans la mesure du possible, nous prendrons comme référence l’édition définitive de chacun des romans étudiés, mais que cette règle générale comportera un certain nombre d’exceptions79.
← 32 | 33 → Contenu
Dénoncer le désordre à l’œuvre dans le monde et proposer des remèdes à celui-ci : tel serait l’un des propos (nous ne parlons pas de « projet », car l’on a trop souvent prêté aux romans du « Signe de piste » et à leurs auteurs d’hypothétiques intentions80) des romans scouts étudiés. Puisque ceux-ci sont reçus dans un contexte socio-culturel lui-même marqué par le thème du désordre et de la mise en ordre, ainsi que par des lecteurs dont l’adolescence est forcément concernée par de telles problématiques, ils ont toutes les chances de rencontrer les représentations et les préoccupations, parfois les plus intimes, de leurs destinataires.
La première partie de notre analyse aura pour objet la prise en compte de quelques grandes formes de désordre et des réponses que les romans scouts tentent d’y apporter. Elle s’attachera particulièrement, dans un premier ← 33 | 34 → chapitre, à détailler cette perturbation et à envisager les solutions qui peuvent lui être opposées par le recours à l’imaginaire. On s’intéressera principalement à ce que Gilbert Durand nomme l’imaginaire « synthétique », qui sera abordé au sein de trois sphères différentes, l’une collective (il sera alors question de la discorde et de l’unité), l’autre duelle (on évoquera à ce propos l’amitié contrariée et la formule narcissique qui prétend s’opposer à l’obstacle), la troisième individuelle (concernée par le désordre intrinsèque à l’individu et par une androgynie qui ferait office de remède). Dans un second chapitre, on approfondira la question de l’ordonnancement et de l’imaginaire « synthétique » dans la perspective particulière de la temporalité, qui permettra de mettre en évidence le problème constitué par la rupture de la continuité historique et le rôle de restauration joué par une approche « synthétique » du temps, notamment concrétisée dans le récit.
La deuxième partie de notre analyse sera consacrée spécifiquement à la dimension pragmatique de la communication littéraire. Elle montrera comment s’élabore un processus d’initiation qui permet au lecteur de renouveler, par l’expérience littéraire, son rapport au monde. L’approche psychosociologique s’ouvrira alors à une lecture plus fondamentalement anthropologique, au cours de laquelle seront envisagées entre autres les questions de la fiction et du numineux.
Details
- Pages
- 413
- Publication Year
- 2015
- ISBN (PDF)
- 9783035264715
- ISBN (MOBI)
- 9783035299724
- ISBN (ePUB)
- 9783035299731
- ISBN (Softcover)
- 9782875742001
- DOI
- 10.3726/978-3-0352-6471-5
- Language
- French
- Publication date
- 2015 (January)
- Keywords
- Stratégie discursive Émotionne Expérience esthétique Littérature comparée
- Published
- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2014. 413 p.